Les possibles leçons de la sociologie quantitative à l’ethnographie
Possible lessons from quantitative sociology to ethnography
Résumé
Ce texte vise à favoriser le dialogue entre sociologues « qualitativistes » et sociologues « quantitativistes », notamment pour les étudiants en recherches doctorales. S’il est bien connu que la sociologie statistique aurait à gagner à se fonder sur des études de terrains pour élaborer ses modèles, la position inverse est moins souvent discutée alors qu’elle est pourtant stimulante. Je souhaite montrer ainsi que certaines précautions prises par les quantitativistes pourraient inspirer d’une manière originale les chercheurs de terrain en particulier pour les problèmes d’échantillonnage, d’établissement de la causalité, de vérification de la validité, d’étude des variables, de modélisation, et d’élaboration théorique. Pour chacun de ces aspects je propose des exemples montrant à partir d’études sociologiques classiques comment les démonstrations auraient pu être renforcées par l’adoption de certains raisonnement empruntés à la sociologie statistique.
Mots clés : Méthode sociologique; Ethnographie; Statistiques; Modèles; Validité.
Abstract
This text aims at promoting conversations between 'qualitative' and 'quantitative' sociologists, particularly for doctoral students. While it is well known that statistical sociology would benefit from relying on field studies to develop its models, the opposite position is less often discussed, although it is nevertheless stimulating. I thus try to show that certain precautions taken by quantitative researchers could inspire some original ways field researchers, in particular regarding the problems of sampling, establishing causality, verifying validity, studying variables, modelling, and theoretical development. For each of these aspects, and based on classical sociological studies, I offer examples of how the demonstrations could have been strengthened by adopting some of the reasoning borrowed from statistical sociology.
Keywords: Sociological method; Ethnography; Statistics; Models; Validity.
------------------------------
Christophe Brochier
Sociologue
Université Paris 8, Laboratoire CREDA (IHEAL)
Chrisbrochier[at]yahoo.com
Article reçu le 3 décembre 2021 ; accepté le 18 juillet 2022
Les possibles leçons de la sociologie quantitative à l'ethnographie
La simple observation des carrières et des publications des sociologues montre que le dialogue entre praticiens des méthodes qualitatives (entretiens et observation en particulier) et les utilisateurs des modèles statistiques est peu développé ; pour des raisons de formation notamment, les sociologues ont tendance à choisir l’une des deux options et à s’y tenir. Le fléchage des postes de maîtres de conférences ouverts au recrutement contribue d’ailleurs à maintenir la distinction entre les deux types de profils. Il n’est donc pas étonnant que peu d’enquêtes combinent les deux approches et que les discussions de méthode prennent place à l’intérieur des cadres disciplinaires établis. On peut le regretter car chacune des deux façons d’étudier la réalité sociale a ses mérites et ses vertus, et l’échange de points de vue permettrait sans doute des transferts de précautions méthodologiques. Plus exactement, la pratique des deux types de méthode montre que chacun est sensible à certains raisonnements et que les précautions qu’il développe pourraient être sources d’enseignement pour l’autre. Les « qualitativistes » (c'est-à-dire, dans ce texte, ceux travaillant à partir d’entretiens et d’observations) sont ainsi, en général, attentifs à produire des données de « qualité », dont les capacités à décrire la réalité sociale sont éprouvées puisque liées à des procédures cognitives de sens communs. Ils tâchent d’ordinaire de saisir les caractéristiques de la situation avec précision et s’efforcent de restituer le « sens » des situations et des actions. Les « quantitativistes » sont plus soucieux des moyens de généraliser des connaissances portant sur les acteurs à partir d’effectifs importants. Ils s’intéressent en particulier aux problèmes d’échantillonnage et examinent avec soin les effets des variables pertinentes les unes sur les autres.
La thèse qui sous-tend ce court article est que rien n’oblige le méthodologue à penser les deux perspectives comme relevant de mondes séparés, mêmes si les praticiens appartiennent en général à des traditions épistémologiques différentes. Des lectures croisées peuvent permettre aux enquêteurs de chaque bord non seulement de saisir l’importance des précautions prises ordinairement par les autres, mais encore de trouver les moyens d’en tirer des conséquences pratiques. J’insiste sur le terme de précaution puisque mon propos n’est pas d’inciter les quantitativistes à faire des campagnes d’entretiens ou les ethnographes à s’initier à l’analyse de variables (quoique que ce serait sans doute profitable à tous). Mes remarques concernent un renforcement de la rigueur de chaque méthode par une prise en compte des exigences des autres approches. Elles sont justifiées par le fait que ma longue pratique de l’ethnographie, s’est trouvée enrichie par l’étude des méthodes économétriques des économistes du travail (Brochier, 2021). C’est sur la base de cette expérience que s’organiseront les quelques suggestions que je ferai dans ce texte, destinées en particulier aux étudiants en master ou en doctorat qui cherchent à étendre leurs compétences méthodologiques. Il ne s’agira donc pas de proposer un traité de méthodologie ni une comparaison systématique entre les deux types de traditions de recherche. Je me bornerai en fait à regarder comment les sociologues « qualitativistes » pourraient gagner à s’intéresser de plus près, ou tout au moins d’une manière originale pour eux, dans une perspective empruntée aux démarches quantitatives, aux problèmes d’échantillonnage, de causalité, de variables, de mesure et de généralisation. Cette démarche ne présuppose aucune supériorité éventuelle des méthodes quantitatives sur les qualitatives. Elle ne repose pas non plus sur l’idée que les quantitativistes ne prennent jamais en compte les dimensions que je mets en avant. Le principe que je développe est que chaque approche peut s’enrichir d’un intérêt porté aux autres en s’appuyant sur des logiques qui ne lui sont pas familières. J’illustrerai mes remarques d’exemples empruntés à des textes classiques de la littérature sociologique essentiellement américaine, de façon à prendre mes distances avec d’éventuelles polémiques actuelles, notamment dans le cadre de la sociologie française.
L’échantillonnage
Les enquêtes ethnographiques se fondent en principe sur l’étude des groupes ou des individus qui permettent de circonscrire raisonnablement le sujet choisi et qui ont accepté la présence du chercheur. Parfois les enquêteurs sélectionnent plusieurs unités d’études (localités, institutions ou organisations, etc.) pour augmenter la variété des situations, mais la durée nécessaire à de telles entreprises limite en général l’ambition. Les enquêteurs de terrain se servent donc souvent d’ « échantillons de convenance » par rapport à leur thématique, voire construisent simplement leur sujet à partir des cas qu’ils ont pu examiner. Il peut difficilement en être autrement, vu la difficulté d’une ethnographie approfondie. La conséquence de cette situation est que les possibilités de généralisation s’en trouvent réduites. Le chercheur est souvent contraint de produire des conclusions limitées au seul cas étudié ou à proposer une application plus large de ses conclusions sans pouvoir se justifier véritablement. Ainsi, William Foote Whyte dans la conclusion de Street Corner Society (1943) discute des problèmes d’adaptation des Italiens du quartier étudié à la société bostonienne, et il étend ensuite (à la fin de l’ouvrage) ses affirmations, sans guère de précaution, aux rapports entre les Italo-Américains en général et la société américaine.
Les quantitativistes sont de leur côté beaucoup plus préoccupés par les questions d’échantillonnage car les chiffres qu’ils produisent peuvent être biaisés (ou rendus moins sûrs) par des échantillons insatisfaisants, c'est-à-dire peu représentatifs de la population totale. Ils préfèrent donc utiliser des échantillons de grande taille, constitués de préférence par un procédé pouvant s’apparenter à un tirage aléatoire. Ils peuvent également, comme le font les sondeurs d’opinion, constituer des échantillons par quotas, qui assurent une représentation des différents groupes pertinents similaire à celle de la population cible. S’ils travaillent sur des échantillons qu’ils n’ont pas fabriqués eux-mêmes, et qu’ils soupçonnent un biais de composition, ils peuvent utiliser des méthodes de pondération des effectifs des différentes sous populations.
Les sociologues enquêtant par entretiens ou observations n’ont pas besoin de telles procédures car ils ne cherchent pas à produire des chiffres précis, mais certaines précautions des quantitativistes peuvent les inspirer et les conduire à des procédures de deux types : d’abord discuter la capacité de l’échantillon à permettre des généralisations (ou montrer l’extension maximale de la généralisation) ; ensuite procéder à un échantillonnage théorique (Chapoulie, 2000) permettant de dégager certains principes de variation. Cette dernière précaution consiste à sélectionner l’échantillon à partir de certaines variables qui sont connues pour être essentielles ou dont l’importance apparaît au cours de l’enquête. Si l’on veut par exemple étudier les méthodes d’enseignement des professeurs de collège, il peut être utile de considérer des individus d’âge et de sexe différent et des établissements accueillant un public plus ou moins populaire. Si l’on omet ces précautions, on s’interdit de repérer dans quelle mesure les phénomènes décrits dépendent des caractéristiques de l’échantillon. Pour en prendre un exemple, nous pouvons revenir au cas de Whyte : les phénomènes qu’il décrit dépendent sans doute du fait que Boston était une ville où les descendants d’Irlandais étaient particulièrement nombreux et bien placés dans l’échelle sociale[1] et qu’ils étaient en conflits récurrents avec les descendants d’Italiens. Sa généralisation au pays entier était un peu aventureuse.
La causalité et la corrélation
La question de la causalité est une préoccupation ancienne et centrale des modèles statistiques. En regardant les corrélations entre variables, les quantitativistes cherchent souvent à savoir dans quelle mesure les variations d’une variable « indépendante » entraînent des variations sur une variable d’intérêt (ou « dépendante »). Par exemple, en sociologie de l’éducation, on peut regarder si les redoublements sont corrélés avec une amélioration des résultats scolaires. Pour des raisons complexes que l’on n’expliquera pas toutes ici, le passage d’une logique de corrélation à une logique de cause à effets est délicat et pose des problèmes récurrents aux spécialistes (Abbott, 1998). Les sociologues qualitativistes, de leur côté, sont plutôt portés à décrire des gens et des situations observées par eux ou décrites par les autochtones. Sur le sujet du redoublement, un enquêteur de terrain aurait plutôt tendance à observer le comportement des redoublants dans plusieurs classes et à procéder à des entretiens avec les élèves et les enseignants. Les préoccupations causales ne sont en général pas centrales dans ce type de démarches qui cherchent le plus souvent à produire des descriptions fouillées. Sans être centrales, elles sont cependant souvent latentes et peuvent être légitimement attendues par les lecteurs. Ainsi, dans le cas de l’échec scolaire, il serait intéressant pour le lecteur d’avoir une description des comportements des élèves « faibles » et « forts » (selon le point de vue professoral) ; mais une mise en rapport plus systématique avec des facteurs, des causes ou des éléments d’explication fait aussi partie de ce que l’on pourrait apprécier d’une étude sur le sujet. Ce que l’on peut décrire le plus facilement ce sont les causes immédiates qui se confondent presque avec l’échec scolaire (ne pas faire ses devoirs, ne pas venir en cours, avoir des lacunes, ne pas écouter, etc.) et il peut être utile de lier ces comportements à d’autres aspects moins immédiatement visibles. Si le chercheur n’affronte pas explicitement le problème de la mise en relation de ce qu’il peut observer avec d’autres éléments (« causes » plus ou moins lointaines), il court le risque de privilégier implicitement certaines caractéristiques des personnes ou des situations (la taille de la fratrie, le niveau d’éducation des parents, etc.), surtout si ces données sont plus facilement accessibles.
Je prendrai ici un exemple réel emprunté à l’ethnographie urbaine. Art Gallaher (1961), dans son « étude de communauté » (community study) de la bourgade de « Plainville », constate que les habitants ont tendance à considérer que les catholiques sont des « non chrétiens ». Il ne donne pas les raisons de ce jugement. En revanche, il explique la faible popularité des témoins de Jéhovah dans la ville en citant les commentaires des habitants fustigeant les recommandations « non patriotiques » des témoins (refuser la conscription et le salut au drapeau). Il aurait été intéressant d’en savoir plus, mais la méthode d’explication de l’auteur est apparemment (dans ce cas) fondée sur la possibilité de traiter comme « explication » des commentaires négatifs au sujet d’une religion. Il ne fournit donc pas au lecteur les données lui permettant de comprendre de quelle manière se construisent les jugements des autochtones au sujet des religions minoritaires.
On peut regarder, à titre de comparaison, la logique des études quantitatives en matière d’explication. Les modèles d’analyse quantitatives par variables utilisés pour fournir des « explications », c'est-à-dire des listes de corrélations entre la variable étudiée et des variables soupçonnées de contribuer à ses variations, obligent les praticiens à penser plus complètement la mise en relation du phénomène avec ses possibles « facteurs » de variation. Les statisticiens le font souvent en mobilisant dans leurs modèles les variables qui ont montré des effets évidents dans d’autres enquêtes. Dans certains travaux, ils vont plus loin et étudient des chemins causaux possibles montrant des relations complexes entre variables (par exemple l’éducation dépend du revenu qui dépend lui aussi de l’éducation, elle-même dépendante du type de localité, etc.[2]). De cette manière ils s’obligent à réfléchir au nombre, à la nature et aux modes d’action des différents facteurs possibles, démarche qui peut inspirer les démarches « qualitatives ».
Pour illustrer l’intérêt de cette démarche, on peut ici s’intéresser à un autre exemple d’ethnographie qui aurait pu s’en inspirer. Aaron Wildawsky (1964) a constaté lors de son étude d’ethnographie urbaine que les noirs de la petite ville d’Oberlin en Ohio dans les années 1960 étaient politiquement « apathiques ». Il semble expliquer ce fait en avançant que les gens en question, qui sont pour la plupart peu formés et mal payés, manquent de « conscience politique ». Les entretiens font pourtant apparaître des modalités plus subtiles. Ainsi, l’un des enquêtés ne s’est pas plaint d’une infraction l’affectant car il pensait apparemment qu’un homme comme lui ne pouvait rien faire contre les autorités municipales. Un autre dit ne pas avoir voté pour les démocrates car il se considérait comme un républicain. Il est évident ici que ces deux cas peuvent ouvrir des pistes d’explication différentes. Dans l’idéal, l’application de la logique de la modélisation par variable inciterait l’enquêteur voulant affiner ses analyses à mieux préciser par quoi se manifeste exactement le phénomène étudié et à mieux caractériser les facteurs possibles à l’œuvre.
Mais il est possible d’aller un peu plus loin encore. Le problème de l’« explication » en sociologie quantitative, et notamment par les modèles usant de la régression multiple est que ces derniers ne produisent que des mesures de corrélations, en principe du type « si la variable X augmente d’une unité, alors la variable étudiée augmentera de β unités ». Pour pouvoir parler strictement de cause, il faudrait pouvoir connaître tous les facteurs produisant des variations, de façon à pouvoir examiner celui qui nous intéresse en bloquant les autres (Givord 2014). C’est le modèle expérimental (ou quasi-expérimental) : je considère un groupe de contrôle et un groupe test, composés d’unités tout à fait comparables (que j’ai en principe prises de façon aléatoire au sein d’un groupe plus large pour éviter les biais de sélection), j’applique mon traitement au groupe test et je compare les résultats avec le groupe témoin. L’identification de l’effet causal est possible car j’ai neutralisé tous les autres facteurs pouvant s’ajouter à mon traitement. Bien sûr, une telle démarche est impossible à réaliser avec des données d’enquête de type démographique (trop nombreuses et souvent mal adaptées aux mesures), ce qui complique la tâche des quantitativistes. Mais le point important est que ces problèmes d’attribution d’effets causaux obligent les modélisateurs à discuter la question des « variables omises ». Il s’agit là d’une précaution particulièrement importante dès lors que l’on cherche des explications causales, et elle peut inspirer utilement les enquêteurs qualitativistes. Il n’est pas en effet acceptable de singulariser une caractéristique de la situation au titre de « variable explicative » sans véritable justification et de prétendre ensuite avoir expliqué un phénomène. Aucune discussion causale ne peut se faire sans un examen de l’éventail des facteurs à l’œuvre et de leur mode d’action. Prenons un exemple d’attribution non satisfaisante emprunté à un texte ethnographique. Dans son étude importante sur les écoliers britanniques de classe populaire, Paul Corrigan (1979) se demande pourquoi les enfants de l’école qu’il étudie chahutent, et il propose la réponse suivante à partir de ses entretiens : pour contester le pouvoir de l’institution et des professeurs tout en poursuivant leur mode de vie habituel à l’intérieur des murs de l’école. Donc deux facteurs sans doute liés entre eux et qui ont semblé important à l’enquêteur au cours de son travail. Mais est-on certain que la liste des facteurs n’aurait pas pu être allongée ? Cet exemple nous conduit à nous demander si la façon dont l’enquête ethnographique est conduite ne mène pas plus souvent à certaines explications plutôt qu’à d’autres.
L’étude des variables
Les quantitativistes raisonnent sur des variables qu’ils peuvent mesurer (de façon continue ou discontinue). Cela les oblige à définir avec une grande précision ce qu’ils veulent étudier et la manière de le mesurer. On peut penser que c’est une façon très réductrice d’envisager la réalité (et cela l’est, certes, mais de manière souvent assumée, la modélisation étant toujours une simplification). La démarche oblige cependant à distinguer et définir de façon systématique les différents éléments que l’on mobilise dans l’analyse tout en justifiant le choix. Évidemment, tous les quantitativistes ne montrent pas un égal niveau de rigueur, mais c’est ici le principe qui m’intéresse. Ce dernier peut présenter des intérêts pour un ethnographe. L’enquête de terrain met en effet toujours en présence de situations complexes, souvent embrouillées et où tout se mélange. Analyser une situation ou un phénomène demande cependant parfois de décomposer et d’évaluer avec une grande précision les éléments en jeu.
J’en prendrai un exemple tiré de la sociologie du Brésil contemporain. Dans leur ouvrage consacré à la situation des noirs à São Paulo, Roger Bastide et Florestan Fernandes (1955) s’efforcent de démontrer que les Afro-brésiliens sont victimes d’un racisme presque systématique dans de nombreuses situations de la vie courante. Mais ils définissent et décomposent de façon peu détaillée le phénomène étudié. Ainsi ils considèrent comme équivalents l’existence de proverbes racistes, l’enracinement séculaire d’un mépris racial, les distinctions statutaires liées aux tons de couleur et la discrimination effective. De même, ils ne font pas de distinction entre « préjugé de couleur » et « préjugé racial ». En termes quantitativistes, cela signifie que la variable d’intérêt est mal définie et que différentes façons possibles de la mesurer sont mal distinguées.
Un autre point est important. L’intérêt de la perspective quantitativiste dans le domaine de la description des facteurs est qu’elle s’efforce de mesurer l’intensité du lien entre les variables. L’opération serait assez difficile à réaliser dans l’enquête qualitative, mais rien n’empêche le chercheur de terrain de s’intéresser à la force du lien entre les situations et les faits. Ainsi William Westley (1970), quand il étudie l’usage de la violence chez les policiers américains dans les années 1960, s’attache à montrer dans quels cas elle est la plus fréquente. Il met en avant les situations dans lesquelles les délinquants résistent ou insultent les représentants de l’ordre, mais il ne décrit pas la force du lien entre les facteurs et les manifestations de violence (qu’il omet d’ailleurs aussi de décrire). Dans ce cas, l’exigence d’une sorte de mesure se traduirait ethnographiquement par l’obligation de mieux décrire plus de cas, de façon à établir des sortes de tableaux de correspondance. Un apport évident des méthodes quantitatives est d’ailleurs l’insistance sur la nécessité de prendre en compte des unités nombreuses (un grand « N » dans le vocabulaire des statisticiens) et de faire en sorte que les observations soient indépendantes les unes des autres. À l’inverse, les qualitativistes n’indiquent pas toujours sur combien de cas observés où d’individus ils fondent leurs analyses, et il n’est pas rare que le lecteur soit en position de soupçonner que le « N » n’est pas suffisant et que les cas observés soient liés les uns aux autres. Si les quantitativistes ont parfois la mauvaise habitude de se servir de données dont on ignore la qualité (car on ne sait pas les conditions réelles de leur production), les ethnographes ont souvent celle de proclamer implicitement : « Veni, vidi, comprehendi », ce qui revient à dire « j’y étais donc je sais et je n’ai pas besoin de vous prouver que ce que j’ai constaté suffit » (Brochier, 2015).
La modélisation
Les quantitativistes essaient de construire des « modèles », c'est-à-dire des représentations simplifiées de la réalité. Ils peuvent s’en servir pour faire des prévisions ou pour proposer des schémas explicatifs fondés sur la différence entre ce qui est « structurel » et ce qui relève de l’« aléatoire ». La question de la validité de ces modèles est toujours difficile et complexe, mais l’idée de décrire les éléments principaux d’un système de relations entre acteurs en séparant ce qui est plus ou moins stable et permanent de ce qui varie fortement est intéressante. Elle pourrait inspirer plus systématiquement les sociologues qualitativistes. L’enquêteur peut ainsi résumer ses découvertes en proposant une sorte de modèle montrant les caractéristiques centrales et peu variables du phénomène et les changements plus ou moins aléatoires venus des évènements ou d’autres caractéristiques. Ainsi quand Patricia Sexton (1965) parle des enseignants de Spanish Harlem, à New York, elle écrit : « Certains professeurs essaient et réussissent, d’autres essaient et échouent » (p. 53), et elle décrit ensuite divers cas d’enseignants. Le lecteur aurait sans doute gagné à trouver une analyse du phénomène présentant ce qui est central ou structurel dans la situation (car venant des caractéristiques les plus fondamentales) et ce qui explique les importantes variations d’un cas à l’autre.
Un autre point intéressant de la modélisation est qu’elle incite souvent les chercheurs à examiner des propriétés des relations entre les variables comme l’endogénéité, la colinéarité et les modes d’interactions. L’endogénéité renvoie à l’idée que les variations d’une variable explicative (au moins) sont influencées par le modèle lui-même et notamment pas la variable dépendante (celle que l’on étudie en établissant l’équation). Ainsi la discrimination peut tendre à produire certains parcours professionnels qui jouent à leur tour sur la discrimination. La colinéarité (qui n’a pas besoin d’être absolue) renvoie à l’idée que deux variables mesurent à peu près la même chose et qu’il ne faut donc pas (pour des raisons mathématiques) les inclure toutes deux dans le modèle. Les interactions entre variables renvoient au fait qu’à chaque niveau d’une variable peut correspondre des réponses différentes d’une autre (Ragin, Mayer, Drass, 1984). Ainsi les revenus d’une femme diplômée peuvent être supérieurs à ceux d’un homme diplômé alors que ceux d’une femme n’ayant que l’éducation primaire seront inférieurs à ceux d’un homme dans la même situation. La variable sexe et la variable scolarité ont donc des effets sur le revenu qui peuvent dépendre du niveau de scolarité choisi.
Il n’est pas évident de traduire ces précautions en idées pour l’enquêteur ethnographe, mais l’intuition peut être ici de prendre en compte les influences des éléments de la situation les uns sur les autres de façon plus systématique. J’en prendrai plusieurs exemples. Dans Plainville, James West (1945) signale que les jeunes gens pauvres de cette bourgade rurale ont tellement intériorisé leur infériorité sociale qu’ils sont prêts à accepter à peu près n’importe quel emploi stable. Certains, cependant réagissent à l’inverse et transforment le sentiment de rabaissement en volonté farouche de sortir de leur condition et de réussir leur vie professionnelle. Il est ici évident que la condition sociale de dominé a des effets différents sur la variable qui nous intéresse (disons l’ambition) en fonction d’au moins une autre variable que l’on aurait bien aimé connaître (peut-être le fait que l’un des parents au moins a été correctement scolarisé). Il est également possible que cette autre variable soit conditionnée à son tour par une autre (par exemple un vécu d’humiliation sociale marquée pour l’un des parents). Sur un sujet proche, un autre exemple peut illustrer les liens complexes entre facteurs (ou éléments d’une situation). Dans Tally’s Corner (1967), Eliot Liebow affirme que les hommes noirs du quartier pauvre qu’il a étudié refusent souvent les petits boulots qu’on leur signale car ils sont convaincus que de tels emplois ne les aideront guère face à l’ampleur de leurs problèmes personnels. Cela parce qu’ils en ont une expérience personnelle à laquelle s’ajoute celle de leurs proches. Liebow ne tient donc pas compte du fait que le refus des petits jobs entretient à la fois le manque d’argent chronique et le manque de contacts professionnels et d’expérience. Katherine Newman, à l’inverse, dans No shame in my game (2000) montre que les jeunes gens pauvres qu’elle a étudiés dans les années 2000 acceptent les « Mc jobs » et économisent afin de s’insérer dans le monde du travail. Le tableau complet des éléments à prendre en compte pour décrire le rapport au travail tel qu’il est évoqué à partir des observations ethnographiques n’est probablement pas complet dans le livre de Liebow (et peut être pas non plus chez Newman).
Les relations complexes entre les éléments peuvent enfin être illustrées par la situation d’une bourgade rurale brésilienne dans les années 1950 telle qu’elle a été étudiée par Marvin Harris (1956). L’auteur montre qu’il est trompeur de considérer que la pauvreté et le fait d’être noir sont des situations indépendantes. Il ne s’agit pas seulement selon lui du fait que les noirs sont plus souvent pauvres que les blancs en raison des conséquences accumulées de l’esclavage. Un autre facteur plus complexe s’ajoute : les autochtones tiennent compte de la richesse quand ils procèdent à des catégorisations raciales. Ainsi dans la localité, parler des noirs est une manière de désigner les pauvres ; un riche ne peut pas être « noir », et un individu très pauvre peut difficilement être « blanc ». Affirmer que les « noirs » sont maintenus dans la pauvreté parce qu’ils sont noirs obscurcirait donc la relation complexe entre les deux catégories.
La validité
Dans quelle mesure un modèle statistique rend-t-il correctement compte de la réalité ? Les quantitativistes ne poussent pas forcément tous très loin la réponse à la question, mais les usages veulent qu’ils se soucient au moins formellement de cette inquiétude. Ils peuvent le faire, par exemple, en soumettant les coefficients de régression obtenus dans leurs modèles à des tests de significativité et en donnant leur variance, en calculant le coefficient de détermination (le « R² ») des différentes versions du modèle, en examinant les résidus (la différence entre les données recueillies et celles prévues par le modèle), etc. L’idée est qu’il faut avoir une idée du degré d’écart avec la réalité ou du degré d’incertitude qu’entraîne l’utilisation du modèle.
Les sociologues qualitativistes peuvent-ils s’inspirer de ces précautions ? Une application évidente concerne les comptes-rendus d’enquêtes s’achevant par des propositions générales résumant l’essentiel d’un phénomène. On retrouve alors d’une certaine manière la distinction que font les quantitativistes entre la partie structurelle du modèle (donnée par l’équation) et les aléas (pris en compte sous la forme d’une variable aléatoire). Pour prendre un exemple classique, bien que non emprunté à une étude ethnographique, quand Tocqueville écrit qu’aux États-Unis l’adultère est peu répandu (en tout cas beaucoup moins qu’en France) car les mariages y sont plus libres (c'est-à-dire moins arrangés en fonction de considérations de castes sociales et de fortune et plus souvent fondés sur les sentiments), il construit une généralité de base qui est loin de couvrir toutes les situations observables. À n’en pas douter, l’adultère et les relations hors mariage existaient bien aux États-Unis dans les années 1830, et une recherche complète sur ce sujet s’inquiéterait du décalage entre le modèle théorique et la gamme des faits réels.
Si l’on s’intéresse à des situations de recherche plus communes, le problème de la validité peut être envisagé par les sociologues qualitativistes sous l’angle de l’étude des cas négatifs, comme l’a souvent recommandé Howard Becker (2014). Repérer les cas qui ne « collent » pas à la théorie proposée aide à affiner le modèle en donnant une idée des limites des conclusions à couvrir la diversité des cas réels. Le chercheur peut donc améliorer la validité de sa description des phénomènes en cherchant des cas négatifs, ce qui l’oblige à examiner plus de cas. On retrouve alors la question de l’échantillonnage évoquée plus haut. Si l’enquêteur se contente trop rapidement des cas qui sont facilement observables, il risque de passer à côté de certaines dimensions du phénomène. Par exemple Davis (et al. 1941) dans leur étude du Sud profond aux États-Unis discutent des cas de mobilité descendante chez les blancs. Mais ils manquent d’exemple et dégagent deux cas typiques : dégradation de la situation économique individuelle ou manquements à l’ethos ou aux habitudes imposées par les relations au sein du groupe. Chercher d’autres cas aurait pu donner une vision plus complète et intéressante du phénomène.
Il faut ajouter à ces remarques le fait que la focalisation sur un ou deux cas (par exemple un village ou une usine) courante dans les enquêtes qualitatives empêche également de donner des indications sur la solidité des résultats dans le cas ou l’on changerait d’échantillon. Non seulement d’autres facteurs (ou variables) pourraient apparaître (comme on l’a vu plus haut), mais les explications et la généralité des descriptions pourraient être remises en cause. L’ouvrage classique de Peter Woods (1979) sur la négociation de l’ordre scolaire dans les écoles britanniques est ainsi fondé sur l’étude d’une seule école. Il n’est pas certain que ses conclusions seraient exactement les mêmes s’il avait simplement étudié deux ou trois cas de plus. Dans toutes les situations, cependant, l’étude des cas négatifs est utile pour ceux cherchant à tester les possibilités de propositions théoriques lors d’une tentative de montée en généralité à partir d’enquêtes de terrain.
Théories
Les manuels de modélisation socioéconomique recommandent de mettre au point des conclusions qui soient falsifiables à partir d’enquêtes réplicables. L’intérêt de ces exigences est évident : éviter les comptes-rendus de recherche qui proposent des conclusions « tirées du chapeau », c'est-à-dire données sans que l’on sache exactement sur quelles bases matérielles et à partir de quels raisonnements elles ont été produites. Les enquêtes produites par les « qualitativistes » ne sont, pas plus que celles des quantitativistes, complètement à l’abri de ce type de critiques. Beaucoup d’articles publiés, par exemple, annoncent en introduction, sans précision, quelles méthodes ont été employées (par exemple : « des entretiens approfondis ») et produisent ensuite une série de propositions générales sur le phénomène étudié. Dans une telle configuration, le lecteur reste dans l’ignorance des mécanismes réels de production des analyses et il lui est difficile de dire de quelle manière les conclusions pourraient être falsifiables ou le dispositif réplicable (Siracusa, 2021). La production de théories par induction, pour être convaincante, doit cependant reposer sur la description sincère et complète des phases d’élaboration des conclusions à partir des données recueillies (Brochier, 2006). Dans le cas contraire, le recours à la méthode hypothético-déductive des quantitativistes peut être préférable puisqu’il conduit parfois à infirmer les hypothèses de départ, voire à déboucher sur des mystères[3]. Si les quantitativistes échouent souvent à faire la preuve que leurs données confirment bien la théorie qu’ils avancent (il leur arrive fréquemment d’écrire : « nos résultats suggèrent que… »), le problème est susceptible de concerner les deux écoles méthodologiques. Les théories que nous produisons doivent indiquer leur champ d’application et de validité probable en fonction des échantillons, des modes de constitution des données et des procédures utilisées pour les traiter. Le lecteur doit donc disposer des informations lui permettant de suivre ou de ne pas suivre l’auteur, et le cas échéant, de mettre en place un dispositif de recherche plus satisfaisant.
Conclusion
La thèse qui forme l’arrière-plan de ce texte est que les praticiens d’une discipline des sciences sociales, quelle qu’elle soit, ont tout à gagner à regarder quels problèmes de méthode préoccupent leurs voisins des autres disciplines. L’enfermement méthodologique correspond en général à une vision ritualiste de la pratique de la recherche du type : « Si j’ai utilisé les mêmes méthodes que mes collègues immédiats, alors j’ai accompli mon devoir. » Il fait oublier que notre obligation est de fournir les analyses les plus complètes de la réalité sociale et pas de suivre une tradition préfixée en matière de procédure. Si des gens intelligents et compétents dans leur domaine (qui n’est pas le nôtre) déploient beaucoup d’efforts pour corriger des insuffisances dans leurs travaux, il est probablement pertinent de s’intéresser à leurs démarches. Cela revient à se demander dans quelle mesure comprendre leur logique peut aider à améliorer nos propres recherches. En sociologie, la profondeur de la division interne entre qualitativistes et quantitativistes ne laisse pas d’être préoccupante. La multiplication de sous disciplines fonctionnant comme des chapelles de convertis en est une raison. Les sociologues ont tendance à penser que l’habitude pour chaque sous-groupe à raisonner selon des lignes méthodologiques très différentes, voire contradictoires, est plus ou moins inévitable. Je ne partage pas cette opinion, dans le sens où je prétends qu’il est possible à un sociologue au cours de sa carrière de s’intéresser à plusieurs méthodes comme à plusieurs thèmes. Praticien moi-même de l’ethnographie depuis plus de 25 ans, j’ai voulu dans cet article proposer quelques exemples de préoccupations méthodologiques chères aux sociologues quantativistes, et suggérer quelques idées d’application aux sociologues qualitativistes. Cela ne signifie pas que la sociologie de terrain ait des leçons à recevoir de la part des statisticiens, mais, plus modestement, que si les chercheurs habitués au langage de l’ethnographie, notamment en début de carrière, prennent la peine d’envisager les problèmes de méthode à partir des perspectives de sociologues travaillant différemment, ils peuvent parvenir à des réflexions susceptibles d’enrichir leurs pratiques. À eux, ensuite, de proposer éventuellement à leurs collègues de l’autre bord des suggestions propres à affiner les méthodes statisticiennes. En matière de méthodologie, le dialogue est toujours payant, mais il impose de s’intéresser durablement et sans parti pris aux points de vue de gens enquêtant à partir d’autres principes épistémologiques.
Notes de fin
[1] « Tu peux pas savoir ce que c’est que de vivre dans un quartier comme celui-ci. Tu rentres au cours préparatoire et tu as miss O’Rourke ; cours élémentaire première année : miss Casey ; deuxième année : miss Chalmers ; cours moyen première année : miss Mooney, et ainsi de suite » (Whyte, 1995 : 302).
[2] Pour des exemples et une analyse théorique voir : Duncan (1966).
[3] Pour un exemple d’enquête par modélisation statistique qui aboutit à un constat d’échec à véritablement expliquer le phénomène étudié (les écarts de revenus entre basketteurs noirs et blancs aux Etats-Unis) : Naito & Takagi (2017).
Bibliographie
Abbott Andrew (1998). « The causal devolution ». Sociological method and research, vol. 27 : 148-181.
Bastide Roger, Fernandes Florestan (1955). Relações raciais entre Negros e Brancos em São Paulo. São Paulo : ed. UNESCO/ANHEMBI.
Becker Howard S. (2014). What About Mozart? What About Murder? Reasoning From Cases. Chicago : University of Chicago Press.
Brochier Christophe (2006). « Algumas observações e propostas sobre a metodologia das pesquisas de sociologia empírica », Pro-Posições, vol. 17, n°1 : 243-268.
_______________ (2015). Comprendre et pratiquer la sociologie. Paris : Armand Colin.
_______________ (2021). « Comment étudier la discrimination « raciale » sur le marché du travail ? L’usage de la régression multiple aux États-Unis depuis les années 1960 ». Journal of Interdisciplinary History of Ideas, vol. 10, n° 19. [URL : https://www.ojs.unito.it/index.php/jihi/article/view/5578/5260]
Chapoulie Jean-Michel (2000). « Le travail de terrain, l'observation des actions et des interactions et la sociologie », Sociétés contemporaines, n° 40 : 5-27.
Corrigan Paul (1979). Schooling the smash street kids. London : Mac Millan.
Davis Allison, Gardner Burleigh, Gardner Mary (1941). Deep South. Chicago : University of Chicago Press.
Duncan Otis (1966). « Path Analysis: Sociological Examples », American Journal of Sociology , vol. 72, n° 1 : 1-16.
Galhaher Jr Art (1961). Plainville fifteen years later. New York : Columbia University Press.
Givord Pauline (2014). « Méthodes économétriques pour l’évaluation de politiques publiques », Économie & prévision, n° 204-205 : 1-28.
Harris Marvin (1964). Town and Country in Brazil. New York : Columbia University Press.
Liebow Eliot (2010 [1967]). Tally's Corner. Les Noirs du coin de la rue. Rennes : PUR.
Naito Hisahiro, Takagi Yu, 2017, « Is racial discrimination disappearing in the NBA? Evidence from data during 1985-2015 », International Review of Applied Economics, vol. 3 : 651-669.
Newman Katherine (2000). No shame in my game. The working poor in the inner city. New York : Vintage.
Ragin Charles, Mayer Susan, Drass Kriss (1984). « Assessing Discrimination: A Boolean Approach ». American Sociological Review, vol. 49, n°2 : 221-34.
Sexton Patricia Cayo (1965). Spanish Harlem. New York : Harper & Row.
Siracusa Jacques (2021). Les sujets du verbe. Une critique de l'écriture sociologique. Paris : Hermann.
West James (1945). Plainville USA. New York : University of Columbia Press.
Westley William (1970). Violence and the Police. A Sociological Study of Law, Custom, and Morality. Cambridge : M.I.T. Press.
Whyte William Foote (1995). Street corner society. Paris : La découverte.
Wildawsky Aaron (1964). Leadership in a small town. Totowa : Bedminster Press.
Woods Peter (1979). The divided school. London : Routledge.
Pour citer cet article :
Christophe Brochier, « Les possibles leçons de la sociologie quantitative à l’ethnographie », RITA [en ligne], n° 15, décembre 2022, mis en ligne le 02 avril 2023.



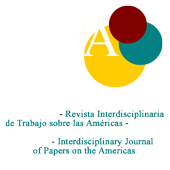
 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8