Le far-west urbain sans régulation : inégalités et ville globale. Entretien avec Jõao Sette Whitaker
O faroeste urbano sem regulação: desigualdades e cidade global. Entrevista com João Sette Whitaker
------------------------------
Nathalia Capellini
Université Paris Saclay - Université Versailles-St-Quentin-en-Yvelines
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
François Weigel
Université fédérale du Rio Grande do Norte (UFRN)
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Entretien avec Jõao Sette Whitaker
Le far-west urbain sans régulation : inégalités et ville globale
João Sette Whitaker Ferreira, professeur à l'Université de São Paulo, a été Secrétaire du Logement à la mairie de cette même ville, entre décembre 2015 et décembre 2016, sous le mandat de Fernando Haddad, candidat vaincu par Jair Messias Bolsonaro lors du second tour des dernières élections présidentielles brésiliennes. Docteur en architecture et urbanisme, détenteur d'un Master en Sciences politiques, João Sette Whitaker, universitaire reconnu pour ses travaux sur les inégalités urbaines, a été professeur invité à l'IHEAL (Paris III) lors de l'année universitaire 2011 / 2012.
C'est donc avec la plus grande curiosité intellectuelle que la revue RITA est allée à sa rencontre, chez lui à São Paulo, pour l'interroger sur la ville globale et ses changements, sur les politiques urbaines au Brésil - mais aussi, dans une moindre mesure, en France, pays qu'il connaît bien - ainsi que sur la situation économique, écologique et politique du Brésil. Cet entretien a été réalisé au début du mois de février 2020, juste avant que la pandémie du coronavirus ne vienne perturber l'ensemble de la planète.
* Pour s'adresser à un plus grand nombre de lecteurs, cet entretien, réalisé en février 2020 à São Paulo, a été publié par RITA en portugais et français.
* Para ampliar o número de leitores, esta entrevista realizada em fevereiro de 2020 em São Paulo, foi publicada pela RITA em português e francês (ver em baixo).

João Sette Whitaker / Crédits : photo concédée par l'auteur
RITA : Notre numéro est consacré aux grandes villes et aux changements globaux, écologiques en particulier. Vous avez écrit un livre, à partir de votre thèse, dont le titre interpelle : São Paulo, o mito da cidade global [São Paulo : le mythe de la ville globale][1] ? Loin d’inviter à un comparatisme uniformisant, la formule de ce titre tend à souligner les contradictions et réalités distinctes qui séparent plusieurs villes. São Paulo, 12 millions d’habitants, 22 millions pour toute l’agglomération, de par sa taille et de par la complexité de ses problèmes sociaux, est-elle un laboratoire des problématiques urbaines existant partout dans le monde ou bien se caractérise-t-elle par des problématiques absolument irréductibles et par des contrastes sociaux sans commune mesure avec ceux de métropoles de l’hémisphère nord ?
João Sette Whitaker : La critique que je fais dans ce livre est bien davantage tournée vers la catégorie théorique de la ville globale, construite par le discours urbanistique dans les années 1990, en particulier par Saskia Sassen[2] qui réactualise des concepts de Peter Hall. Celui-ci, pour la première fois, a utilisé la formulation de « ville globale » [The World Cities, 1966]. Or cette expression, « ville globale », se prête à tous les discours : on peut par exemple parler de « ville globale » selon la portée générale des travaux de Fernand Braudel sur l’économie-monde, c’est-à-dire en identifiant l’ouverture internationale d’une ville et sa prééminence économique au-delà des frontières régionales ou nationales. On peut même se référer à la Rome de l'Antiquité, ou à la Lisbonne de l’époque des navigations, comme étant des villes globales. Sassen, à la fin du siècle précédent, donne à ce terme une nouvelle dimension : en schématisant, une « ville globale » est capable de capter les énormes montants de capitaux financiers volatiles transitant de par le monde, et elle investit ces ressources pour se garantir une place centrale dans un archipel de villes internationales, à la fois en concurrence et interconnectées. La théorie de Sassen a fait florès et a inspiré nombre d’urbanistes, comme Jordi Borja et Manuel Castells qui se sont penchés sur le cas de Barcelone. Seulement, le grand problème de ces théories est que, récupérées par le discours néolibéral, elles ont établi une sorte de recette du succès dans le champ des politiques urbaines ; pour une bonne gestion, il conviendrait de se comporter comme une « wannabe world city » (« désireuse d’être ville mondiale »), selon la formule de John Short, pupille de Logan et de Molotch, auteurs de Urban Fortunes (1987).
Toutes les villes se sont ainsi portées candidates à la dimension globale. Ici, dans la région métropolitaine de São Paulo, la commune de Santo André, par exemple, à l’époque une ville du PT[3], du maire Celso Daniel, entendait montrer sa vocation globale par un axe urbain hyper-moderne attirant les capitaux privés. Des survols en hélicoptère avaient même été réalisés pour la mise en place du projet, avec la présence de Jordi Borja en personne. En fait, j’ai montré dans ma thèse que ce discours a été adopté par les villes dans les disputes politiques internes, pour justifier une canalisation d’investissements publics urbains, non pas avec la visée démocratique de diminuer les inégalités urbaines, mais afin d’acquérir le rang de ville globale, dans une logique perverse de l’urbanisme libéral, à savoir celle des synergies urbaines. D’abord, on fait croître et briller la ville ; puis, supposément, on redistribue les parts du gâteau, mais en fait cela n’arrive jamais. Mettre en place une politique d’assainissement des banlieues ne serait donc plus une urgence, il conviendrait plutôt de construire un centre d’affaires, avec fibre optique et tous les types d’investissements possibles, ce qui va générer une croissance et irait – selon ce discours – permettre ensuite d’obtenir des marges qui seront réinvesties dans les périphéries. C’est typiquement la logique néolibérale : les priorités sont inversées. Sassen ou encore Borja sont devenus des consultants voyageant de par le monde, et ce concept de « ville globale » n’a cessé de prendre de l’ampleur. Au point de devenir un crédo international, à partir d’exemple de villes européennes couronnées de « succès », telles que Bilbao ou Barcelone. La recette ? Elle est, pour les villes, dans le prolongement du consensus de Washington : on attire des fonds sur les bourses de valeur et avec des taux d’intérêts avantageux, on organise des méga-événements culturels, on transforme des quartiers riches en pôles d’attractivité pour les employés d’entreprises et de services de haute gamme, avec de bons aéroports, des avenues modernes qui connectent idéalement l’aéroport au centre d’affaires et aux quartiers résidentiels, le tout étant marqué par une concentration absolue des investissements dans certaines zones. Appliquée à São Paulo, ville où la concentration de revenus atteint des niveaux absurdes, cette recette ne fait qu’accentuer des déséquilibres déjà énormes. Cette « recette », aujourd’hui un peu épuisée en Amérique Latine, est cependant très actuelle, par exemple, en Afrique.
La ville globale – selon cette théorie – présuppose un certain nombre de caractéristiques, des éléments qui la placent dans cette catégorie : une bourse de valeurs d’importance ou le fait d’être le siège d’entreprises internationales, entre autres. Et j’ai constaté que, à l’époque, São Paulo, en dépit de son gigantisme, n’était le siège de pratiquement aucune entreprise d’envergure planétaire (bon nombre de sièges d’entreprises nationales se trouvaient à Rio de Janeiro), que les grands axes de services n’étaient pas si importants ou étaient en construction, et que les aéroports ne faisaient pas transiter des flux si importants. Nous étions alors en 2003, les choses ont depuis un peu changé, mais j’ai voulu démontrer que ce discours sur la ville globale a en réalité été employé pour justifier une canalisation presque exclusive d’investissements pour une portion infime de la ville, avec quelques grands axes tels que l’avenue Luiz Carlos Berrini. Sur quatre ans, l’équivalent d’un budget annuel de la ville tout entière a été investi dans la zone autour de cette avenue, pour le métro, l’amélioration des réseaux urbains, la fibre optique, des bâtiments à basse consommation, etc. Par conséquent, mon livre visait avant tout à dénoncer l’usage d’un discours politique et manipulateur sur la ville globale, à la faveur d’intérêts immobiliers et du marché privé, qui fructifie par le biais des politiques publiques urbaines. Toujours est-il que si São Paulo n’est pas une ville globale dans le sens idéologique qui s´est construit avec le néolibéralisme, on peut du moins dire que, en s’insérant dans un système-monde capitaliste, elle est globale dans le sens de Peter Hall ou celui de Braudel. Cela est manifeste depuis les années 1950, époque où São Paulo a surpassé Rio de Janeiro et est devenue la véritable capitale économique du Brésil, puis rapidement le poumon économique de l’Amérique latine. Globale, elle l’est également, bien sûr, par sa taille, son envergure géopolitique dans le continent latino-américain. Mais elle est globale avec ses propres caractéristiques, celles d’un pays en développement, étant bien différente de Tokyo, New York, Paris ou Londres, dont parlait Saskia Sassen. Ne négligeons pas ces hiérarchies : São Paulo, à l’égal de villes comme Le Caire, Johannesburg ou México, est une ville qui exprime toutes les vicissitudes et contradictions du capitalisme contemporain et inégal, une ville absolument emblématique de l’urbanisation dans la logique du « fordisme périphérique » pour reprendre les termes des régulationnistes français et en particulier d’Alain Lippietz[4]. Elle se démarque tout autant par le fait d’être le grand moteur économique de son pays ou même de son continent, que par une concentration de revenus sidérante et la permanence de niveaux de pauvreté extrêmes.
RITA : Même dans des villes que vous avez citées, Paris, New York ou Londres, la concentration de revenus et le déséquilibre social et spatial sont des phénomènes qui, au fil des ans, prennent de l’ampleur. Vous avez été, vous-même, dans l’arène politique, lorsque vous étiez Secrétaire à l’Habitation dans l’équipe municipale de Fernando Haddad. Alors quels types de politiques, sur le plan urbanistique notamment, faut-il mettre en place pour contrer ce problème croissant ?
J. S. Whitaker : Il est impossible de véritablement renverser cette situation en moins de cent ans, et en s’appuyant à peine sur des politiques publiques. Mais commençons d’abord par nous interroger sur ce fait que vous évoquez : l’approfondissement des inégalités, bien qu’à des échelles incomparablement moins importantes qu’au Brésil, dans des villes de pays développés. Quel est la grande problématique qui se trouve à la racine de toutes ces interrogations ? Quel est l’élément essentiel qui se trouve en filigrane de toutes les discussions autour du capitalisme contemporain ? La régulation par les pouvoirs publics, le rôle de l’État. Dans la dépression des années 1930, le capitalisme s’est effondré, et comme dans toutes les crises du capitalisme, ceci valant aussi pour la crise financière entamée en 2008, l’effondrement est venu d’une rupture dans le processus d’accumulation du capital, qui veut que l’argent soit investi sur la production, laquelle génère en retour des profits en argent, qui seront eux-mêmes réinvestis, et ainsi de suite. Le capitalisme a un besoin constant de consommation ; autrement dit, il dépend de ce que les marxistes appellent la forme-marchandise. Si la marchandise ne peut être transformée en profits qui peuvent être ensuite réinvestis dans la production, le cycle est brisé. En 1929, le capitalisme avait tellement tiré sur la corde, dans le sens d’une réduction des coûts de la main-d’œuvre, que la classe populaire n’a finalement plus eu les capacités de consommer ce que le système produisait. Pour remédier à cette crise, on a adopté la solution keynésienne : l’État est dans l’obligation d’investir dans l’économie, de soutenir la consommation et d’enrayer le conflit capital/travail, sans quoi le capitalisme s’effondre pour de bon. Le New Deal redynamise l’économie nord-américaine et ces politiques seront ensuite appliquées en Europe, dans l’après-guerre. Avec, d’ailleurs, de l’argent nord-américain, à travers le plan Marshall, car il fallait bien, pour les États-Unis, consolider ce système de consommation de masse et asseoir ainsi une position de suprématie dans l’industrie mondiale. Les marchés européens et asiatiques font l’objet de soins tout particuliers : la reconstruction de l’Europe occidentale est massivement financée et, au Japon, Douglas MacArthur assure même la gouvernance d’une occupation administrative pendant près de sept ans. Le modèle des États-Providence n’est autre que la construction de sociétés de consommation de masse, avec un certain nombre de conquêtes politiques et sociales, bien entendu. On aurait presque pu croire, durant quelques années, qu’il y avait une exacte correspondance entre la société dans son ensemble et la société de consommation, une idée que l’on retrouve dans le titre évocateur de la revue française de l’Institut national de la consommation – 50 millions de consommateurs, devenue plus tard 60 millions de consommateurs, suivant l’évolution démographique du pays.
Et dans ce modèle de l’État-Providence, la régulation est indispensable. Le capitalisme, comme le montre le livre récent de Thomas Piketty[5], a comme tendance intrinsèque de créer des inégalités et de générer davantage de gains par l’investissement sur le capital – les actifs financiers, mais aussi les héritages et la patrimonialisation du capital –, plutôt que par des investissements productifs. Durant les Trente Glorieuses, avec la construction de ces États du bien-être social, le monde capitaliste connaît « un intermède », selon l’optique de Thomas Piketty. Cela a impliqué, d’ailleurs, notamment au sein des intellectuels marxistes, toute une discussion autour du rôle de l’Etat en tant « qu’instrument » ou non du capital, mais cela mériterait tout un débat à part.
Depuis lors, sous l’influence néolibérale, les inégalités se creusent à nouveau, l’intermède est terminé. À partir de la crise de la fin des années 1970 et avec la financiarisation globale, les gains sur les revenus du capital sont de nouveau plus importants que par le biais de l’investissement productif. Le capitalisme redevient cette machine qui concentre très fortement les revenus. Quel était le différentiel de l’intermède ? La régulation ! Comme je l’ai cité, de nombreux penseurs marxistes l’ont avancé : l’État capitaliste, quand il s’agit de la régulation de la forme politique pour implanter un système économique efficace, peut affronter, au besoin, les propres forces privées du monde capitaliste. C’est notamment le cas lorsqu’il instaure un impôt sur les grandes fortunes. Or dans le champ de l’urbain, il y a également de la régulation, qui affecte les intérêts du marché immobilier, quand on interdit, par exemple, de construire des bâtiments de plus de huit étages. En affrontant des intérêts immédiats du grand capital, les pouvoirs publics régulent le far-west et, au final, construisent une base plus large pour le « capital général ». Mais le retour en force du libéralisme ouvre une époque de dérégulation, à partir notamment de Tatcher ou Reagan ou dans la France de Sarkozy mais même, à un degré moindre, de Mitterrand. Et la toute récente loi Élan (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) amplifie la dérégulation du marché immobilier en France, alors même que l’État français s’était longtemps signalé par une intervention forte en faveur du logement locatif social. Automatiquement, lorsqu’on lâche la bride de la régulation, les contrastes urbains apparaissent. Car il faut bien comprendre que les inégalités urbaines sont directement liées non à une question urbanistique, mais plutôt économique. Au Brésil, le déficit habitationnel est de l’ordre de six millions de logements. Mais la question essentielle n’est pas seulement de construire de nouveaux logements... C’est une question économique : si on donnait de meilleurs salaires aux populations les plus modestes, et si on avait un État régulant les plafonds des loyers, elles pourraient ainsi avoir accès à un logement locatif, réduisant considérablement, peut-être bien par moitié, ce déficit habitationnel, et l’on résoudrait le problème d’habitat de trois millions de logements, soit près de dix ou onze millions de personnes.
RITA : Dans le livre que vous avez organisé, vous suggériez d’ailleurs qu’au Brésil, ces dernières années, les constructions de bâtiments ont pullulé, dans une sorte d’euphorie immobilière, sans aucun critère de qualité urbaine ou de réduction des inégalités[6]. Vous affirmez qu’il s’agirait de « construire » des villes, plus équilibrées, au lieu de seulement « produire » des maisons ou des immeubles...
J. S. Whitaker : Exactement ! Ce qui importe, c’est une régulation de l’urbain, autrement dit une régulation qui produit des « localisations ». Les villes sont des « systèmes d’infrastructure » qui créent des localisations. Pourquoi São Paulo est inégale ? Parce que le Brésil n’a jamais eu un modèle économique où l’État régule une économie incluant toute la population et où il vise, du point de vue urbain, à offrir une infrastructure équitable sur les territoires, avec des quartiers plus ou moins. En réalité, ce modèle de la formation d’une société de consommation de masse et de l’expansion de la forme-marchandise n’a jamais été une nécessité ici, bien au contraire. Historiquement, le rôle des espaces périphériques du capitalisme international n’était pas de fournir des consommateurs, mais plutôt de fournir uniquement, de 1500 jusque vers la moitié du XXe siècle, des matières premières (avec une main-d’œuvre d’esclaves pendant près de quatre siècles) et puis, de 1950 jusqu’aux années 1990 et même encore aujourd’hui, une main-d’œuvre bon marché. On a fourni du bois-brésil, de la canne-à-sucre, du caoutchouc, du café, et caetera, et actuellement notre pays est toujours un grand fournisseur de marchandises et matières premières, une immense grange où prospère l’agrobusiness. La crise internationale des années 1930 a eu, ici aussi, de profonds effets, affectant la balance des échanges et réduisant par moitié le prix de certaines matières premières. Les producteurs des pays d’Amérique Latine, dont le Brésil, ont été contraints d’accepter cette réduction des prix, et l’ont repassée aux travailleurs en réduisant les payements. Il y eut, dans toute l’Amérique latine, une augmentation considérable de la misère ouvrière et agricole. D’où l’arrivée au pouvoir de « pères des pauvres » et de gouvernements populistes, tels ceux de Perón en Argentine, de Cardenas au Mexique, et de Vargas au Brésil. Ces gouvernants se sont affirmés grâce à des politiques nationalistes et industrialisantes, qui essayaient de suivre le modèle industriel européen, et avaient donc fait un effort de construction de biens de capital (au Brésil, Vargas créa la Petrobras, compagnie pétrolière nationale, et implanta les premières sidérurgies et des ports de grande capacité). Cependant, la contradiction de base entre l’industrialisation et la vocation d’exportateurs de matières premières, dans le contexte du capitalisme mondial « inégal et combiné », ainsi que la permanence d’une pauvreté massive, ne permettraient pas que ces modèles s’épanouissent.
L’État-providence mis en place dans les pays centraux du capitalisme eut aussi un effet sur la division internationale du travail et, donc, sur ces pays. Les régulations par l’État, l’instauration de salaires minimums et les cotisations salariales, ont fait augmenter le coût de la main-d’œuvre dans les pays développés, les industries ayant dû alors se tourner vers des pays moins développés pour trouver une main-d’œuvre bon marché, dans le contexte d’une expansion impérialiste. C’est ainsi que, à partir des années 1960, des pays comme le Mexique ou le Brésil, mais aussi l’Argentine dans une moindre mesure, qui avaient déjà quelques infrastructures grâce aux industries de base citées, vont s’industrialiser massivement et rapidement. Seulement, cette industrialisation galopante est conditionnée à la manutention de la pauvreté, car les industries recherchent une main-d’œuvre peu coûteuse. Et par conséquent l’urbanisation qui accompagne cette industrialisation n’a pas du tout été équilibrée, faute de bonnes conditions salariales. Certains auteurs l’ont ainsi appelée « l’industrialisation des bas-salaires ». D’un point de vue spatial, cela signifie que de grandes villes industrielles ont explosé à partir des années 60, marquées cependant par de très fortes inégalités. L’immigration massive de travailleurs venant du Nord du pays, très pauvres, provoqua l’expansion horizontale de quartiers délaissés par l’État, construits en toute hâte par les ravailleurs eux-mêmes et très précaires. L’urbaniste Erminia Maricato va alors faire l’association du phénomène économique et le territoire, en parlant d’une « urbanisation des bas-salaires ».
RITA : Et ce déséquilibre nous ramène là à la question de production de « localisations »...
J. S. Whitaker : Tout à fait. Ce que nous appelons les localisations sont différenciées et elles ont à la fois une valeur d’usage et une valeur d’échange. Cette valeur d’usage est protégée par les élites. Vous êtes ici chez moi, profitant de la valeur d’usage de ma maison. Elle est protégée et, en fait, tout le quartier est classé d’intérêt historique ; nous voyons ici comment l’État est un agent régulateur, qui protège les quartiers riches s’il le faut. Mais quand la valeur d’échange s’élève, autrement dit quand monte la pression du marché, il peut aussi déréguler, permettant la construction de grandes tours modernes. En Europe, la régulation est beaucoup plus stricte. Ici et dans d’autres pays moins développés, c’est la fameuse logique du far-west. Si cela vaut pour les quartiers riches, les plus pauvres, par contre, sont laissés à la dérive, sans aucune présence de l’État.
RITA : Et c’est ce qui est arrivé dans le quartier de Vila Madalena, où de récents projets immobiliers, gigantesques, pullulent un peu partout et défigurent les rues traditionnelles ?
J. S. Whitaker : Pas seulement dans la Vila Madalena, mais dans le Brésil tout entier, lorsque des quartiers de classes moyenne voient grimper leur valeur d’échange et la pression immobilière ! En fait, la logique urbaine suit la logique économique : je vais bientôt publier un livre dans lequel j’évoque une forme sociale – et donc aussi économique et urbaine – « patrimonialiste », qui est caractéristique du Brésil et d’autres pays à la périphérie du capitalisme. C’est la logique de la « croissance » brésilienne, où l’État n’a jamais eu besoin d’être régulateur, puisque notre marché de consommation n’a jamais été assez grand au point de devoir être contrôlé et réglementé pour constituer une société de consommation de masse. Pas besoin d’une « autonomie » de l’État pour permettre une base capitaliste homogène et ample, ici le capitalisme est au contraire réducteur, contrôlé par un petit groupe très fortuné tourné vers l’exportation, et une société de consommation très limitée qui lui est satellitaire. Ici, l’État travaille sous le contrôle des propriétaires – d’où mon emploi du terme patrimonialisme. Il gouverne pour eux et non pas pour l’ensemble de la société et pour améliorer la vie les travailleurs aux « bas salaires », dont la pauvreté était justement le gage de la croissance économique. Selon la publication “Multinationales et travailleurs au Brésil »[7], Volkswagen concentrait en 1974 les ¾ de sa production en Allemagne, et le dernier quart se divisait entre Brésil (avec près de 500.000 unités produites), le Mexique (85.000 unités) et l’Afrique du Sud (35.000 unités). La quasi-totalité des résultats obtenus dans ces pays étaient envoyés en Allemagne sous le compte de « payements de services d’assistance à la production et à la gestion ». Mon collègue Csaba Deák, chercheur à l’Université de São Paulo, parle de croissance entravée[8], du fait de l’expatriation des excédents de la production capitaliste au Brésil. Les gains ne restent pas au pays pour servir de levier à l’économie nationale. Ils sont retirés, drainés. Et l’État vient à la remorque de cette dynamique économique.
C´est exactement cette logique qui se reproduit au niveau de l’espace urbain. Au long de l’histoire, avec quelques exceptions de temps en temps, l’État ne régule et ne réglemente pratiquement rien, il ne fait que défendre les intérêts immobiliers dominants. Revenons à l’exemple de la Vila Madalena. Ce quartier de São Paulo a fait l’objet des convoitises du marché immobilier, qui a commencé à construire à tout-va et à détruire le quartier bohème historique, sans aucune régulation ou même, au contraire, avec des lois urbaines très favorables aux promoteurs. Je parlais d’exceptions, ce sont les périodes où des partis de gauche gagnent les gouvernements municipaux, ce qui commence à arriver avec une certaine fréquence depuis la redémocratisation et la constitution de 1988, qui redonna un certain pouvoir aux municipalités. Cela s´est passé à São Paulo à trois reprises, en 1989, en 2001 et en 2013, quand le Parti des Travailleurs gouverne la ville, et invariablement met en place des instruments de régulation et de contrôle urbains. La gestion de Fernando Haddad, entre 2013 et 2016, à laquelle j’ai pris part, implante un nouveau plan directeur établissant un zonage. Après d’âpres négociations avec le marché immobilier, elle est parvenue à instaurer un coefficient de construction équivalent à une fois la surface du lot (Coefficient 1) pour la ville tout entière. L’investisseur qui souhaitait construire au-dessus de cela –devait payer. Et dans le cœur de la Vila Madalena, comme dans une très large partie de la ville, la limite maximale fixée était le coefficient 2. Autrement dit, la logique était : si tu as un terrain de 300 m2, tu pourras construire au maximum 600 m2. Cependant, ces dernières années, le marché immobilier a pris ses aises. La corrélation des forces ne permet plus tout à fait de tels accords. Comment étions-nous donc parvenus à fixer cette règle ? Dans les axes structurants, c’est-à-dire les grandes avenues et surtout dans les 600 mètres autour des stations de métro (car le métro est un grand agglomérateur qui rend possible une démocratisation urbaine), la limite était un coefficient 4, toujours moyennant paiements. Cela veut dire que dans ces zones étaient rendues possibles les constructions de bâtiments plus élevés, pour densifier le transport public, avec aussi des couloirs pour les autobus. C’est ce qu’on retrouve dans l’avenue Heitor Penteado, l’avenue Nossa Senhora da Lapa ou encore dans la Cardeal Arcoverde, et donc autour du métro de Vila Madalena... Mais vous ne pouvez pas imaginer les hauts cris poussés par les élites qui habitent tout près de cette station, dans de grandes maisons très bien situées. On avait beau expliquer qu’on régulait et qu’on essayait de mettre fin au grand désordre de l’immobilier, les élites se plaignaient : « Ah, mais ma maison ne sera plus tranquille... » Pas de chance pour ceux qui habitent près du métro ou d’une grande avenue, mais il importait de protéger le quartier de la Vila Madalena et d’éviter une gentrification qui expulsait ses habitants. Qu’est-il advenu ensuite ? Il y a un moment où la force de la ville comme valeur d’échange finit par prendre le dessus sur la ville comme valeur d’usage. Les intérêts en jeu font triompher la conception de la ville comme valeur d’échange.
RITA : Et telle est la situation du quartier aujourd’hui...
J. S. Whitaker : Il y a conflit entre élites. Parce que la Vila Madalena n’est plus un quartier populaire, mais est devenu, en fait, un quartier élitisé, justement en conséquence de cette gentrification et des nouveaux immeubles haut-standing qui y ont été construits avant notre plan directeur. Donc on a un conflit entre, d’un côté, des élites qui tentent de maintenir une valeur d’usage (avec des petites maisons cossues, avantageusement situées) et puis, de l’autre, les intérêts de ceux qui veulent faire croître la valeur d’échange et veulent vendre à plus de gens, tous des classes aisées, le privilège de s’installer dans le quartier. L’idée, pour autant, n’est jamais de démocratiser. Personne ne dit : ok, notre projet est de détruire la Vila Madalena, qui est bien desservie par deux ou trois stations de métro à proximité, par des lignes de bus, non loin du centre ; et en faisant table rase des vieilles maisons, nous construirons de hauts bâtiments à six étages, en s’assurant que 50% de la population de ces nouveaux immeubles viendra des taudis situés en marge de la ville. Très franchement, si 50% des habitations étaient mises à disposition de gens gagnant entre un et trois salaires minimums, je serais prêt à signer pour un tel réaménagement urbain. Mais il est clair qu’un tel scénario n’arriverait jamais. Pourquoi ? Parce qu’au Brésil, avec sa logique de société élitiste et patrimonaliste, où ceux qui gouvernent sont ceux qui ont le patrimoine, il est impensable que l’État se donne vraiment les moyens d’une régulation urbaine, pour garantir que dans ces noyaux hyper valorisés soient aménagés des logements sociaux. C’est là où on voit toute la différence avec un pays comme la France où, bon gré mal gré, l’État met tout de même en place des mécanismes de mixité sociale. Ce qui arrive en France est que le marché, dans un contexte de dérégulation générale, influence chaque foi plus l’État dans son rôle d’intermédiation, de telle sorte que, là-aussi, les intérêts privés gagnent. Mais il faut quand même négocier et conduire l’État dans cette direction. En France, donc, la lutte est donc contre la libéralisation de l’agent étatique ; au Brésil, c’est tout bonnement le far-west, la mainmise directe du marché sur le territoire, et l’État n’est qu’un instrument sous son contrôle, sans aucun pouvoir de régulation, ou même promouvant une dérégulation qui le favorise.
Les villes brésiliennes s’inscrivent dans cette logique. São Paulo est-elle une ville aux inégalités criantes ? Oui, car elle a derrière elle des décennies de structuration sociale sans que l’État n’ait servi à rien d’autre qu’à protéger les intérêts d’une portion d’élite. Prenez une carte de São Paulo : vous verrez à l’œil nu que toute la concentration des investissements publics s’est faite, historiquement, dans l’axe dit sud-ouest. L’axe où se trouve toute la population à hauts revenus. À Rio de Janeiro il en va de même avec la Zone Sud, et c’est pareil pour Belo Horizonte, Curitiba, Recife... Dans toutes les villes brésiliennes, des investissements publics énormes font de certaines aires des quartiers équivalents au luxe du premier monde. La logique est clairement de protéger les 5-10% les plus riches. Ces 10% représentent certes une population importante : plus de 20 millions d’habitants, qui d’ailleurs se concentrent dans quelques villes. Au Brésil, si tu gagnes plus de 2500 reais par mois, tu fais déjà partie des 15% de la population mieux dotée financièrement. C’est quelque chose dont on n’a pas vraiment notion. Piketty a bien montré le degré insensé de concentration des revenus au Brésil, même si ici il n´est pas facile de le mesurer. En effet, sa méthode mesure les revenus déclarés, ce qui correspond à une bonne partie de la main d’œuvre active dans des pays régulés. Mais au Brésil, entre 45 et 50% de la population travaille dans l’informel, sans registre officiel des revenus. Alors, si l’on mesure les inégalités en regardant l’impôt sur le revenu, l’on va perdre presque 50% des travailleurs qui sont dans l’informel. Et même parmi ceux qui sont en règle, près de 30 % ne déclarent pas d’impôts sur le revenu, tout simplement parce qu’ils gagnent moins que le seuil minimum pour déclarer. La mesure de l’inégalité des revenus est donc très imprécise et, certainement, sous-estimée. En outre, comment mesurer la richesse en propriété de terres, qui n’est pas la même chose que la richesse des revenus ? Dans notre pays, il y a un groupe de plusieurs dizaines de députés, propriétaires terriens, qui, ensemble, possèdent l’équivalent, en surface, de trois Belgiques[9]. Il y a là une appropriation, par l’État ou des représentants de l’État, des intérêts de l’élite. Et l’on voit bien que l’idée d’un État indépendant est une chimère... Une grande partie des maires brésiliens possèdent des terres, ils sont même souvent, dans des villes de taille moyenne (qui au Brésil, ont quand même entre 100 et 500 mille habitants), propriétaires de lots bien situés, laissés vides pour de fructueuses spéculations. Comment les pouvoirs publics vont-ils agir contre les grands propriétaires terriens si le maire lui-même est d’une famille de grands propriétaires ? Toute la contradiction est là.
RITA : Dans ce numéro de RITA, nous souhaitions réfléchir sur la façon dont la crise écologique, sur différents plans, affecte les processus urbains. Les inondations récentes de Belo Horizonte ou São Paulo, par exemple, ne sont pas des phénomènes fortuits et nouveaux. Les questions urbanistiques sont clairement à relier avec ces événements ; l’atterrissement et la canalisation des cours d’eau est un phénomène ancien. La crise écologique, par ailleurs, met aussi au jour de nouvelles questions. En quoi l’augmentation de phénomènes climatiques externes et les bouleversements écologiques peuvent-ils modifier les politiques urbaines ? Est-ce que, là encore, ces processus exacerbent les problèmes de concentration des revenus ?
J. S. Whitaker : Je suis évidemment conscient de la gravité des changements climatiques et je ne doute pas que la terre est ronde[10] [rires]. Mais je suis plus sceptique sur le fait que ces changements aient augmenté significativement l’impact des pluies sur les populations les plus pauvres. Ce qui a augmenté, ça c’est sûr, c’est notre capacité à communiquer. De grandes inondations qui emportent des habitants, provoquant le chaos et la mort, font partie de l’histoire de São Paulo depuis la moitié du siècle précédent. Il y a des changements ? Je le concède, mais n’allons pas nier que les pluies n’étaient pas, par le passé, un problème. C’est une fois de plus la même question : l’urbanisation sans régulation de l’État est une urbanisation qui ne planifie pas, ne prévoit rien. Quelle est la logique environnementale de l’urbanisation brésilienne ? Il n’y en a pas : la priorité est de résoudre les préoccupations des élites. Et quelle était l’attente principale des élites au long des années 1950 ? Se déplacer en voiture. On a donc canalisé les cours d’eau pour faire des grandes voies routières. Un désastre, une folie ! Avec le développement économique, on est passé de 1,5 millions de voitures circulant dans la ville de São Paulo, dans les années 1970, à six millions aujourd’hui, et les voies expresses non seulement n’ont pas diminué, mais on continue à en construire. De plus, le manque de régulation, le « far-west », a fait que la ville s’imperméabilise complètement en raison des innombrables tours et de leurs parkings souterrains. Mais le plus grave problème environnemental est le fait qu’au fil du temps ont été expulsées de la ville formelle, bien fournie en infrastructures, une grande partie des populations les plus pauvres. Celles-ci, sans d’autres recours et sans politiques de logement social, se sont installées dans les zones de captage de la ville (mananciais), où aujourd’hui vivent plus d’un million de personnes.
Alors, comment résoudre cette question environnementale ? D’abord, demandons-nous quels sont les points centraux en termes d’écologie urbaine. Il s’agit du drainage, de l’assainissement, des déchets et de l’émission de gaz. Il y a, bien sûr, d’autres éléments, mais ceux-ci sont des enjeux essentiels, en particulier, du point de vue de la politique urbaine, les deux premiers. L’assainissement nécessite d’avoir des stations de traitement. Le Brésil a beau avoir la dixième économie mondiale, cela n’empêche qu’un nombre important de villes de plus d’un million d’habitants n’ont pas plus de 30% d’eaux usées collectées. À São Paulo même, la SABESP (Compagnie d’assainissement de l’État de São Paulo) déclare que 99,5% des eaux usées sont collectées, mais ce qu’elle ne dit pas, c’est qu’à peine 30% de ces eaux sont traitées. L’immense surplus d’eaux non traitées est jeté dans les rivières. Alors des types bien intentionnés vont venir pour nous vendre des smart cities, des immeubles avec la meilleure isolation thermique, parfaits pour l’environnement, etc. D’accord, mais leur égout continuera à aller dans les rivières ! Et retirer mille familles des taudis insalubres de la zone de captage serait plus important d’un point de vue environnemental que construire 500 bâtiments avec normes écologiques, label vert et tout le tintouin... Car il est là, le problème environnemental : 1,2 millions de personnes vivent dans des aires insalubres. Et la vérité est que la ville n’a jamais été conçue pour intégrer ces gens, qui a constitué la main-d’œuvre à bas salaire de notre industrialisation. Comme je l’ai expliqué, nous ne vivons pas dans une société de consommation qui a réellement besoin de ces gens-là. J’ai coutume de dire que nous n’avons pas, au Brésil, un État du bien-être social, mais un État du « laisser-faire social », c´est à dire, « laissez-les faire, les pauvres, il se débrouillent tout seuls ». La formule de la doctrine économique libérale, ici, indique plutôt l’abandon de la population. En conséquence, tous ces discours techniques sur la ville verte ne sont la plupart du temps que de la poudre aux yeux. Il faut assainir pour tout le monde, mais la corrélation des forces politiques empêche de le faire. On préfère construire un superbe pont « Estaiada Octávio Frias de Oliveira » plutôt que d’assainir, de collecter et de traiter l’ensemble des eaux. Alors les villes croissent économiquement, les banlieues pauvres s’étendent et envahissent des terrains de préservation écologique, dans des aires de captation d’eau, et le marché immobilier, sans régulation, imperméabilise chaque fois plus nos villes...
J’en reviens à la Vila Madalena, un quartier qui, justement, a été imperméabilisé. Quel est le problème de tous ces nouveaux immeubles qu’on y a construits ? En raison d’une loi relative au coefficient d’occupation, il est certes interdit de construire sur l’ensemble du terrain ; mais, pour compenser, le marché immobilier occupe le sous-sol, qui lui n´est pas règlementé, avec notamment des parkings et une imperméabilisation totale de ces aires souterraines. Une loi a donc dû être mise en place pour contraindre les groupes de construction à installer un petit réservoir de drainage dans chaque immeuble. Cela a, au moins, amélioré un peu les choses. Mais la situation demeure fort chaotique. Et on oublie souvent que, pour la question du drainage, les politiques portant sur la mobilité urbaine ont également un impact direct. Une ligne de métro rend moins nécessaire une imperméabilisation d’innombrables espaces routiers. Un tramway, comme dans de nombreuses villes européennes, permet même de laisser croître la pelouse. Faire du transport de masse peut permettre de réduire les voies sur les bords de cours d’eau et Paris l’a bien compris en réduisant les accès routiers le long de la Seine. En passant, il faut dire que Paris est un cas particulier : comme Santos non loin d’ici, Paris est presque entièrement imperméabilisé, avec l’une des solutions d’ingénierie les plus géniales qui soit, dans toute l’histoire urbaine mondiale. Le drainage fonctionne à Paris par un système très complexe de vases communicants en-dessous d’une grande structure générale.
Quoi qu’il en soit, la ville est un système d’infrastructures qui, d’une façon générale, ne peuvent être produites que par l’État parce qu’elles sont extrêmement coûteuses. Je peux construire seul ma maison, une villa cossue si j’ai les moyens ou une barraque en tôle si je suis pauvre. Mais je ne vais pas construire un métro, qui coûte 100 millions de dollars par kilomètre linéaire, ou un système d’adduction des eaux d’égout. Pour cela, l’intervention publique est nécessaire et, donc, en fonction de ce qu’il investit (ou non), l’État est le levier initial de la valorisation urbaine. Et c’est ici que se manifeste la perversité du capitalisme non régulé : l’infrastructure bâtie avec de l’argent public y génère une hausse de la valeur d’échange, qui est négociable et fait l’objet d’appropriations individuelles. Pour contrer cela, des instruments de régulation urbaine existent et en particulier l’impôt sur le foncier, qui est différencié selon les zones d’habitat dans pratiquement tous les pays du monde. L’État, d’une certaine façon, nous dit par ce biais : tu peux profiter de l’infrastructure urbaine, si tu as les moyens tu vas pouvoir habiter dans une zone privilégiée, mais il va donc te falloir payer un impôt plus élevé, correspondant à la qualité des infrastructures dont tu disposes. C’est une façon de recapturer des différences, pour réinvestir dans d’autres lieux et homogénéiser l’espace urbain. Or, au Brésil, tout ceci est insignifiant...
RITA : Pendant la dictature a été construit le célèbre Minhocão [qu’on pourrait traduire par « le grand ver de terre »], une artère surélevée qui barre la ville sur près de 4 km. L’avenir de ce grand axe routier est aujourd’hui l’objet de vifs débats et vous-même, à diverses reprises, avez exprimé une opinion très critique à l’encontre du projet de restructuration, qui établirait une sorte de ceinturon vert, dont vous estimez qu’il correspond à une forme d’hygiénisation de la ville. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette question?
J. S. Whitaker : Le Minhocão est un concentré de tous les problèmes que j’ai déjà évoqués. Le Minhocão, c’est l’œuvre des pouvoirs publics, de l’État patrimonialiste (en termes conceptuels, bien sûr, dans une dénomination qui englobe l’État-nation et les collectivités territoriales). En 1972, il s’agissait de servir les intérêts du secteur de l'automobile, à une époque où le cercle encore assez restreint de l’élite et des classes moyennes supérieures circulait sans trop de problèmes de trafic routier. Depuis quelques années, les choses ont changé à São Paulo, avec une vraie saturation des voies de circulation, mais, encore aujourd’hui, il est souvent plus pratique de prendre sa voiture que d’utiliser les transports en commun, qui sont encore très en-deçà de ce qu’ils devraient être dans une ville de cette taille. En d’autres termes, les choses ont changé non pas parce que les transports collectifs se sont sensiblement améliorés, mais plutôt parce que le trafic est de plus en plus insupportable ! En tout cas, Paulo Maluf, maire de l’époque, répondant à la pression de l’élite, de l’industrie automobile (locomotive de l’industrialisation « aux bas salaires ») et des grandes entreprises de construction qui faisaient la pluie et le beau temps au Brésil, lança la construction du Minhocão, qui lui rendait en plus un énorme capital éléctoral (son slogan était « Maluf, celui qui fait »). Celui-ci a très bien fonctionné, durant de longues années, jusqu’à ce que la croissance économique ait permis une plus grande démocratisation de la voiture... Pour le meilleur et pour le pire: la classe-moyenne moins aisée peut soudain prendre la voiture, mais du même coup on en arrive au fameux théorème de Paulo Guedes, Ministre de l’Économie du gouvernement Bolsonaro, qui se plaint parce que les femmes de ménage peuvent soudain passer leurs vacances à Miami. En somme, tout le monde utilise la voiture, le trafic s’engorge et le Minhocão commence à déranger les élites. Pourquoi ? Elles le voient comme une verrue urbaine, alors que le discours du « vert » gagne de la force. C’est donc l’élite – ou du moins la partie de l’élite plus connectée avec les tendances culturelles urbaines mondiales – qui se mobilise pour la destruction du Minhocão. Demandez donc aux populations les plus pauvres si elles pensent qu’il faut détruire le Minhocão ! Elles n’en ont que faire de ce débat. Le Minhocão est une horreur ? Certes, mais il y a beaucoup de gens qui l’utilisent et pour qui c’est une nécessité, tout simplement parce qu’ils n’ont pas d’autres choix et que les transports collectifs ne leur permettent pas de se rendre partout, dans un délai raisonnable. C’est donc une discussion, assez tendue d’ailleurs, dans l’entre-soi de l’élite. Il y a des secteurs de ces élites qui ont pris conscience de la nécessité d’une ville plus humaine, « une ville pour les personnes » : de beaux discours que prêche, par exemple, l’urbaniste Jan Gehl.
Sauf que la destruction du Minhocão serait très préjudiciable pour toute une partie de la population plus pauvre, et ce pour d’autres raisons. En raison des problèmes de respiration et des pollutions – olfactive, visuelle et sonore – la valeur de l'immobilier, en particulier dans les étages au bas des immeubles, a énormément baissé le long de cet axe routier. Certains de mes étudiants ont fait des recherches sur l’évolution du profil des habitants. Dans les immeubles longeant le Minhocão, se sont installés des gens à bas revenu, notamment des carrossiers ou encore des vendeurs de CDs d’occasion sur l’avenue Santa Ifigênia, profitant de loyers insignifiants. Il m’arrive parfois de dire, ironiquement, que Maluf a élaboré une politique sociale en le faisant construire, car il a ainsi permis, en raison de la dévalorisation causée par le Minhocão, que des gens pauvres réussissent à habiter le centre-ville. Pour les propriétaires, ce n’était bien sûr pas une bonne chose. Les années ont passé et puis les investisseurs, face au congestionnement du marché de l’immobilier, ont commencé à voir cette zone un peu « perdue » comme un « front » intéressant : avec la valorisation que pourrait apporter la destruction du Minhocão ou bien sa reconversion en un parc linéaire surélevé, il y aurait de quoi transformer à nouveau cette voie en un grand boulevard bordé d’arbres, comme il l’était auparavant. La pression du marché immobilier a donc commencé à se faire plus forte, se joignant à la pression de cette autre fraction de l’élite qui entend plutôt construire espace vert. Cette dernière, d’ailleurs, en dépit d’apparences merveilleuses – tout le monde veut du vert, sur le modèle de la coulée verte à Paris ou de la High Line Park à New York ! – est peut-être porteuse de la vision la plus individualiste et égoïste qui soit : l’idée est de pouvoir se balader le week-end et, au fond, peu importe ce qui se passe en-dessous du couloir surélevé, peu importe les gens habitant dans ce sous-sol urbain, sans lumière.
RITA : Et quel est le projet que vous-même défendez ?
J. S. Whitaker : Pour moi, il est très clair qu’à moyen terme et même à court terme, il n’y a pas d’autres solutions que d’en finir avec le Minhocão. Le modèle de l’automobile a du plomb dans l’aile, les problèmes respiratoires sont énormes, les conditions de vie intolérables. Mais ce que je dis, c’est que la régulation publique doit tout faire pour planifier le découpage de zones et garantir que la population actuellement résidente dans les appartements sous le Minhocão ou en face de celui-ci, ne soit pas tout bonnement expulsée de ces quartiers. Il n’y a rien de plus absurde et violent que d’expulser au loin un type qui aurait vécu 20 ans au même endroit, payant un bas loyer et respirant des gaz carboniques pendant tout ce temps-là, pour laisser les riches s’installer. Faut-il enlever le Minhocão ? Oui, mais alors faisons un plan contre la gentrification, déterminons des « ZEIS » (Zones spéciales d’intérêt social), désapproprions des terrains pour faire du logement social, créons des règles pour protéger les habitants de ces quartiers, mettons en place des taxes contre le rachat de vieux immeubles occupés par des locataires y vivant depuis plus d’une décennie. Ce n’est que par ces politiques de régulation que l’on garantira la construction d’un nouveau boulevard où apparaîtrait une réelle mixité sociale. Or ce que je préconise représente, pour le Brésil d’aujourd’hui, le plus forcené des discours cubano-soviético-vénézuéliens ! Et une telle politique ne sera donc jamais mise en place. Dans les faits, le Minhocão va être détruit, un nouveau boulevard sera construit, une série de logements à très haut revenus seront offerts avec de belles plaquettes où l’on pourra lire : « Venez habiter sur le boulevard São João, dans l’édifice Saint Jean du Beauregard (sic, en français dans le texte) » !
RITA : Le Minhocão serait donc un bon résumé de toute une logique de gestion de la ville. Mais nous voudrions maintenant vous emmener sur un autre terrain, plutôt en hors-champ par rapport à votre spécialité, à savoir l’urbanisme. Vous avez, il y a quelques années, pris position sur la question de l’art urbain, notamment quand le maire Dória avait souhaité effacer des installations et murs d’art urbain. Pourquoi l’art (pictural, mais aussi cinématographique ou littéraire) est-il si important pour le développement d’une ville et, d’une façon plus générale, pour une réflexion sur le devenir des grandes villes ?
J. S. Whitaker : L’art a un rôle significatif dans les dynamiques de production de l’espace, tout en offrant du sens sur les différentes façons dont s’opère celle-ci. L'art joue notamment ce rôle quand des groupes artistiques, qui se projettent à différents niveaux de démocratisation, se constituent en mouvements sociaux organiques. Or, outre l’argent et le capital, qui sont bien entendu des facteurs de transformation, les mouvements sociaux représentent réellement une force transformatrice de la ville. Et ils le sont, généralement, du point de vue social d’une ville plus juste et citoyenne. Un mouvement culturel est l’expression de sociabilités et est donc porteur de revendications ou du moins de discours, de positionnements. C’est en ce sens qu’il est force agissante sur la ville. Je pense par exemple à l’importance du rap en France, dans les représentations sur l’urbain et le politique, et je me rappelle par exemple de la chanson de Zebda, « Le bruit et l’odeur », contre les stigmates lancés par le milieu politique sur les populations des HLM. Ici pèsent sur la société urbaine des mouvements tels que le hip-hop, notamment à São Paulo mais aussi à Recife ou ailleurs, ainsi que la danse de rues, la samba et le pagode – les rodas de samba dans des quartiers souvent plus riches, le pagode dans des quartiers périphériques –, et je pourrais ajouter le candomblé et les religions afro-brésiliennes, ou même le mouvement culturel évangélique – pour le meilleur et pour le pire, car les évangéliques ont fortement influé sur le résultat des dernières élections. Ce sont des mouvements qui d’une façon ou d’une autre font essaimer un discours en lien avec des demandes sociales, en particulier dans le champ de l’urbain. Il me vient à l’esprit, par exemple, l’appropriation que des mouvements sociaux ont fait de la samba d’Adoniran Barbosa, compositeur de São Paulo : dans sa chanson « Saudosa maloca » est exprimée la nostalgie du temps vécu dans un vieux taudis, démoli pour l’édification d’un bâtiment imposant.
Mais, au-delà de cette question du discours ou du positionnement, les mouvements culturels se territorialisent, et c’est aussi pour cela qu’ils sont une force transformatrice. Lors de la gestion de Fernando Haddad, l’un des aspects les plus forts dans la structuration urbaine passait par la réappropriation de l’espace urbain comme espace de vie, avec la fermeture pour les voitures de grandes avenues, les week-ends, mais aussi avec tout un réseau culturel mis à contribution, notamment dans les banlieues. Il y avait là un véritable élan pour le hip-hop, le théâtre, le cinéma (avec le projet Cinesp qui offrait des séances gratuites au sein des CEUs [Centres éducationnels unifiés], dans les périphéries). L’art peut donc être utilisé comme un outil de politique publique urbaine à visée démocratique et culturelle. Et l’art a cette influence territoriale : autour de pôles culturels, se créent des liens de citoyenneté et de solidarité urbaine. Souvent on nous reproche, à nous les urbanistes, d’être autocentrés ou présomptueux, mais il est cependant bien vrai que « l’urbain est tout », c’est-à-dire que dans l’urbain tout peut se produire ou, pour le dire encore en d’autres mots, l’urbain est le support physique de la sociabilité. La politique urbaine est donc, dans des rapports d’interdépendance, une politique de transports, d’éducation, de santé, d’habitat, de culture... Cette dernière, de fait, est essentielle au sein de ce réseau interconnecté, et je crois que c’était vraiment perceptible sous la gestion de Fernando Haddad, y compris à travers des politiques qui n’étaient peut-être pas directement artistiques mais qui affectaient la culture. Par exemple, Transcidadania (« Trans-citoyenneté »), qui était un projet de réintégration sociale pour les transsexuels.
RITA : Cette question du respect des minorités va bien au-delà du seul cas de São Paulo. Justement, nous souhaiterions vous poser une dernière question pour passer de la ville à la situation générale du pays. On se souvient encore des images apocalyptiques du ciel de São Paulo, obscurci par les cendres des incendies venant du nord et du nord-ouest du pays. L’épisode nous renvoie directement à des problèmes macro qui dépassent la seule politique de la ville et alimentent des réflexions sur les agissements de l’agrobusiness, l’exploitation de la forêt par le capitalisme international et la négligence du gouvernement actuel. On a également en tête le problème de la gestion de l’eau, sous la gouvernance d’Alckmin, il y a quelques années, et l’on voit que de nouvelles dynamiques régionales ont un impact sur la vie à São Paulo, alors même que l’on pensait le sud-est du Brésil comme étant à l’abri de la question des sécheresses. Peut-on penser la ville d’aujourd’hui sans son rapport avec l’arrière-pays et avec tout l’écosystème d’un pays ? Comment contrer la politique de développement économique ultralibéral, écologiquement irréfléchie, du gouvernement Bolsonaro ?
J. S. Whitaker : L’exemple de la fumée, en ce jour qui est devenu nuit, est intéressant pour ce qui est de sa symbolique. Je crois que, pour le coup, Bolsonaro n’a pas eu de chance. Cela aurait pu arriver lors d’autres incendies, antérieurement. Cependant, le symbole pesait fort par rapport à ce que Bolsonaro autorisait ou même encourageait, en termes de destruction écologique. Et il est d’ailleurs possible qu’on ait eu, cette semaine-là, un nombre d’incendies absolument ahurissant, bien au-delà de ce qui a pu se faire par le passé, avec une action délibérée dans le sud du Pará ou le Mato Grosso, sous le couvert du président. Néanmoins, je crois qu’il faut prendre garde, dans la dynamique du discours anti-bolsonariste, à ne pas escamoter la perversité de la société brésilienne, qui est structurelle. Comme si en retirant Bolsonaro, tout se résolvait d’un coup de baguette magique… Alors qu’au fond Bolsonaro ne fait que porter à son extrême une sauvagerie sociale et institutionnelle qui a toujours existé au Brésil, pays aux si fortes inégalités. Ici, dans le passé, nous avons eu un maire comme Maluf, et aujourd’hui, après la parenthèse Haddad, c’est Dória qui a été élu maire et plus tard gouverneur de l’État de São Paulo. Or Maluf ou Dória sont exactement représentatifs de ces politiques qui négligent plus de la moitié de la population, prolongeant des tendances nationales qui, depuis plus de cinq cents ans, laissent vivre le peuple dans des conditions absolument indignes. Bolsonaro est-il une plaie pour le Brésil ? Certes, mais des agressions perpétrées contre des homosexuels, on a vu cela en plein gouvernement Lula, même si à l’époque les efforts pour l’augmentation de la tolérance sociale furent énormes... Quel est le grand drame que représente Bolsonaro ? En réalité, il officialise et rend transparent ce que le Brésil exécute en sourdine depuis des siècles. C’est terrible ? Oui, indubitablement, mais peut-être qu’au fond c’est aussi une bonne chose, vu d’un certain angle. Je crois que le gouvernement Bolsonaro est un désastre total, mais au moins, quelque part, il représente des tensions qui font affleurer des éléments mettant à nu et caractérisant, sans aucun voile, la nature intrinsèque de la société brésilienne.
Les questions d’égalité entre les genres, du machisme et du racisme structurels, d’homophobie, ... : tous ces aspects apparaissent aujourd’hui de façon plus visible parce que Bolsonaro met les choses sous tension et vient par exemple dire à un reporter de la chaîne Globo qu’il a un terrible visage d’homosexuel, croyant même bon d’ajouter : « Mais je ne vais pas pour autant t’accuser d’être un homo ! » Exposer tranquillement ce genre de propos, c’est expliciter ce que 50 millions de Brésiliens, qui ont voté pour lui, pensent plus ou moins implicitement. Il faut donc analyser prudemment les choses et comprendre que Bolsonaro est la pointe d’un iceberg, le reflet d’une tendance qui se révèle aujourd’hui de façon si impudente qu’on ne peut plus faire semblant de l’ignorer.
RITA : Mais en tant que professeur de l’Université de São Paulo, agissant dans les champs culturel et universitaire, vous ne croyez pas que les attaques systématiques et violentes contre le monde intellectuel constituent une nouveauté, sans précédent ?
J. S. Whitaker : Plus ou moins. En fait, l’actuel gouvernement brésilien, mais aussi le gouvernement de l’État de São Paulo, sont plus explicites. Et parce qu’ils sont plus explicites, la teneur et les effets de leurs discours prennent de l’ampleur. Plus besoin de prendre des pincettes, les attaques peuvent se faire au grand jour. L’impact le plus significatif du gouvernement actuel est subi par les universités fédérales, qui sont sous la coupe directe de Bolsonaro et du Ministère de l’Éducation. Le gouvernement revient directement sur des conquêtes réalisées au long d’une quinzaine d’années. Il y a 20 ans, les universités – et plus spécialement les universités publiques fédérales – ne représentaient qu’un tiers de ce qu’elles sont aujourd’hui. Les années Lula et Dilma Rousseff ont permis de dupliquer le nombre de campus d’universités fédérales. Mais Bolsonaro est arrivé et a frappé durement contre ce qui était devenu une tradition.
RITA : Il y aurait donc bien une nouveauté : l’attaque contre l’université fédérale ne connaît aucune limite.
J. S. Whitaker : Mais on a déjà connu cela. Fernando Henrique Cardoso, malgré ses années de carrière universitaire, a très peu fait pour les universités fédérales. Il avait amplifié le système des universités privées. Plus tard, avec Lula et notamment avec Haddad comme Ministre de l’Éducation, s’ouvre une période fantastique où, d’une part, l’accès aux universités privées est structuré et démocratisé, avec des bourses et financements, et où, d’autre part, les universités fédérales s’épanouissent et les salaires y sont revalorisés. Ce que les gouvernants actuels tentent de détruire au Brésil, ce sont les acquis du gouvernement Lula. Les gens refusent de dire cela clairement, parce qu’à gauche, ça sous-entend que tu approuves sur toute la ligne ce qu’a fait le gouvernement Lula. Prenons cependant un papier, un crayon et faisons une recension. Ce qui est en train d’être détruit, ce sont les choses obtenues à partir du XXIe siècle et de l’arrivée du PT au pouvoir. Un pouvoir qui a généré plein de choses positives, avec aussi des aspects négatifs. Mais il est certain que tout cela est détruit de façon inédite, avec une impudence et une grossièreté sans aucun frein ni bon sens. Car aujourd’hui les forces en présence ont fait en sorte que la société brésilienne a rompu avec la « cordialité », dont nous parlait le sociologue Sérgio Buarque de Holanda[11], un phénomène social où les relations de pouvoir et de domination sont minimisées et traitées de manière sournoise, dans une logique patriarcale et familiale. « Le Brésil est un pays multiracial qui n’a jamais eu de racisme », par exemple, est une affirmation si souvent entendue et qui montre comment les élites brésiliennes sont capables de cacher, sous un manteau de « cordialité » la dureté de sa structure sociale, dans un pays ou la quasi-totalité de la population riche est une population blanche. Il est là le grand changement, dans la fin de la cordialité et la mise à nu des tensions sociales telles qu’elles sont, plus que dans la logique structurelle de la société ou dans la façon d’agir du gouvernement. Ce qui arrive est donc terrible, je le sais bien, mais cela met à nu une société qui fonctionne ainsi depuis plus de 500 ans, malgré quelques avancées. Dans les 12 ans de gouvernement Lula et lors du premier mandat de Dilma Rousseff, la courbe était vraiment ascendante, de façon inédite. Je ne parle pas tellement de la croissance économique, mais plutôt d’une croissance avec redistribution. Des avancées ont eu lieu dans l’éducation, la protection des terres indigènes, le droit des minorités, etc.
Ce qui s’est accompli en ces années, et je crois que les tenants actuels du pouvoir ne le mesurent pas vraiment, c’est un changement générationnel majeur. Voilà, à mon sens, la plus grande transformation des années Lula, et cela me rend plutôt optimiste pour l’avenir, à moyen terme. Prenez mai 1968. Les étudiants des facultés françaises, en 1968, avaient pour la plupart une vingtaine d’années, ils étaient les enfants de l’après-guerre et avaient grandi durant les Trente Glorieuses, dans une société plus ouverte, avec de grandes conquêtes sociales et civiques, le mouvement féministe qui prenait de l’ampleur, etc. Surtout, l’éducation était le moteur de ces grandes avancées sociales, dans la mesure où toute cette génération bénéficiait d’une école universelle et avait plus facilement accès à l’université où, à Paris, les jeunes pouvaient écouter ou lire des intellectuels comme Althusser, Sartre, Simone de Beauvoir et bien d’autres. Ces jeunes ont alors promu une transformation sociale, qui était une transformation générationnelle. Au Brésil, le phénomène me semble similaire. Un jeune de 20-30 ans, aujourd’hui, est né après la Constitution de 1988 et a grandi dans les années Lula. Toute la scolarité et la formation de ce jeune s’est faite sous l’ère Lula, avec un apprentissage sur ce qu’est la sociabilité, le droit, une information ouverte, la nécessite de se positionner dans le monde, etc. Tout cela a un impact dont, je crois, pas même Lula n’a vraiment conscience. Et ceux qui dominent la politique brésilienne aujourd’hui sont de la vieille génération, avec certes une minorité des nouvelles générations qui s’est incrustée dans son sillage et qui est incarnée par les fils de Bolsonaro, mais qui ne représente nullement une transformation générationnelle décisive.
Aujourd’hui, les jeunes affirment : « nous voulons plus d’université, des droits égaux, moins de préjugés, une femme libre et insoumise, ... ». Cela représentera un fort pouvoir de transformation ; cela le représente déjà, à dire vrai, en mettant sous pression le gouvernement Bolsonaro. C’est bien, évidemment... mais cela n’est peut-être pas non plus sans poser problème, car ces questions générationnelles restent parfois trop éloignées des enjeux économiques. D’un côté, les préoccupations de cette génération exercent une pression absolument positive pour la défense de politiques publiques garantissant des droits civiques pour tous les groupes sociaux, quelque soit l’origine ehtnique ou le genre, mais aussi un meilleur accès à la culture, la défense des terres indigènes, etc. D’un autre côté, ce qui fait souvent défaut est une compréhension plus générale des enjeux économiques. Le ministre de l’Économie Paulo Guedes s’en donne à cœur joie et détruit allègrement les avancées économiques de l’époque Lula, à l’égal de la destruction appliquée dans le champ des universités ou sur les droits du travail. Et les discours d’opposition des jeunes n’incluent pas toujours ces questions. Toujours est-il que nous sommes, je crois, dans une phase de transition. Et cela n’est pas que national, on le voit de par le monde. Mais je suis peut-être trop optimiste et il est possible que l’on souffre encore longtemps avant que ne se fasse ressentir cette force de transformation.
RITA : Et puis, à l’opposé de ce mouvement générationnel que vous évoquez, les tendances conservatrices de certaines églises évangéliques peuvent constituer on contrepoids important...
J. S. Whitaker : Oui, c’est vrai, mais à mon sens ce contrepoids n’aura pas autant d’impact, car la caractéristique du mouvement des masses évangéliques est qu’il repose sur de la manipulation. Pour preuve, toutes ces populations qui mordent à l’hameçon des fausses informations et qui croient aux bobards qu’on leur raconte, comme par exemple quand on leur a dit que Fernando Haddad, pour inciter à la liberté sexuelle, était prêt à distribuer des biberons en forme de pénis dans toutes les écoles du pays. La génération dont je parle sait bien qu’il s’agit d’un tissu de mensonges. Le camp est donc nettement divisé, mais pour ma part je crois que le vent de cette génération soufflera plus fort, parce qu’il est culturel et qu’il a assimilé toute une transformation de valeurs, alors que, d’un autre côté, tout repose sur des pasteurs qui martèlent à longueur de prêches des récits tout faits, ne pouvant faire illusion qu’à court terme.
RITA : Merci pour ces mots de conclusion, cela fait toujours du bien d’entendre un point de vue optimiste !

Le Minhocão / Crédits : Photo libre de droits
------------------------------
O faroeste urbano sem regulação: desigualdades e cidade global. Entrevista com João Sette Whitaker
RITA: Esse número da Revista RITA é dedicado às grandes cidades e às mudanças globais (ecológicas em particular). Você escreveu um livro baseado em sua tese de doutorado, São Paulo, o mito da cidade global?[1], que se distancia de uma comparação padronizada e nos convida a enfatizar as contradições e realidades distintas que existem entre diferentes cidades. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, 22 milhões se contarmos toda a aglomeração urbana. Por seu tamanho e pela complexidade de seus problemas sociais, São Paulo seria um laboratório de problemas urbanos existentes no mundo todo ou seria caracterizada por problemas absolutamente irredutíveis e, em particular, por contrastes sociais que não podem ser comparados com os das metrópoles do hemisfério norte?
João Sette Whitaker: As críticas que faço neste livro se referem mais a categoria teórica da “cidade global”, construída pelo discurso do urbanismo na década de 1990, em particular por Saskia Sassen[2]. Sassen atualiza na verdade os conceitos de Peter Hall, que usou essa ideia pela primeira vez em 1966. No entanto, esse termo “cidade global” se presta a discursos muito variados: pode-se, por exemplo, falar de “cidade global”, na linha dos trabalhos do historiador Fernand Braudel sobre a economia-mundo que identifica a abertura internacional de uma cidade e sua preeminência econômica para além das fronteiras regionais ou nacionais. Assim, podemos utilizar esse termo para nos referir à Roma da Antiguidade ou à Lisboa na época das navegações como cidades globais. Na década de 1990, Sassen deu a esse termo uma nova roupagem: por meio do planejamento, uma "cidade global" é aquela capaz de capturar as enormes quantidades de capital financeiro volátil que transitam pelo mundo e de investir esses recursos para garantir a si mesma um lugar de destaque em um arquipélago de cidades internacionais e interconectadas. A teoria de Sassen floresceu e inspirou muitos planejadores urbanos, como Jordi Borja e Manuel Castells, que estudaram o caso de Barcelona. Só que o grande problema dessas teorias é que, recuperadas pelo discurso neoliberal, elas estabeleceram uma espécie de receita para o sucesso no campo das políticas urbanas. Para se ter uma boa administração, uma cidade deve se comportar como uma “wannabe world city” [uma cidade que deseje ser global], de acordo com a fórmula de John Short, aluno de Logan e Molotch, autores de Urban Fortunes[3]. Na época, todas as cidades queriam alcançar essa dimensão global.
Aqui, na região metropolitana de São Paulo, o município de Santo André por exemplo, na época uma cidade governada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o prefeito Celso Daniel, pretendia mostrar sua vocação global por meio de um eixo urbano hipermoderno, capaz de atrair o capital privado. Até sobrevoos de helicóptero foram realizados para a implementação do projeto, com a presença do próprio Jordi Borja. Como eu mostrei em minha tese, na realidade, esse discurso foi adotado pelas cidades de maneira endógena, no contexto de disputas políticas internas, para justificar uma canalização de investimentos públicos urbanos. Porém, esses investimentos não tinham um objetivo democrático de diminuir as desigualdades urbanas, mas visavam a obtenção dessa posição de cidade global, em uma lógica perversa do urbanismo liberal que é a das sinergias urbanas. Assim primeiro se faz crescer o bolo, para depois, supostamente, redistribuir, o que na verdade nunca é feito. Nessa lógica, a implantação de uma política de saneamento nas periferias não seria mais uma questão urgente, colocando-se à frente a necessidade de construir um centro de negócios, com fibra ótica e todos os tipos de investimentos possíveis, que gerariam segundo esse discurso crescimento e permitiriam obter lucros que seriam, em um momento posterior, reinvestidas nas periferias.
Essa é uma lógica tipicamente neoliberal: as prioridades são invertidas. E isso se tornou um credo internacional, baseado em exemplos de cidades europeias que tiveram “sucesso” com essa fórmula, como Bilbao ou Barcelona. Na época, Sassen e Borja se tornaram consultores internacionais viajando pelo mundo e vendendo essa receita da cidade global. Qual foi a receita? Tentar atrair fundos de bolsas de valores com taxas de juros atrativos, investir em grandes eventos culturais, transformar bairros ricos em polos de atratividade para funcionários de alto escalão das empresas do setor terciário, com bons aeroportos, boas avenidas com conexão, idealmente, entre esses aeroportos, os bairros de negócios e as áreas residenciais. É uma concentração absoluta e total de investimentos em determinados zonas.
O meu livro criticava essa receita “consenso de Washington” da cidade global, uma receita neoliberal para todas as cidades adotarem e que era concentradora de rendas, tudo que São Paulo não precisava. Aplicada em São Paulo, cidade em que a concentração de renda já alcança níveis enormes, esta receita acentuaria ainda mais os desequilíbrios. Hoje, essa “receita” já um pouco desgasta na América Latina é bem atual na África, por exemplo. A cidade global na teoria apresentada acima pressupõe um certo número de características ou elementos que colocam uma grande aglomeração na categoria cidades globais: uma importante bolsa de valores ou sedes de empresas internacionais, entre outras. E na época que escrevi, em 2003, notei que São Paulo, apesar de seu tamanho gigantesco, não era sede de praticamente nenhuma empresa em escala planetária (um bom número de sedes de empresas nacionais ficava no Rio de Janeiro), que os principais eixos terciários não eram tão importantes ou estavam em construção (como a avenida Berrini) e possuíam altos níveis de vacâncias, e que, por seus aeroportos, não transitavam fluxos de negócios tão importantes.
As coisas mudaram um pouco desde então, mas o que eu quis demonstrar é que esse discurso da cidade global era usado para justificar uma canalização quase exclusiva de investimentos para uma pequena parte da cidade, naquela época, a região da avenida Luiz Carlos Berrini. Ao longo de quatro anos, o equivalente a um orçamento inteiro anual da cidade foi investido na área ao redor daquela avenida, para construir o metrô, melhorando as redes urbanas, instalando fibra ótica para a instalação de prédios inteligentes etc.... Tudo isso, no entanto, não significa que São Paulo não seja uma cidade global. Porém, ela não é uma cidade global no sentido ideológico que se estabeleceu com o neoliberalismo, mas no sentido de Peter Hall ou de Braudel, uma cidade global que se encaixa em um sistema capitalista. Isso é evidente desde a década de 1950, quando São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou a capital econômica do Brasil e se tornou também rapidamente o pulmão econômico da América Latina. Cidade global também é pelo seu tamanho e seu escopo geopolítico no continente latino-americano. Mas é global com suas próprias características de um país em desenvolvimento, sendo muito diferente de Tóquio, Nova York, Paris ou Londres, das quais Saskia Sassen falou. São Paulo, da mesma maneira que cidades como o Cairo, Joanesburgo ou Cidade do México, é uma cidade que expressa todas as vicissitudes e contradições do capitalismo contemporâneo, que é desigual e combinado, uma cidade emblemática da urbanização em uma lógica de “fordismo periférico”, para usar o conceito dos regulacionistas franceses, sobretudo de Alain Lippietz[4]. Distingue-se, assim, tanto por ser o grande polo econômico de seu país ou mesmo de seu continente quanto por uma impressionante concentração de renda e uma permanência de níveis extremos de pobreza. Então o meu livro visava a denunciar o uso de um discurso político e manipulador de um conceito de cidade global para justificar as disputas internas do mercado imobiliário, em torno da captação de investimentos públicos, para os seus interesses privados.
RITA: Mesmo nas cidades que você mencionou, Paris, Nova York ou Londres, a concentração de renda e o contraste social e espacial são fenômenos que cresceram, ao longo dos anos. Você atuou na política quando era Secretário de Habitação da gestão municipal de Fernando Haddad em São Paulo. Para você, que tipos de políticas públicas, especialmente no nível urbano, devem ser implementadas para reverter essa situação que se amplia?
J. S. Whitaker: É impossível reverter de fato essa situação em menos de cem anos, e dificilmente contando apenas com políticas públicas. Mas vamos começar pensando no que vocês falaram: o aprofundamento das desigualdades nas cidades dos países desenvolvidos, mesmo que em níveis incomparavelmente menores do que no Brasil. Qual é o principal elemento que está na raiz desse fenômeno? Qual é a questão essencial que atravessa todas as discussões em torno do capitalismo contemporâneo? A regulamentação pelas autoridades públicas, o papel do Estado. Após a depressão da década de 1930, o capitalismo entrou em colapso. Como em todas as crises do capitalismo, como apontou Marx - inclusive durante a crise financeira iniciada em 2008 -, o colapso veio de uma ruptura no processo de acumulação de capital, onde dinheiro vira mercadoria que vira dinheiro com lucro. O capitalismo tem uma necessidade constante de consumo, o que os marxistas chamam de “forma-mercadoria”. Se a mercadoria não puder ser transformada em lucros que possam ser reinvestidos na produção, o ciclo de reprodução do capital é interrompido, e você tem a quebra do capitalismo. Em 1929, o que aconteceu foi uma crise de subconsumo: o capitalismo havia esticado tanto a corda na direção de reduzir os custos da mão-de-obra, que a classe trabalhadora não tinha mais a capacidade de consumir o que o sistema produzia. Para remediar esta crise, foi adotada a solução keynesiana. O Estado foi obrigado a investir na economia, para mediar o conflito capital/trabalho e criar condições para um consumo de massa, com vistas a impedir a quebra total do capitalismo. Todo o esforço do New Deal revitaliza a economia estadunidense, e essas políticas serão aplicadas na Europa no período do pós-guerra com o dinheiro dos Estados Unidos por meio do Plano Marshall. Ou seja, os Estados Unidos tentavam construir um mercado de consumo para consolidar a sua posição de liderança industrial mundial, chegando ao ponto de financiar a reconstrução da Europa Ocidental. Os mercados europeu e também asiático são objetos de cuidados muito particulares. No Japão, Douglas MacArthur garante a governança de uma ocupação administrativa por quase sete anos. Então o modelo do Estado de bem-estar social é um eufemismo para a construção de sociedades de consumo em massa, com algumas conquistas políticas e sociais. Durante um período, havia quase uma correspondência entre o que é o conjunto da sociedade e o que é a sociedade de consumo (é claro que com as perversidades do capitalismo). Encontramos essa ideia, por exemplo, no título evocativo da revista francesa do Instituto Nacional Consumo: “50 milhões de consumidores”, que, mais tarde, se tornou 60 milhões de consumidores, seguindo a evolução demográfica do país. E neste modelo do estado de bem-estar social, a regulamentação é essencial.
O capitalismo, como mostra o livro recente de Thomas Piketty[5], tem uma tendência intrínseca de criar desigualdades e gerar mais ganhos com o investimento em capital - ativos financeiros, ou o aspecto patrimonialista do capital, como as heranças - do que com investimentos produtivos. Durante os Trinta Anos Gloriosos, com a construção desse estado de bem-estar keynesiano na Europa, o mundo capitalista experimentou o que Piketty chamou de "interlúdio". Esse fenômeno gerou, principalmente entre os intelectuais marxistas, toda uma discussão em torno do papel do Estado como um "instrumento" ou não do capital, mas isso mereceria um debate à parte.
Desde então, sob influência do neoliberalismo as desigualdades aumentaram novamente e o interlúdio acabou. Desde a crise do final da década de 1980 e com a financeirização global, os ganhos da renda do capital são novamente maiores do que o investimento produtivo. O capitalismo se torna novamente essa máquina que concentra a renda e as vicissitudes do capitalismo começam a reaparecer também em seu centro. Qual foi o diferencial do "interlúdio" nos países europeus, nos Estados Unidos e outros países como Canadá, Japão e Nova Zelândia? A regulação! Como eu citei, muitos pensadores marxistas têm argumentado, que o Estado capitalista, quando se trata de regular a forma política para implantar um sistema econômico eficaz, pode confrontar, se necessário, as próprias forças dos grandes capitais privados. Este é o caso quando se introduz um imposto sobre grandes fortunas. No campo urbano, há também regulamentação que afeta os interesses do mercado imobiliário, quando o Estado proíbe, por exemplo, a construção de edifícios com mais de oito andares. Ao enfrentar os interesses imediatos do grande capital, as autoridades públicas regulam o faroeste, mas também contribuem com a construção de uma base mais ampla para o “capital geral”. Mas o ressurgimento do neoliberalismo abre uma era de desregulamentação, começando com a Tatcher ou o Reagan, na França, por Sarkozy, mas até mesmo Mitterrand. E a lei recente francesa Elan [Lei evolução da habitação, do desenvolvimento e do digital, que regula o financiamento público nesse setor] amplia a desregulamentação do mercado imobiliário na França, mesmo que o Estado francês mantenha uma forte atuação em favor da habitação social de aluguel. Automaticamente, quando você começa a desregular, as discrepâncias urbanísticas vão aparecendo. Porque é preciso entender que as desigualdades urbanas estão diretamente ligadas não a uma questão urbana, mas a uma questão econômica. No Brasil, o déficit habitacional é de cerca de seis milhões de moradias, mas a questão essencial não é só construir novas moradias. É também uma questão de política econômica, se déssemos melhores salários às populações mais pobres, e se o Estado regulasse o teto dos aluguéis, essa população poderia ter acesso a uma moradia de aluguel. Assim reduziríamos consideravelmente, quem sabe pela metade, o déficit habitacional, resolvendo assim a falta de três milhões de habitações, ou seja, afetando quase dez ou onze milhões de pessoas.
RITA: No livro que você organizou, você sugeriu que no Brasil, nos últimos anos, a construção de edifícios se multiplicou em uma espécie de euforia imobiliária, sem nenhum critério de qualidade urbana ou de redução de desigualdades. Você diz que se trata de “construir” cidades mais equilibradas, e não somente “produzir” casas ou edifícios...
J. S. Whitaker: Exatamente! O que importa é uma regulamentação do urbano, ou seja, uma regulamentação que produz "localizações". As cidades são "sistemas de infraestrutura" que criam localizações. Por que São Paulo é desigual? Porque o Brasil nunca teve um modelo econômico onde o Estado regula a economia para incluir toda a população, do ponto de vista urbano, oferecendo infraestruturas de maneira mais ou menos homogênea e equitativa através do território e dos diferentes bairros. Na realidade, esse modelo de formação de uma sociedade de consumo de massa e da expansão da forma mercadoria nunca foi uma necessidade aqui, muito pelo contrário. Historicamente, o papel dos países periféricos no capitalismo mundial desigual e combinado não era de fornecer consumidores, mas apenas fornecer matérias-primas, principalmente a partir de 1500 até meados do século XX. E de 1950 até hoje em dia, o papel é de fornecer mão-de-obra barata e, depois de 1990 até hoje, começou também a ser de fornecer consumidores. Então de 1500 até os anos 1950, o papel do Brasil era produzir pau-brasil, cana-de-açúcar, borracha, café etc., com mão de obra escrava, sem a menor necessidade de construir uma sociedade homogênea, como matéria-prima para a indústria nascente da Europa. Atualmente, nosso país ainda é um grande fornecedor de commodities, um enorme celeiro onde o agronegócio prospera. A crise internacional da década de 1930 teve efeitos profundos aqui também, porque ela exacerbou o desequilíbrio da balança comercial reduzindo pela metade o preço de certas matérias-primas. Os produtores da América Latina, como o Brasil foram forçados a aceitar essa redução de preços, e repassaram essa redução para os trabalhadores reduzindo os salários. Houve por toda a parte, na América Latina, um aumento considerável da miséria das populações operárias e camponesas. E, por isso, surgiram tantos governos populistas, com “pai dos pobres” como Perón na Argentina, Vargas no Brasil ou Cardenás no México. Esses governantes se afirmaram graças à políticas nacionalistas e de industrialização, que tentavam seguir o modelo industrial europeu e, portanto, que se esforçaram para construir bens de capital (no Brasil, Vargas criou a Petrobrás, a Companhia Nacional de Petróleo e implantou as primeiras siderúrgicas e portos de grande capacidade). No entanto, a contradição básica entre industrialização e vocação de exportadores de mercadorias, no contexto do capitalismo global “desigual e combinado” com uma persistência da pobreza maciça, não permitiu que esses modelos prosperassem.
O estado de bem-estar social estabelecido nos países centrais do capitalismo também teve um efeito na divisão internacional do trabalho e, consequentemente, nesses países da América Latina. A regulamentação estatal, a introdução de salários mínimos e o número de horas máximo de trabalho aumentaram o custo da mão-de-obra nos países desenvolvidos, diminuindo os lucros, e as indústrias recorreram aos países menos desenvolvidos para encontrar mão de obra barata. Esse fenômeno se desenvolve no contexto de uma expansão imperialista. Assim, a partir dos anos 1960, países como o México ou o Brasil, mas também a Argentina, em menor grau, que já possuíam algumas infraestruturas, graças ao desenvolvimento de indústrias de base já citadas, se industrializaram maciça e rapidamente. No entanto, essa industrialização desenfreada é condicionada à manutenção da pobreza, porque a condição dessa industrialização é a mão-de-obra barata. É exatamente o caso da China hoje. E, consequentemente, a urbanização que acompanha essa industrialização não foi equilibrada, por falta de boas condições salariais para sustentar a construção dessa cidade. Alguns autores chamam isso de "industrialização de baixos salários". Do ponto de vista espacial, isso significa que grandes cidades industriais explodiram a partir da década de 1960, marcadas, no entanto, por desigualdades muito grandes. A imigração maciça de trabalhadores do norte muito pobre do país, levou à expansão horizontal de bairros abandonados pelo Estado, autoconstruídos e muito precários. A planejadora urbana Erminia Maricato fará então a associação do fenômeno econômico e do território, falando de uma "urbanização dos mal pagos".
RITA: E esse desequilíbrio nos leva de volta à questão da produção de "localizações" ...
J. S. Whitaker: Tout à fait. A cidade é um sistema de infraestruturas que cria localizações. E essas localizações são diferenciadas, têm valor de uso e valor de troca. Esse valor de uso é protegido pelas elites. Aqui, na minha casa, vocês estão usufruindo do valor de uso da minha casa. Ela é protegida, esse bairro aqui é tombado; em um exemplo do Estado agindo enquanto agente regulador que protege os bairros ricos se necessário. Mas quando o valor de troca - a pressão do mercado - se torna forte, a regulação estatal pode também destombar, permitindo, assim, que se construam prédios modernos. Na Europa a regulação estatal urbana é muito mais rígida. Aqui, a lógica dos países subdesenvolvidos é a do faroeste. Embora isso se aplique aos bairros ricos, os mais pobres, por outro lado, ficam à deriva, sem a presença do Estado.
RITA: É o que está acontecendo na Vila Madalena, em São Paulo, né?
J. S. Whitaker: Não só na Vila Madalena, mas também no Brasil inteiro onde bairros de classe média vivem a explosão de seu valor de troca e da pressão imobiliária! Na verdade, a lógica urbana segue a lógica econômica: eu vou lançar um livro até o meio do ano onde falo sobre a produção patrimonialista do espaço, a quem chamo de uma forma social-patrimonialista, que é também econômica e urbana, que é característica do Brasil e de alguns outros países subdesenvolvidos. A nossa lógica é a lógica permanente do faroeste, em que o Estado nunca precisou ser um Estado regulador, porque nós nunca tivemos mercado de consumo suficiente para ser regulado e regulamentado para constituir uma sociedade de consumo de massas. Não houve necessidade de uma "autonomia" do Estado para permitir o estabelecimento de uma base capitalista ampla e homogênea, pelo contrário. Aqui o capitalismo é redutor: controlado por um pequeno grupo muito rico voltado para a exportação, e por uma sociedade de consumo muito limitada que orbita ao redor desse primeiro grupo. Aqui, o Estado trabalha sob o controle dos proprietários - daí o significado do termo patrimonialismo – e governa para eles e não para toda a sociedade, não para melhorar a vida dos trabalhadores de “baixos salários”. Nessa lógica patrimonialista, a pobreza desses trabalhadores era precisamente a promessa de crescimento econômico. Segundo a publicação "Multinacionais e trabalhadores no Brasil", a Volkswagen por exemplo, concentrou naquele mesmo ano 3/4 de sua produção na Alemanha, e o último quarto era dividido entre o Brasil (com quase 500.000 unidades produzidas), o México (85.000 unidades) e a África do Sul (35.000 unidades) [6]. Quase todos os lucros obtidos nesses países eram enviados para a Alemanha como "pagamentos por serviços de apoio à produção e gestão". O meu colega da USP Csaba Deák chama esse processo de crescimento entravado por causa da expatriação dos excedentes da produção capitalista no Brasil. Esse lucro não fica no país para alavancar a economia nacional[7]. Ele é retirado, drenado. Então, a lógica urbana brasileira é a de um Estado que vem a reboque dessa dinâmica econômica e que é subordinado à dinâmica econômica. Ele não é regulador, ele vem correndo atrás, dizendo: Espera, espera.
É exatamente essa lógica que é reproduzida no nível do espaço urbano. Ao longo da história, com algumas exceções de tempos em tempos, o estado não regula praticamente nada, apenas defende os interesses imobiliários dominantes. Voltando ao exemplo da Vila Madalena. Esse bairro de São Paulo foi objeto de interesse do mercado imobiliário e o mercado imobiliário começou a construir de qualquer jeito, destruindo o histórico bairro boêmio, sem regulamentação, pelo contrário, com leis urbanas muito favoráveis aos empreendedores. Eu falei antes de exceções, essas correspondem aos períodos em que os partidos de esquerda venceram eleições municipais, o que começou a acontecer com certa frequência desde a redemocratização e a constituição de 1988, restaurando assim um certo poder aos municípios. Isso aconteceu em São Paulo três vezes, em 1989, em 2001 e em 2013, quando o Partido dos Trabalhadores governou a cidade e invariavelmente pôs em prática instrumentos de regulação e controle urbanos. A gestão de Fernando Haddad, entre 2013 e 2016, da qual participei, implementa um novo plano diretor, estabelecendo um zoneamento. Depois de muita negociação com o mercado imobiliário, essa gestão conseguiu implementar um coeficiente de construção equivalente a uma vez a área do lote (coeficiente 1) na cidade inteira. Tudo que se construir acima do coeficiente 1 tem que ser pago. E no miolo da Vila Madalena e em quase em toda cidade, o limite deveria ser o coeficiente 2. Ou seja, se eu tiver um terreno de 300m2 eu posso construir 600m2. O problema é que o mercado imobiliário não deixa. Na correlação de força, você não consegue implementar isso. Para conseguir, o que se negociou? Que nos eixos estruturantes, ou seja, nas grandes avenidas e sobretudo nos 600m no entorno da estação de metrô - porque, na verdade, o metrô é um grande aglomerador e um grande capacitador de democratização urbana -, você permite um coeficiente 4 (pagando também). Isso quer dizer que você permite subir prédios para poder adensar ao lado do transporte público, com corredores comerciais onde tem corredor de ônibus. Então, ali você vai ter a Heitor Penteado, a Pedroso de Morais (que não liberou, mas que poderia), a Nossa Senhora da Lapa, lá em cima, a Cardeal Arco Verde... O resultado é que, nos 600m ao entorno da estação de metrô Vila Madalena, você ia permitir construir. A gritaria das elites, que já moram lá na Vila Madalena em grandes casas bem situadas, foi gigantesca, e a resposta da prefeitura foi: A gente está regulando. “Ah, mas, veja bem, é que vai afetar a minha casa”. Má sorte, você que mora ao lado do metrô ou ao lado de uma grande avenida, mas a gente precisa proteger o bairro da Vila Madalena e evitar uma gentrificação que expulse seus habitantes. Mas aí chega uma hora em que o interesse da cidade enquanto valor de troca se sobrepõe ao valor de uso.
RITA: É o que está acontecendo agora...
J. S. Whitaker: É um conflito de elites. Porque a vila Madalena não é mais, vamos dizer, um bairro popular. Ela é um bairro elitizado, precisamente por causa dessa gentrificação e dos novos edifícios de alto padrão que foram construídos lá antes do nosso plano diretor. Então nós temos um conflito entre as elites que estão lá tentando manter um valor de uso - que é um valor de uso privilegiado de pequenas casinhas bem localizadas - contra quem quer o valor de troca, que é tornar esse privilégio um privilégio de mais gente gerando alto lucro imobiliário. Mas o objetivo nunca é o de democratizar. Nunca é o de dizer vamos destruir a vila Madalena, que é ao lado de dois ou três metrôs e tudo mais, tem muito ônibus e é perto do centro, e construir vários prédios com 6 andares de altura. Se alguém me falar isso e garantir que 50% da população virá dos mananciais eu assino embaixo. Se 50% das habitações for forçosamente para gente que ganha entre 0 e 3 salários mínimos, então eu assino embaixo. É claro que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque os instrumentos que o Estado deveria ter de regulação urbana, de garantir que se tenha nesses miolos muito valorizados habitações de cunho social no Brasil é impensável, porque é uma lógica de uma sociedade de elite, de uma sociedade patrimonialista, onde quem manda é aquele que é dono do patrimônio. Então ele não vai permitir porque ele não quer essa mistura, aí você vê a diferença com a França. Na França você tem intermediário do Estado. O que está acontecendo é que o mercado, o capital, por causa da desregulamentação geral, influencia cada vez mais o intermediário do Estado, de maneira que nesse campo também, os interesses privados se sobressaiam. Na França a luta é contra a liberalização do agente do Estado. Aqui é o faroeste, onde o mercado tem uma influência direta sobre o território, e o Estado já é instrumento sob seu controle, sem nenhum poder de regulação, e mesmo promovendo uma desregulamentação que o favorize.
As cidades brasileiras historicamente representam essa lógica. Se podemos dizer hoje que São Paulo é uma cidade desigual, é que ela é resultado de 500 anos de uma estruturação onde o Estado não serviu pra nada, exceto para proteger os interesses de uma pequena elite. Olhando um mapa da cidade de São Paulo, vê-se que toda a concentração de investimentos públicos se dá historicamente no chamado eixo sudoeste. E é no eixo sudoeste onde se concentra toda a população de alta renda. No Rio de Janeiro, isso acontece na Zona Sul; em Belo Horizonte, em Curitiba, em Recife isso acontece também. Todas as cidades brasileiras são assim. Há enormes investimentos públicos que transformam esses bairros em bairros equivalentes de cidades de primeiro mundo. Claramente, é uma lógica de uma cidade feita para proteger os 5-10% mais ricos. E esses 10% são muitos: mais de 20 milhões de habitantes. E essa muita gente se concentra em algumas cidades. No Brasil, alguém que ganha mais de 2.500 reais por mês, com carteira assinada, já está nos 15% mais ricos do país. É impressionante, e pouca gente tem noção disso. O Piketty e sua equipe mostraram justamente esse grau de concentração de renda no Brasil.
Só que o método do Piketty tem um problema, no caso do Brasil. Porque ele vem de um país regulador, esse estudo mede a renda declarada, o que corresponde a uma parte importante da mão de obra ativa em países regulados. Só que no Brasil, 45-50% da população trabalha na informalidade e não tem sequer carteira de trabalho. Então se medimos as desigualdades pelo imposto de renda, perdemos informações sobre quase 50% de trabalhadores sem registro. E mesmo entre os trabalhadores formais, quase 30% não declaram imposto de renda, porque são isentos. Então a medida da desigualdade de renda é muito imprecisa e certamente também subestimada. E ainda mais: como medir a riqueza em propriedades de terra, que não é a mesma coisa que a renda? Existe um grupo de uma centena de políticos deputados que é dona de três Bélgicas[8]. Nesse contexto é impossível o Estado ser independente, quando uma grande parte dos prefeitos no Brasil é dona de terras, ou em cidades médias (o que no Brasil são cidades entre 100 e 500 mil habitantes), eles possuem lotes bem situados, deixados vazios para frutuosas especulações financeiras. Mas como é que o Estado vai agir contra o grande proprietário de terras, se ele é da família do grande proprietário de terras? Se o representante do Estado é o proprietário patrimonial? Então, a contradição é essa. Ela está na natureza da coisa.
RITA: Uma das ideias que a RITA tinha com esse número especial sobre mudanças globais era de discutir como a nova crise ecológica, na sua concepção ampla, afeta alguns processos urbanos. Pensando sobre as enchentes atuais em Belo Horizonte e em São Paulo, elas não são processos novos. As questões urbanísticas têm uma relação clara com o que está acontecendo, com a retificação dos rios urbanos no Brasil, que é um fenômeno antigo. Só que, com a crise ecológica, a gente vai ter novas questões a tratar. Como é que o aumento de fenômenos climáticos extremos e as mudanças ecológicas que vivemos vão mudar, ou não, a maneira como a política urbana é feita? A concentração de renda pode exacerbar esses processos?
J. S. Whitaker: É claro que estou ciente e concordo com a gravidade da questão das mudanças climáticas. Mas, sinceramente, sou um pouco cético sobre se são elas que estão aumentando esse impacto direto de chuvas sobre as populações mais pobres. O que está certamente aumentando é a nossa capacidade de comunicar sobre elas. Grandes enchentes que produzem o caos, onde morre gente, fazem parte da história de São Paulo desde os anos 1950. E no mesmo nível que vemos agora. Apesar dos recordes históricos atuais, os dos anos 1940 são apenas um pouco abaixo. As mudanças existem, mas a chuva também acontecia antes. De novo, eu venho à mesma questão: A urbanização sem regulamentação estatal é uma urbanização que não planeja, que não prevê nada. Então, qual é a lógica ambiental da urbanização brasileira? É uma lógica que não pensou no plano ambiental e que está voltada a solucionar o problema das elites. E qual o interesse das elites no Brasil ao longo de 50 anos? Andar de carro. Para isso, a lógica desastrosa da urbanização foi canalizar rios para a construção de vias expressas. Com o desenvolvimento econômico, São Paulo passou de 1,5 milhões de carros circulando pela cidade nos anos 1970, para 6 milhões hoje, e as vias expressas não apenas não diminuíram, mas continuam a ser construídas. É uma loucura total! Além disso, a falta de regulação, o "faroeste", tornou a cidade completamente impermeável por causa das inúmeras torres com seus estacionamentos subterrâneos. Mas o problema ambiental mais sério é o fato de que, com o tempo, grande parte das populações mais pobres foram expulsas da cidade formal que possuí infraestruturas. Essas pessoas, sem outros recursos e sem políticas sociais de moradia, se instalaram nos mananciais da cidade, onde hoje vivem mais de um milhão de pessoas.
Então, como você resolve esse problema ambiental? Primeiro, vamos nos perguntar quais são os pontos centrais em termos de ecologia urbana. São eles a drenagem, o saneamento, os resíduos e as emissões de gases. Existem, é claro, outros elementos, mas essas questões são essenciais, e do ponto de vista da política urbana as duas primeiras são prioritárias. A questão do saneamento se resolve com saneamento domiciliar e estações de tratamento. O Brasil é a décima economia mundial, mas diversas cidades de mais de um milhão de habitantes como Guarulhos ou Maringá têm apenas 30% do esgoto coletado. Em São Paulo, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) diz que coleta 99,5% do esgoto, mas ela não fala que apenas 30% é deste valor é tratado. O resto é jogado diretamente no rio. Então, existem os promotores das smart cities, dos prédios com boa atuação térmica e bons para o meio ambiente, etc. Mas o esgoto desses empreendimentos continua a ser despejado nos rios! Além disso, se mil famílias precárias fossem realojadas da zona de manancial, seria mais eficaz de um ponto de vista ambiental do que fazer 500 prédios com ISO não sei quanto, selo verde... Porque o problema ambiental da cidade está em ter 1 milhão e 200 mil pessoas morando em área de mananciais. Mas por que essas pessoas estão lá? Porque a cidade nunca foi pensada para incorporá-las. Porque nós não estamos em uma sociedade de consumo que necessite dessas pessoas. Essas pessoas são a mão de obra da nossa industrialização com baixo salário. Eu brinco que nós temos, no Brasil, um Estado do “deixa estar (laissez-faire) social”, isso quer dizer “deixa estar” os pobres, que se viram sozinhos. A formulação da doutrina econômica liberal indica aqui o abandono da população. Nesse contexto, os discursos técnicos sobre uma cidade verde são na maior parte do tempo uma enganação. O que precisa ser feito é saneamento para todo mundo. Mas isso não é possível, porque a lógica da correlação de forças políticas faz com que seja construída uma ponte Estaiada [via expressa em São Paulo], asfalto etc. Esgoto, coleta e tratamento não são prioridades, e isso gera grande problema ambiental que só vai crescendo, na medida que essas cidades vão crescendo economicamente e que essas periferias vão se expandido sobre as áreas de proteção e as áreas de captação de água, e que o mercado imobiliário sem regulação vai impermeabilizando cada vez mais a cidade, que é a segunda questão.
Voltando para a Vila Madalena, ela está sendo transformada e impermeabilizada. Por causa da lei chamada coeficiente de aproveitamento, uma nova construção não pode ocupar mais de 50% do lote. Só que no subsolo dos prédios, que não é regulamentado, é feito um estacionamento que impermeabiliza completamente a área. Foi feita uma lei que obrigou a fazer uma piscininha, que é um reservatório de drenagem, em cada prédio. Melhorou um pouco, porque senão a cidade ia ser o caos. A outra política urbana que, por incrível que pareça, tem um impacto direto sobre a questão da drenagem e da impermeabilização do solo é a de mobilidade urbana. Se metrôs e transporte público são desenvolvidos, há menos necessidade de impermeabilizar tudo para os carros, porque a área carroçável se torna menos prioritária. Inclusive, se a opção adotada for bondes, deixa-se o caminho com gramado, como são os bondes hoje em dia na Europa. Com transporte de massa, você faz menos vias expressas em margens canalizadas. Diante dessa obviedade, Paris, por exemplo, fechou as vias expressas marginais do Sena para o carro, para permitir uma drenagem maior, visto que Paris é quase inteira impermeabilizada. Mas Paris, como Santos, funciona em um sistema de vasos comunicantes. Ela tem uma laje geral, e a cidade se drena e se resolve por baixo. Do ponto de vista da engenharia, essa é uma das soluções mais geniais da história urbana mundial, que é a solução de Paris. Mas é uma solução muito complexa.
A cidade é um conjunto de sistemas de infraestruturas; esses sistemas só podem ser produzidos pelo Estado, porque são muito caros. Eu posso construir a minha casa sozinho, se eu for rico, construo uma casona, se eu for pobre, construo um barraco, mas eu construo. Mas eu não posso construir um metrô ou um coletor tronco de esgoto. O metrô custa 100 milhões de dólares o km linear. Por isso, é necessária uma intervenção pública. E então, em função do investimento (ou a falta dele), é o Estado quem gera a valorização urbana. E aí está a perversidade do capitalismo não regulado: ao promover uma infraestrutura que é feita com gasto público, o Estado gera valorização no valor de troca, que é negociável e apropriado individualmente. Por isso existem os instrumentos urbanísticos que representam o Estado regulando. Ele permite a uma parcela da população se apropriar de coisas melhores, mediante a um pagamento de um IPTU muito mais alto, para cobrar por aquilo que ela está usufruindo em infraestrutura urbana. Então o IPTU - que sempre é diferenciado, quase no mundo inteiro -, é um exemplo de instrumento urbanístico em que o Estado está tentando recapturar essas diferenças, para poder reinvestir em outros lugares e produzir uma sociedade mais homogênea. No Brasil, isso é insignificante e revela exatamente essa ideia da correlação na maneira que o Estado atua na regulamentação pública do espaço urbano.
RITA: Durante a ditadura, foi construído o famoso Minhocão, uma via expressa elevada que atravessa a cidade por quase 4 km. Atualmente, o futuro dessa via é objeto de um intenso debate e, em várias ocasiões, você expressou uma opinião muito crítica contra o projeto de reestruturação, que estabeleceria no lugar uma espécie de faixa verde, que você acha que corresponde a uma forma de saneamento na cidade. Você pode nos falar mais sobre essa questão?
J. S. Whitaker: O Minhocão é um concentrado de todos os problemas que mencionei até agora. O Minhocão é obra do poder público, do Estado patrimonialista (em termos conceituais, aqui, é o poder público municipal com fundos também federais). Em 1972, tratava-se de servir os interesses do setor automobilístico, de uma elite que, na época, representava uma parcela restrita da população que circulava de carro ainda com muita fluidez. As coisas mudaram nos últimos anos em São Paulo, hoje há uma real saturação das vias de circulação, então, ainda hoje, é mais conveniente pegar seu carro do que usar o transporte público. E quando não é o caso, isso não acontece porque o transporte público tenha melhorado significativamente, mas porque o tráfego tem piorado! Então, na época, Paulo Maluf, que era o prefeito, respondendo à pressão das elites que queriam andar de carro, da indústria automobilística que era a locomotiva da industrialização de baixos salários e das grandes construtoras que queriam construir e que mandavam no Brasil, lançou a construção do Minhocão. Essa construção rendeu pra ele um enorme capital eleitoral – o mote dele era “Maluf que faz”. Funcionou muito bem durante décadas, até que o crescimento econômico permitiu uma maior democratização do uso do carro... para o bem e para o mal: uma parte da classe média baixa pôde subitamente ter um carro, e, ao mesmo tempo, chegamos a famosa frase de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, que reclama que até as empregadas domésticas podem passar férias em Miami. Muita gente começa a usar o carro, o trânsito fica impossível e o Minhocão começa a incomodar e incomodar as elites. Por quê? As elites veem isso como uma excrescência urbana, agora que o discurso “verde” ganha força. Então, são as elites – ou ao menos aquela parte da elite mais conectada com as tendências culturais urbanas globais - que estão se mobilizando tirar o Minhocão.
Pergunte às populações mais pobres e periféricas se elas acham necessário destruir o Minhocão. Eles não se importam com esse debate. Minhocão é um horror? Certamente, mas há muitas pessoas motorizadas que usam o Minhocão e para quem ele é uma necessidade, simplesmente porque não há alternativa. Portanto, é uma discussão bastante tensa dentro da elite. Há setores dessas elites que se conscientizaram da necessidade de uma cidade mais humana, "uma cidade para as pessoas": como esses belos discursos pregados, por exemplo, pelo planejador urbano Jan Gehl. Exceto que a destruição do Minhocão seria muito prejudicial para uma parcela mais pobre da população que mora lá, por outras razões. Alguns de meus alunos fizeram pesquisas sobre o perfil dos residentes nesses apartamentos: tinha carroceiros, vendedores de CDs usados na Avenida Santa Ifigênia; tinha gente de baixa renda porque os aluguéis eram insignificantes. Às vezes, eu digo ironicamente que Maluf desenvolveu uma política social e de habitação construindo esse Minhocão, que fez com que o valor dos imóveis, especialmente nos andares mais baixos dos edifícios, caísse enormemente, o que garantiu um acesso à moradia na região central para uma população mais pobre. Para os proprietários, isso obviamente não é uma coisa boa. Os anos se passaram, e, em seguida, os investidores, confrontados com um mercado imobiliário congestionado, começaram a ver essa área “perdida” como uma "frente imobiliária" interessante: a valorização que poderia vir da destruição do Minhocão, ou de sua reconversão em parque linear elevado, poderia permitir a transformação dessa via em grande avenida ornada de árvores, como ela foi no passado. A pressão do mercado imobiliário, portanto, começou a se fortalecer, juntando-se à pressão dessa outra fração da elite que quer construir um parque ou um espaço verde. Apesar das maravilhosas aparências onde todos querem verde, segundo o modelo dos corredores verdes [coulées vertes] de Paris ou do High Line Park de Nova York, aqueles que querem construir um parque representam a visão mais individualista e elitista. A ideia é poder passear nos fins de semana e, basicamente, não se importam com o que acontece abaixo do corredor elevado e não se importam com as pessoas que vivem neste subsolo urbano onde não chega luz. É uma visão totalmente egoísta e individualista da cidade.
RITA: E qual é a visão que você e a sua equipe defendem?
J. S. Whitaker: Para mim, é muito claro que, a médio prazo e mesmo a curto prazo, não há outra solução senão acabar com o Minhocão. O modelo do automóvel faliu, os problemas respiratórios são enormes, as condições de vida são problemáticas para as populações que moram lá. Mas o que eu digo é que é uma questão de regulamentação pública. Antes de acabar com o Minhocão precisa-se planejar o zoneamento para garantir que a população pobre não seja simplesmente expulsa dali. Não há nada mais absurdo e violento do que expulsar uma pessoa que vive há 20 anos no mesmo lugar, pagando aluguel baixo e respirando gás carbônico durante todo esse tempo, para deixar os ricos se instalarem. É a gentrificação na sua mais pura definição. Devemos remover o Minhocão? Ok, mas vamos determinar “ZEIS” (zonas especiais de interesse social), desapropriar terrenos para fazer habitação social construídos pelo Estado e criar regras para garantir que a população que mora nessa zona há mais de uma década possa permanecer, aplicando, por exemplo, taxas sobre a compra de apartamentos antigos, uma lei de inquilinato, proteção do valor dos aluguéis, entre outras. É somente por meio dessas políticas regulatórias que garantiremos a construção de uma nova avenida onde exista uma oferta de moradia diversificada para pessoas de diferentes classes sociais. Isso que eu defendo representa, no Brasil de hoje, o mais puro radicalismo cubano-soviético-venezuelano! E essa política, portanto, nunca será implementada, mas deveria. O que vai acontecer então? O Minhocão será destruído, uma nova avenida São João será implementada com uma série de moradias de altíssima renda, e os investimento imobiliários serão promovidos com belos folhetos com mensagens como “Venha morar no novo boulevard São João, no Edifício Saint Jean du Beauregard”.
RITA: O Minhocão seria, então, um resumo muito bom de toda uma lógica de gestão da cidade de acordo com os interesses do mercado. Mas, agora, gostaríamos de tratar de uma outra questão, mais longe da sua especialidade do planejamento urbano. Você se posicionou, há alguns anos, sobre a questão da arte urbana, especialmente quando o prefeito Dória apagou instalações e grafites na cidade. Por que a arte (pictórica, mas também cinematográfica ou literária) é tão importante para o desenvolvimento de uma cidade e, de maneira mais geral, também para uma reflexão sobre o futuro das grandes cidades?
J. S. Whitaker: A arte tem um papel significativo nas dinâmicas da estruturação e da produção do espaço de diferentes maneiras, que são mais ou menos democráticas. A arte desempenha esse papel em particular quando grupos artísticos formam movimentos sociais orgânicos. Porque, além de dinheiro e capital, o que tem um poder transformador em uma cidade, do ponto de vista social de uma cidade mais justa e humana, são os movimentos sociais. Os movimentos culturais, dentro da visão marxista, são expressões de sociabilidade e, portanto, trazem reivindicações ou pelo menos discursos e posicionamentos. Quando você tem um movimento cultural que ganha peso e consistência enquanto movimento social, ele se torna uma força ativa na cidade. Penso, por exemplo, na importância do rap na França, com suas representações sobre o urbano e o político, e me lembro, por exemplo, da música de Zebda, “Le bruit et l’odeur” [O barulho e o cheiro], contra os estigmas que permeiam as populações de habitações populares, os HLM (habitação de aluguel moderado). Aqui, no Brasil, movimentos como o hip-hop, street dance, as religiões afro-brasileiras, ou mesmo o movimento cultural evangélico - para o bem e para o mau - refletem sobre a questão urbana e demonstram poder enquanto movimento. Também o samba e o pagode, as rodas de samba nos bairros mais elitizados, o pagode nos bairros periféricos, são todos movimentos que tem um discurso ligado à reivindicações sociais, principalmente no campo das políticas urbanas.
Mas, além dessa questão do discurso ou do posicionamento, os movimentos culturais também se territorializam, se posicionando enquanto força transformadora. Um exemplo é a apropriação que os movimentos sociais fazem da música de samba, do compositor paulista Adoniran Barbosa, "Saudosa maloca", onde se expressa a dolorosa nostalgia de um barraco demolido para a construção de um edifício imponente. Na gestão do Fernando Haddad, um dos aspectos mais importantes das políticas urbanas foi a reapropriação do espaço urbano como espaço de convivência e vida, com o fechamento das principais avenidas aos carros nos finais de semana, mas também com toda a rede de cultura da periferia. Foi fenomenal, houve um verdadeiro impulso ao hip-hop, ao teatro e ao cinema (com o projeto SPCine, que oferecia sessões gratuitas nos CEUs [centros educacionais unificados], nas periferias). A cultura pode, portanto, ser usada como uma ferramenta para políticas públicas urbanas com um objetivo democrático. A cultura tem um discurso, pode ser utilizada como instrumento e tem uma influência territorial. Por exemplo essa rede de cultura era formada por pontos de cultura instalados nos bairros que criam vínculos de cidadania, solidariedade urbana e redes cidadãs. Muitas vezes, somos criticados, nós, planejadores urbanos, por sermos autocentrados, mas é verdade que "o urbano é tudo", ou seja, o urbano é o espaço onde tudo acontece ou, em outras palavras, o urbano é o suporte físico da sociabilidade. Assim, a política urbana é uma política de transporte, educação, saúde, moradia, cultura, de maneira interconectada. Esta última, de fato, é essencial, e acho que foi realmente foi perceptível sob a gestão de Fernando Haddad, inclusive por meio de políticas que, talvez, não fossem diretamente culturais, mas que a afetavam. Por exemplo, o projeto "Transcidadania", destinado às populações transexuais.
RITA: Essa questão do respeito às minorias vai muito além do caso de São Paulo. Precisamente, gostaríamos de fazer uma última pergunta para refletir sobre a situação geral do país. Ainda nos lembramos das imagens apocalípticas do céu de São Paulo, obscurecidas pelas cinzas das queimadas do norte e noroeste do país. O episódio nos leva diretamente a problemas mais amplos que podem conectar a política urbana a outras questões nacionais. Pensando nessas interconexões, da mesma maneira como entre os anos 1950-1970 houve importantes migrações de populações do Nordeste para as cidades do Sudeste, causando uma restruturação importante dessas cidades, hoje temos as queimadas na Amazônia que podem influenciar as precipitações na região. Temos em mente o exemplo, quando há alguns anos atrás, a seca no Estado de São Paulo causou um grande problema de abastecimento urbano em água potável. Podemos pensar a cidade hoje sem sua conexão com o interior e com todo o ecossistema de um país? Como combater a política de desenvolvimento econômico ultraliberal e ecologicamente imprudente do governo Bolsonaro?
J. S. Whitaker: O exemplo da fumaça, neste dia que se tornou noite, é interessante em termos de sua simbologia. Eu acho que Bolsonaro teve azar. Isso poderia ter acontecido em outras queimadas antes. No entanto, o símbolo ficou muito evidenciado em relação ao que a sua política permite, e até incentiva, em termos de destruição ecológica. E também é possível que, naquela semana, o número de queimadas simultâneas em diversos lugares tenha sido muito superior, com ações deliberadas no sul do Pará e norte do Mato Grosso, sob influência direta do Bolsonaro. No entanto, acredito que devemos ter cuidado no discurso anti-bolsonarista para não escamotear a perversidade da sociedade brasileira, que é estrutural. Como se, retirando Bolsonaro, tudo fosse resolvido com uma varinha mágica, quando o que o Bolsonaro faz é colocar a cereja no bolo de uma desigualdade, e mesmo de uma selvageria social e institucional que sempre existiu no Brasil, um país de grandes desigualdades. Aqui, no passado, tivemos um prefeito como Maluf, e, hoje, após o parêntese de Haddad, Dória foi eleito prefeito e mais tarde governador do estado de São Paulo. Maluf ou Dória são representativos dessa política que subjuga mais da metade da população, prolongando as tendências nacionais que, por mais de quinhentos anos, deixam viver o povo em condições absolutamente indignas e miseráveis. Bolsonaro é uma ferida para o Brasil? Certamente, mas os ataques perpetrados contra homossexuais existiam também em pleno governo Lula, apesar de que na época foram feitos grandes esforços para aumentar a tolerância na sociedade...
Qual é o grande drama que Bolsonaro representa? Na realidade, ele oficializa e torna transparente o que o Brasil executa na surdina há séculos. Isso é terrível? Sim, sem dúvida, mas talvez, no fundo, também seja uma coisa boa, vista por um certo ângulo. Acredito que o governo Bolsonaro seja um desastre total para o país, mas ao menos, de uma certa forma, ele tenciona e traz à tona elementos que expõem e caracterizam, de maneira escancarada, a natureza intrínseca da sociedade brasileira.
As questões de igualdade de gênero, as questões do machismo estrutural, do racismo estrutural, as questões de homofobia, todos esses aspectos, hoje em dia, estão aparecendo porque nós temos um Bolsonaro para tencionar e falar para um repórter da Globo “Você tem uma cara de homossexual terrível”, e ainda completar “mas não vou te acusar de homossexual por causa disso”. Explicitar esse tipo de pensamento explicita o que 50 milhões de brasileiros que votaram nele pensam. Nesse sentido, é bom a gente sempre tomar cuidado e entender que o Bolsonaro é o reflexo daquilo que é uma ponta de um iceberg e que, hoje em dia, dramaticamente, se tornou uma desfaçatez tão grande que ela não precisa ser escamoteada.
RITA: Você, que é professor da USP, universitário, acha que, no campo cultural e universitário, o ataque contra tudo o que representa o intelectualismo é de certa forma uma novidade? Principalmente em sua intensidade?
J. S. Whitaker: Mais ou menos. Eu acho que há, porque o atual governo, e também o que governa tanto aqui no estado [de São Paulo], como em outros estados, se permite explicitar. E ao explicitar também se torna mais efetivo. Ao explicitar, a barra é elevada. Enquanto não é explícito, fica mais escondido, a partir do momento em que se torna escancarado, se exacerba. O impacto mais significativo no governo atual, nesse aspecto, é sobre as universidades federais, porque elas estão sob direto comando do governo federal. Agora, ele age diretamente sob conquistas que foram alcançadas muito recentemente, nos últimos 15 anos. Há 20 anos, as universidades federais eram 1/3 das de hoje. Os 12/15 anos do governo Lula e do PT duplicou os campi de universidade federais.
RITA: Aí está a novidade: o ataque contra a universidade federal não tem nenhum limite.
J. S. Whitaker: Mas isso já ocorria. O Fernando Henrique, apesar dos seus anos de carreira universitária, fez muito pouco pelas federais. O FHC, justamente, ampliou o crescimento do sistema das universidades particulares. Depois, com o Lula você tem um período absolutamente fantástico que foi o do Haddad como Ministro da Educação, que estruturou esse acesso à universidade privada. O acesso público à universidade privada, com bolsas, financiamentos, PROUNI e tudo mais e também com uma ampliação inédita das universidades federais, e dos salários das universidades federais. Agora o ataque está se dando naquilo que foi um avanço. O que está sendo destruído são ganhos obtidos a partir do século XXI e da chegada do PT no poder, que teve muitos aspectos negativos, mas que também teve muitos aspectos positivos. E é isso que está sendo destruído com uma desfaçatez, com uma desmedida, e com uma falta de cuidado e disfarce, que essa é inédita. Porque hoje na correlação de forças se permitiu que a sociedade brasileira saísse da cordialidade. O que está sendo quebrado no Brasil é a cordialidade da qual falou Sérgio Buarque de Holanda, um fenômeno social onde as relações de poder e de dominação são diminuídas e tratadas de maneira dissimulada, em uma lógica patriarcal e familiar. "O Brasil é um país multirracial que nunca teve racismo", por exemplo, é uma afirmação repetida frequentemente que revela como as elites brasileiras são capazes de esconder, sob uma capa de "cordialidade", a dureza da estrutura social de um país onde quase toda a população rica é branca. Com o fim da cordialidade, as tensões sociais são expostas como elas são. Não é uma mudança na lógica estrutural da sociedade e nem na forma de agir do governo. Então, eu acho que é terrível o que está acontecendo, mas escancara uma sociedade que já é assim há 500 anos e que começou a avançar nos 12 anos do governo Lula e do primeiro mandato da Dilma, onde realmente teve uma curva ascendente inédita. Não só do crescimento econômico, mas também e sobretudo do crescimento com distribuição. Ou seja, avanços na educação, nas terras indígenas, nos direitos das minorias e tudo mais.
O que eu acho que aconteceu e que me leva a ser otimista no médio prazo é que as pessoas não percebem que a maior transformação do governo Lula foi geracional. Então, assim, por exemplo, em maio de 1968, em Paris, quem chegou na faculdade com 20 anos tinha nascido em 1948 no pós-guerra e tinha crescido no período de construção dos 30 gloriosos, de uma sociedade mais aberta, das grandes conquistas sociais cívicas, do movimento feminista que já vinha crescendo etc. Mas essa geração tinha também sido promotora dessas grandes mudanças sociais porque era uma geração que cresceu com acesso a escola universal, com acesso à universidade, e que tinha aula com Althusser, Sartre, Simone de Beauvoir etc. De repente, essas pessoas promoveram uma transformação social que era uma transformação geracional.
No Brasil, houve um fenômeno parecido. Quem hoje em dia tem 20-30 anos nasceu pós constituição de 1988 e cresceu nos anos Lula. Ou seja, tiveram boa parte da escolaridade e formação na era Lula com aprendizado sobre o que que é sociabilidade, sobre o que é direito, sobre o que é abertura de informação, sobre o que é posicionamento no mundo etc. Isso tem um impacto que, acho, nem o Lula imagina. Por outro lado, quem ainda está dominando a política brasileira é a velha geração, com uma nova, que é aquela minoria grudada nela, personificada pelo Bolsonaro e os filhos. Mas isso não representa a transformação geracional que está acontecendo, que são justamente os que estão falando “a gente quer universidade, a gente quer PROUNI, a gente quer direitos iguais, a gente não quer preconceito, a gente não quer a situação da mulher submissa…”. Isso vai ter um poder transformador e já está tendo. É isso que está tencionando ainda mais o governo do Bolsonaro, para o bem e para o mal. Por um lado, há uma pauta geracional, que é a das políticas públicas, direitos civis igualitários para todos os grupos sociais, minorias e não minorias, enfim, raça, gênero, acesso à cultura, defesa das terras indígenas etc., que é muito boa. Por outro lado, essa pauta geracional se afasta demais da pauta econômica. Enquanto isso, o Paulo Guedes está deitando e rolando. Ele está destruindo - da mesma forma que acontece no caso das universidades ou dos direitos trabalhistas - os avanços econômicos conquistados na era Lula, e os discursos de oposição dos jovens nem sempre incluem essas questões. A reforma trabalhista é o exemplo mais gritante. Então, no fundo no fundo, eu acho que estamos num momento de transição. E olha só que interessante, eu também acho que isso não é só nacional. Mas pode ser que eu seja muito otimista. Pode ser que a gente sofra muito antes que isso seja capaz de ser transformador.
RITA: Mas, por outro lado, existe o crescimento das igrejas evangélicas, que pode ser um contrapeso ao processo você está descrevendo.
J. S. Whitaker: É um contrapeso, só que é um contrapeso com muito menos força, porque ele é baseado em uma total manipulação. A característica do movimento de massas evangélico é uma manipulação total. O exemplo disso é de que é essa a população que acredita em fake news, que acredita que o Haddad vai distribuir a “mamadeira de piroca”. Você tem esse outro grupo sobre o qual eu falava que sabe que não é assim, que vê isso como uma ofensa. Então, está muito dividido. Mas porque eu acho que o vento geracional é mais forte? Porque ele é cultural, tem assimilação com uma transformação de valores, enquanto o outro é manipulado. Ele é um pastor que fica botando coisa na cuca e por isso tem vida curta. Então, eu acho aí que está a grande diferença nesse confronto.
RITA: É bom ouvir uma visão otimista. Obrigado.
Notes de fin
[1] Whitaker Ferreira João Sette (2007). O mito da cidade global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano. Petrópolis: Vozes.
[2] On peut notamment trouver la teneur des thèses défendues par Sassen dans : Sassen Saskia (1996). La ville globale. Paris : Descartes & Cie.
[3] Le Parti des Travailleurs, parti historique de Lula, Dilma Rousseff et Fernando Haddad, vaincu par Bolsonaro lors des dernières élections.
[4] Voir notamment Lippietz Alain (1992). Mirages et miracles. Problèmes de l'industrialisation dans le Tiers-Monde. Paris : La Découverte.
[5] Piketty Thomas (2013). Le Capital au XXIe siècle . Paris : Le Seuil.
[6] Whitaker Ferreira João Sette (2012). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano. Parâmetros de qualidade para a implementação de projetos habitacionais e urbanos. São Paulo: LABHAB; FUPAM.
[7] Coletivo Paulo Freire ; CEDAL (1977). Multinationales et travailleurs au Brésil. Paris: Maspero.
[8] Deák Csaba (1991). « Acumulação entravada no Brasil. E a crise dos anos 80 ». Espaço & Debates, v. 30, n°32 : 32-46. São Paulo : Universidade de São Paulo.
[9] João Sette Whitaker fait ici référence à un ouvrage écrit par un journaliste qui s’est penché sur cette question : Castilho Alceu Luís (2012). Partido da terra: como os políticos conquistam o território brasileiro. São Paulo : Contexto.
[10] Allusion à un discours en vogue, de remise en cause de cette évidence scientifique, dans les cercles de Bolsonaro et du philosophe Olavo de Carvalho, considéré comme le "gourou" des cercles de l'extrême-droite brésilienne.
[11] La « cordialité », comme concept sociologique, est un enjeu central de Buarque de Holanda Sérgio (1998 [1936]). Racines du Brésil. Paris : Gallimard.
Notas de fim
[1] Whitaker Ferreira João Sette (2007). O mito da cidade global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano. Petrópolis: Vozes.
[2] Sassen Saskia (1998). As Cidades na Economia Mundial. São Paulo: Studio Nobel.
[3] Logan John R. et Molotch Harvey L. (1987). Urban Fortunes: The Political Economy of Place. Berkeley : University of California Press.
[4] Ver por exemplo, Lippietz Alain (1992). Mirages et miracles. Problèmes de l'industrialisation dans le Tiers-Monde. Paris : La Découverte.
[5] Piketty Thomas (2014). O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro : Intrínsica.
[6] Coletivo Paulo Freire ; CEDAL (1977). Multinationales et travailleurs au Brésil. Paris: Maspero.
[7] Deák Csaba (1991). « Acumulação entravada no Brasil. E a crise dos anos 80 ». Espaço & Debates, v. 30, n°32 : 32-46. São Paulo : Universidade de São Paulo.
[8] João Sette Whitaker faz aqui referência ao livro seguinte : Castilho Alceu Luís (2012). Partido da terra: como os políticos conquistam o território brasileiro. São Paulo : Contexto.
Pour citer cet article
Nathalia Capellini et François Weigel, "Le far-west urbain sans régulation : inégalités et ville globale. Entretien avec Jõao Sette Whitaker", RITA [en ligne], n°13 : novembre 2020, mis en ligne le 10 novembre 2020. Disponible en ligne: http://revue-rita.com/rencontres-13/le-far-west-urbain-sans-regulation-inegalites-et-ville-globale-entretien-avec-joao-sette-whitaker-nathalia-capellini-francois-weigel.html



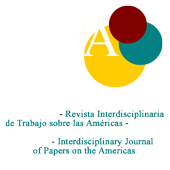











 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8