"La frontière Canada/États-Unis vue par un chercheur français" - Entretien avec Pierre-Alexandre Beylier
------------------------------
Cléa Fortuné
Doctorante en civilisation américaine
CREW (Center for Research on the English-speaking World), EA 4399, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
"La frontière Canada/États-Unis vue par un chercheur français"
Entretien avec Pierre-Alexandre Beylier
Pierre-Alexandre Beylier est Maître de conférences en civilisation nord-américaine à l’université Grenoble-Alpes au sein du laboratoire ILCEA4. Docteur en civilisation américaine, ses recherches portent sur la frontière Canada/États-Unis. Sa thèse, soutenue en 2013 sous la direction de Jean-Michel Lacroix, s’intitule « La Frontière Canada/États-Unis depuis le 11 septembre 2001 : continuités et mutations ». En 2016 il publie l’ouvrage Canada/États-Unis : les enjeux d’une frontière aux Presses Universitaires de Rennes, qui s’interroge sur les transformations que la frontière a subi depuis sa création et sur les politiques sécuritaires mises en place suite aux attentats du 11 septembre 2001[1].
RITA : Pouvez-vous nous présenter votre parcours de recherche et ce qui vous a motivé à étudier la frontière États-Unis/Canada ?
Pierre-Alexandre Beylier : J’ai découvert mon intérêt pour la recherche lors de la rédaction de mon Master 1 sur l’identité canadienne dans la chanson populaire des années 1990. Après avoir passé l’Agrégation d’anglais en 2008, je suis allé au Canada pour ma deuxième année de Master. Au fil des cours que je suivais en études canadiennes, je me suis rendu compte que la frontière Canada/États-Unis – dont je n’avais jamais entendu parler jusque-là et que j’assimilais à nos frontières européennes par son degré d’ouverture et sa dimension pacifique – était en fait devenu un sujet de tension entre les deux pays depuis les attentats du 11 septembre 2001. J’ai donc proposé à ma directrice de recherche de faire porter mon mémoire de M2 sur ce sujet davantage politique : « la frontière Canada/États-Unis depuis le 11 septembre 2001 ». Ces recherches ont été passionnantes et m’ont donné envie de les approfondir dans une thèse sur le même sujet. Pendant ma thèse, j’ai eu la chance non seulement d’obtenir un contrat doctoral mais également plusieurs bourses qui m’ont permis de passer plusieurs mois au Canada et aux États-Unis. J’ai pu mener de nombreux entretiens avec des hommes politiques et des acteurs du secteur privé pour évaluer l’impact que la politique américaine de sécurisation des frontières avait eu sur la frontière Canada/États-Unis. J’ai également pu me rendre dans plusieurs régions frontalières pour interroger les résidents et voir « de première main » l’objet de ma recherche. C’est une chose de lire des articles sur un objet de recherche, c’en est une autre de s’y frotter physiquement. Et l’expérience a été très enrichissante. Lorsque par la suite j’ai obtenu mon poste de MCF en 2014, la charge pédagogique et les tâches administratives m’ont empêché dans un premier de temps de dégager du temps pour organiser de nouveaux terrains. Mais une fois bien implanté dans mon poste, j’ai pu y retourner, grâce aux financements de mon laboratoire. J’essayais, la plupart du temps, de faire coïncider ces terrains avec des conférences auxquelles je participais en Amérique du Nord.
Depuis l’obtention de ce poste, j’ai axé ma recherche sur les villes-frontières et les communautés frontalières, laissant de côté l’approche macro pour me concentrer sur l’approche locale. Comme j’ai toujours été passionné par les frontières, cela m’a permis de concilier mes deux passions que sont la géographie et la civilisation nord-américaine.
RITA : Qu’est-ce que la frontière Canada/États-Unis a de particulier ?
PAB : Comme je l’ai dit précédemment, la frontière Canada/États-Unis était, pour moi, à l’image des frontières européennes : une frontière amicale, « ouverte », pacifique et non-défendue. C’était effectivement le cas jusqu’aux années 1990 où il s’agissait même de la plus longue frontière non-défendue au monde. Toutefois, les attentats du 11 septembre ont changé la donne. Son degré de défonctionnalisation – avant 2001 on pouvait la traverser en quelques secondes avec des contrôles sommaires et une déclaration orale de citoyenneté – a attiré l’attention des pouvoirs publics et des médias états-uniens, qui se sont engagés dans une opération de sécurisation. Toutefois, le projet fut colossal, étant donné le haut degré d’intégration qui unit les deux pays. En effet, au fil des décennies, les deux pays ont noué des liens aussi divers que nombreux, tant dans le domaine économique que dans le domaine « humain ». Par ailleurs, tout était à construire car la frontière était quasiment non-défendue – seuls 350 agents de la Border Patrol (les agents fédéraux étatsuniens qui patrouillent le long de la frontière) la surveillaient en 2001. Donc lorsqu’il a fallu sécuriser cette frontière longue de près de 9 000 kilomètres, qui était devenue une interface active, l’enjeu a été de trouver un équilibre entre sécurité et facilitation des flux. D’où le concept de « frontière intelligente » qui a été mis en place dès décembre 2001 pour atteindre ces deux objectifs présentés comme mutuellement non exclusifs, à l’aide de technologies, de collecte d’informations et de coopération.
RITA : La frontière États-Unis/Canada est-elle comparable à la frontière États-Unis/Mexique (en termes de migrations, de mesures sécuritaires, de liens économiques, de mobilités transfrontalières…) ?
PAB : Pendant longtemps les deux frontières des États-Unis ont été « ouvertes » et des liens étroits se sont tissés à travers elles. Les deux frontières terrestres des États-Unis sont toutefois de nature différente. En ce qui concerne la frontière Canada/États-Unis que je connais le mieux, elle est d’une diversité incroyable. Selon que l’on se trouve dans la région de Detroit/Windsor, Buffalo/Niagara ou au milieu des grandes plaines, la frontière traverse des lieux hautement urbanisés ou bien très ruraux et isolés. Sans parler de l’Alaska… Mais la frontière peut aussi revêtir une nature différente selon son support. Dans sa partie orientale, elle s’appuie principalement sur des cours d’eau, tels que le Saint Laurent et les Grands Lacs alors qu’à l’ouest, elle prend appui sur le 49ème parallèle et elle traverse donc des étendues de champs, dans une logique linéaire. Il convient également de souligner sa dimension maritime, à ses deux extrémités, mais notamment dans la région des îles de San Juan et du détroit de Haro.
La frontière mexicaine est, quant à elle, beaucoup plus active – il s’agit de la frontière la plus active au monde. Elle est aussi plus urbanisée avec le phénomène des « villes jumelles » qui s’est développé depuis sa création et elle est également le site d’un système de production particulier, celui des Maquiladoras, des chaînes d’assemblage financées par des capitaux étrangers mais dont les produits finaux sont destinés aux États-Unis et peuvent traverser la frontière sans droits de douane. Le processus de sécurisation de la frontière mexicaine a par ailleurs commencé bien plus tôt que celui de sa cousine septentrionale, dès les années 1980, lorsque l’immigration irrégulière, qui a toujours été un phénomène ancré dans la région frontalière, a été stigmatisée et criminalisée par le gouvernement étatsunien. Toutefois, le 11 septembre a conduit à une « mexicanisation » de la frontière canadienne. En effet, les pouvoirs publics et les médias américains ont commencé à pointé du doigt le déséquilibre qu’il y avait en termes de contrôles, de ressources et de personnels entre les deux frontières, la frontière mexicaine faisant l’objet d’une attention accrue. Par conséquent, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, l’administration Bush a mis en place une politique dite de « one face at the border » qui a eu pour objectif de traiter les deux frontières de façon uniforme, même si la diversité de la frontière États-Unis/Canada a constitué un obstacle notable à sa sécurisation. Les mêmes mesures et les mêmes processus de contrôle y ont alors étés déployés. Dans le cadre du projet SBI-net, il a même été question de déployer un « mur virtuel » constitué de tours, de caméras et de véhicules de surveillance, à l’instar du mur physique qui a été construit depuis 2006 à la frontière mexicaine. Annulé pour des raisons budgétaires, ce projet a toutefois vu la construction de tours de contrôle dans certains lieux comme à Blaine, dans l’État de Washington.
RITA : Qu’est-ce que les attentats du 11 septembre 2001 ont changé dans la relation entre les deux pays ?
PAB : Le Canada, qui se trouvait historiquement dans une situation « intermestique » avec les États-Unis – ni tout à fait domestique ni tout à fait internationale – s’est retrouvé banalisé. C’est ce qui s’est manifesté, à la frontière, par la politique de la « once face at the border ». Alors que les Canadiens bénéficiaient depuis longtemps de nombreuses exemptions – la plus symbolique d’entre elles concernait le fait qu’ils pouvaient entrer aux États-Unis uniquement grâce à une déclaration orale de citoyenneté – celles-ci ont été annulées les unes après les autres. Pour reprendre le même exemple, dans le cadre de la Western Hemisphere Travel Initiative, ils doivent, depuis le mois de juin 2009, après de longues opérations de lobbying pour obtenir une exemption, présenter un passeport ou un document approuvé par le gouvernement américain s’ils souhaitent traverser la frontière.
RITA : Dans quelle mesure les politiques migratoires étasuniennes ont-elles poussé les migrants latino-américains à traverser la frontière avec le Canada ?
PAB : L’imposition d’un visa et la recrudescence des contrôles à la frontière mexicaine ont poussé les migrants mexicains notamment à prendre l’avion pour le Canada – qui ne leur demande qu’un ETA pour un voyage de moins de 90 jours – et, de là, à traverser aux États-Unis par la frontière canadienne « illégalement ». Depuis quelques années, certaines régions comme le Pacific North West ont vu le nombre de passages irréguliers augmenter de façon significative, un phénomène qui attire de nouveau l’attention sur la frontière septentrionale des États-Unis. Toutefois, il convient de souligner que le Canada a également vu un afflux massif de migrants fuyant les États-Unis, notamment depuis l’élection de Donald Trump, ou plus précisément celle de Justin Trudeau en 2015. En effet, en vertu de l’Accord sur les Pays Tiers Sûrs, une personne ne peut pas demander asile au Canada si elle vient des États-Unis qui est considéré comme un pays sûr, sauf si elle traverse la frontière de façon irrégulière, entre les points d’entrée officiels. Et c’est ce qui se passe depuis 2015. Bien évidemment la crise du Covid a vu l’arrêt de ce phénomène puisque les deux pays ont signé un accord aux termes duquel ils se doivent de renvoyer les migrants dans le pays d’où ils viennent – en l’occurrence les États-Unis[2].
RITA : Les populations autochtones vivant dans des réserves transfrontalières ont-elles subi les politiques sécuritaires de l’après 11 septembre 2001 ?
PAB : Oui. Les populations autochtones, qui, traditionnellement, ne reconnaissent pas les frontières modernes dans la mesure où il s’agit d’un modèle géopolitique d’organisation du monde qui a été importé d’Europe et imposé à eux, ont été affectées par les mesures mises en place dans le sillage du 11 septembre. Alors qu’elles jouissaient d’une certaine liberté de circulation jusque-là, certaines tribus ont vu leur quotidien se compliquer grandement. C’est par exemple le cas des populations de la réserve Akwesasne qui chevauche littéralement la frontière dans la région de Cornwall, Ontario et Massena, NY[3]. Le passage de la Western Hemisphere Travel Initiative leur a notamment imposé d’être détenteurs d’un passeport – ou d’une carte spéciale qui a été mise en place plus tard – pour pouvoir traverser la frontière et se rendre à Cornwall. Le resserrement des contrôles a par ailleurs dissuadé certaines personnes de fournir leurs services sur la réserve.
RITA : Qu’en est-il des relations américano-canadiennes à l’échelle gouvernementale ? Et à l’échelle locale ?
PAB : A l’échelle locale, les relations bilatérales sont plutôt bonnes. Même si elle n’est pas toujours formalisée par des accords, la coopération existe quasiment de façon ancestrale au sein des communautés frontalières qui ont développé des relations cordiales à travers la ligne internationale. A l’échelle nationale, la situation est plus compliquée et les relations sont souvent tributaires du contexte politique entre les leaders des deux pays. A titre d’exemple, les relations entre George W. Bush et Jean Chrétien (Premier ministre canadien de 1993 à 2003) étaient très difficiles dans les années qui ont suivi le 11 septembre. A l’inverse, Barack Obama et Justin Trudeau (Premier ministre canadien depuis 2015) ont partagé une « bromance » qu’ils n’ont cessé de mettre en scène, même si cette dernière n’a pas duré très longtemps à cause du départ du président américain en 2017. Cela ne veut pas dire que des relations cordiales à l’échelle des gouvernements donnent nécessairement naissance à une coopération accrue en matière politique, mais elles offrent un contexte plutôt favorable, comme cela a été le cas entre Barack Obama et Stephen Harper (Premier ministre canadien de 2006 à 2015) qui, bien que n’ayant pas la même idéologie politique – le premier étant un Démocrate et le second un Conservateur – ont réussi à conclure l’accord « Par-delà la frontière ». Cet accord avait pour but d’atténuer les effets négatifs que la sécurisation de la ligne internationale avait eus sur les échanges commerciaux et la mobilité transfrontalière. A l’inverse, des relations tendues entre les deux leaders – comme c’est le cas, en ce moment, entre Justin Trudeau et Donald Trump – constituent davantage un frein qu’un catalyseur à des projets bilatéraux novateurs et une coopération transfrontalière accrue. Même si Justin Trudeau avait veillé à ne pas prendre parti lors de l’élection présidentielle de 2016 et a géré avec brio le début de la présidence Trump, les relations se sont détériorées au fil des mois, notamment à l’occasion du G7 de 2018 à l’issue duquel le président américain a insulté le Premier ministre canadien, le taxant de « malhonnête et faible» à travers un Tweet lapidaire, parce que Justin Trudeau s’était insurgé des droits de douane imposés par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium canadien.
RITA : Pouvez-vous revenir sur les relations entre acteurs publics et associations privées dans la gestion de la frontière américano-canadienne ?
PAB : La particularité de l’Amérique du Nord en termes de coopération transfrontalière plus généralement est qu’il s’agit d’une dynamique qui vient du bas : ce sont les acteurs privés – entreprises ou individus – qui poussent les gouvernements à mettre en place certaines politiques. Afin de résoudre les problèmes fonctionnels auxquels la frontière a dû faire face dans le sillage du 11 septembre, les acteurs du secteur privé se sont mobilisés pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils rendent la frontière plus flexible. C’est ainsi qu’a été signé puis mis en place l’accord « Par-Delà la frontière » en 2011. L’idée a été de mettre en place un « périmètre de sécurité théorique ». En d’autres termes, lorsque cela a été possible, il s’est agi de déplacer les contrôles au niveau du périmètre continental afin d’éviter une duplication de ces derniers. Les objectifs étaient d’intégrer certaines mesures, de fluidifier la frontière notamment en développant les programmes de facilitations, tout en ne compromettant pas la sécurité. En substance, il s’agissait d’une version améliorée de la frontière intelligente[4].
RITA : Qu’est-ce-que la signature de l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) en 1994 a changé dans les interactions et dans la circulation transfrontalière entre le Canada et les États-Unis ? Quels sont les changements apportés par le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) de 2018 ?
PAB : Avant l’ALENA, le Canada et les États-Unis avaient déjà conclu en 1988 un accord de libre-échange bilatéral. L’ALENA s’est donc inscrit dans la continuité de ce premier accord mais en incluant le Mexique. L’effet des deux accords a été significatif puisque le libre-échange a vu une augmentation exponentielle du commerce bilatéral et des investissements. Entre 1993 et 2000, le commerce bilatéral de marchandises est passé de 264 à 588 milliards de dollars. Dans le même intervalle, les investissements américains ont connu une croissance de 90 à 193 milliards de dollars et les investissements canadiens vers le sud de 67 à 177 milliards de dollars.
L’ALENA et les menaces de renégociation, voire de retrait unilatéral, a été une autre pierre d’achoppement dans les relations bilatérales depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Jusqu’au dernier moment, le Canada a ménagé le suspense quant à la signature du nouvel accord après une rupture des négociations. Au final, un nouvel accord a été trouvé mais le Canada a dû faire quelques concessions comme l’ouverture de son secteur de production laitière – protégé par des subsides gouvernementaux – ou l’augmentation des pièces automobiles d’origine américaine dans les véhicules construits en partie au Canada.
RITA : Vous avez récemment effectué un séjour de recherche à Point Roberts, une enclave étatsunienne dans l’État de Washington, où il n’est possible d’accéder que par le Canada. Que pouvez-vous nous en dire ?
PAB : En effet, j’ai effectué un terrain sur ce territoire qui est une « exclave ». Il s’agit d’une péninsule coupée par le 49ème parallèle et isolée du reste des États-Unis. J’ai eu la chance d’y aller deux fois pour interviewer des membres de cette communauté de 1 300 habitants et pour y étudier le rôle que joue la frontière en termes de pratiques et de mobilité. Il est clair que cette configuration confère à la frontière un rôle central et amplifié, tout en compliquant grandement le quotidien des habitants. Cet impact se fait ressentir en termes de mobilité en raison des contrôles – même si la plupart des habitants s’en accommodent – et en termes de régulations notamment pour les entreprises de restauration qui s’approvisionnent en nourriture aux États-Unis ou qui doivent embaucher aux États-Unis. Il se fait aussi ressentir pour la « municipalité » – qui est en réalité administrée par le Comté. Les résidents sont également impactés par les réglementations liées à ce qu’ils peuvent ou non ramener – même s’ils achètent tout aux États-Unis – car la liste des produits, notamment les produits frais, changent régulièrement. C’est une communauté vraiment intéressante à observer et à étudier.
RITA : Travaillant sur la frontière, vous avez été amené à la traverser en de nombreuses reprises. Votre regard de chercheur diffère-t-il de celui du citoyen lorsque vous vous trouvez aux postes douaniers ? Qu’est-ce que cela implique de travailler sur les frontières en termes ethnographiques et personnels ?
PAB : En effet, je l’ai traversée une trentaine de fois rien qu’en trois mois, lors de mon dernier séjour en 2019. En fait, tout comme je l’avais écrit dans ma thèse, son passage est aléatoire. Dans 90% des cas, on la traverse en moins de 15 minutes – parfois même en 30 secondes – mais il y a toujours certaines périodes de la journée où elle est embouteillée, avec certains agents qui font preuve de zèle ou d’agressivité. Mais en règle générale, le franchissement s’est toujours bien passé et parfois les agents étaient sympathiques, voire drôles. J’ai également eu la chance de traverser la frontière Mexique/États-Unis au printemps 2019. Voir ce fameux « mur » a été une expérience incroyable après avoir tant lu sur le sujet. Le franchissement a vraiment été une expérience particulière. Non seulement pour rentrer au Mexique il n’y avait aucun officier pour nous contrôler – hormis à Tijuana – mais le retour aux États-Unis, en tant que piétons, était à la fois long – jusqu’à 1h30 – alors que le passage devant l’officier était, quant à lui, très rapide. Je pense que ces expériences anecdotiques et empiriques enrichissent la recherche car elles donnent à voir notre objet d’étude de l’intérieur.
Travailler sur les frontières peut toutefois s’avérer délicat, notamment en Amérique du nord où le sujet est très sensible. Le fait de s’approcher d’un peu trop près de la frontière ou de poser certaines questions peut paraître suspicieux pour les résidents de Stanstead. De plus, certains résidents, dans certaines villes-frontières en ont « marre » d’être étudiés comme des bêtes de foire. C’était notamment le cas dans la ville de Stanstead, au Québec, qui chevauche la frontière. Certaines personnes ne veulent plus accorder d’interviews, que ce soient à des journalistes ou bien à des universitaires. La plupart du temps, cependant, les interviews se passent très bien et les gens sont contents qu’on s’intéresse à eux ainsi qu’à leur ville. Certains d’ailleurs sont intarissables sur le sujet. Je me souviens notamment d’une femme que j’ai interviewée en octobre dernier et qui est responsable d’une association qui organise un événement « Hands across the Border » au parc de Peace Arch. Elle était vraiment passionnée par la frontière, par les liens transfrontaliers et elle avait beaucoup d’idées pour les développer au mieux.
RITA : Qu’en est-il de la frontière Canada/États-Unis à l’heure du Coronavirus ?
PAB : La frontière Canada/États-Unis est fermée à tout voyageur « non essentiel » depuis le 21 mars 2020 et sa fermeture a été prolongée pour la troisième fois la semaine dernière jusqu’à fin juillet[5]. Contrairement à ce qui s’est passé pour le 11 septembre où la décision de fermer la frontière a été prise de façon unilatérale et intégrale, cette fois-ci, la décision a été prise conjointement avec le Canada, tout en laissant passer les marchandises ainsi que les travailleurs frontaliers[6]. Toutefois, parce que certaines villes dépendent économiquement des visiteurs canadiens, à l’instar de Blaine, dans l’État de Washington, ou de Point Roberts, que nous avons mentionnées précédemment, cette fermeture a un impact très négatif en termes de commerce et de tourisme. En effet, de nombreux Canadiens traversent la frontière pour aller faire leurs courses aux États-Unis, pour aller acheter leur essence, ou bien encore pour aller récupérer des colis qu’ils se font livrer dans des sortes de bureaux de poste privés où ils ont une boîte aux lettres.
Notes de fin
[1] Beylier Pierre-Alexandre (2016). Canada/États-Unis : les enjeux d’une frontière. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
[2] Beylier Pierre-Alexandre (2019). « Le Canada : un refuge anti-Trump en mutation ? ». Études canadiennes / Canadian Studies [Online], 85 | 2018 [URL: http://journals.openedition.org/eccs/1414 ; DOI : https://doi.org/10.4000/eccs.1414. Consulté le 11 juillet 2020]
[3] Poiret Guillaume et Beylier Pierre-Alexandre (2016). « La réserve autochtone « transfrontalière » d’Akwesasne entre Canada et États-Unis, zone de contrebande et faille dans la sécurisation de la frontière ». Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement [Online], 29 | 2016 [URL : http://journals.openedition.org/tem/3238 ; DOI : https://doi.org/10.4000/tem.3238. Consulté le 11 juillet 2020]
[4] Beylier Pierre-Alexandre (2020). “Combining a Closed and Open Border in the Terrorism Era: The Example of the Canada/US Border”. Dans, Ross Ciaran. Reading(s)/Across/Borders. Spatial Practices, Vol. 33: 100-117.
[5] Beylier Pierre-Alexandre (2020). « De l’Europe à l’Amérique du Nord, la contagion du renforcement des frontières ». The Conversation, mars. [URL : https://theconversation.com/de-leurope-a-lamerique-du-nord-la-contagion-du-renforcement-des-frontieres-134874. Consulté le 11 juillet 2020]
[6] Beylier Pierre-Alexandre (2020). « La Frontière Canada/États-Unis à l’épreuve du coronavirus, un sentiment de déjà-vu ? ». COVIDAM : la Covid-19 dans les Amériques, Juin. [URL : https://covidam.institutdesameriques.fr/la-frontiere-canada-etats-unis-a-lepreuve-du-coronavirus-un-sentiment-de-deja-vu/. Consulté le 11 juillet 2020]
Pour citer cet article
Cléa Fortuné « La frontière Canada/États-Unis vue par un chercheur français », RITA [en ligne], n°13 : novembre 2020, mis en ligne le 10 novembre 2020. Disponible en ligne: http://revue-rita.com/rencontres-13/la-frontiere-canada-etats-unis-vue-par-un-chercheur-francais-entretien-avec-pierre-alexandre-beylier-clea-fortune.html



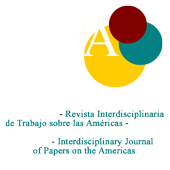









 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8