Où commence la périphérie ? Horizon commun des cinématographies argentine et brésilienne contemporaines
¿Dónde empieza la periferia? Un horizonte común de las cinematografías argentina y brasileñas contemporáneas
Résumé
À partir d’une lecture de la cartographie du novíssimo cinema brasileiro et des films postérieurs au Nuevo Cine Argentino, nous remarquons un mouvement de relocalisation des images cinématographiques hors des axes de production traditionnels en Argentine et au Brésil. Ce bouleversement n’est pas tant géographique que politique et esthétique. Depuis les années 2010, nous constatons une vaste filmographie conçue depuis un point de vue de « cinéastes-habitants » périphériques, lesquels participent d’un lugar de filmar dans des zones initialement invisibilisées, stigmatisées ou exotisées. L’hétérogénéité des formes filmiques et la dispersion des localités ne nous permettent néanmoins pas d’envisager une unité périphérique. Qu’en est-il des villas et favelas, qui incarnent des « périphéries au carré » ? En retraçant une brève histoire de leurs représentations cinématographiques, et en nous intéressant plus spécifiquement à l’œuvre contemporaine de César González et Adirley Queirós, nous souhaitons mettre en évidence que le travail de « cinéaste-habitant » transforme les typologies spatiales en lieux de cinéma propices à de nouveaux récits cinématographiques.
Mots-clés: Cinéma argentin et brésilien ; Lugar de filmar ; « Cinéaste-habitant » ; Villa ; Favela.
Resumen
A partir del estudio del mapa del novíssimo cinema brasileiro y de las películas posteriores al Nuevo Cine Argentino, notamos un movimiento de relocalización de las imágenes cinematográficas que nos lleva fuera de los ejes de producción tradicionales en Argentina y Brasil. Este cambio no es sólo geográfico, sino también estético y político. A partir de 2010, vemos una extensa filmografía que fue concebida desde un punto de vista de “cineastas-habitantes” periféricos, los cuales participan a un lugar de filmar en zonas inicialmente invisibilizadas, estigmatizadas o exotizadas. La heterogeneidad de dichas producciones y la dispersión de las localidades dificultan concebir una unidad periférica. ¿Qué sucede con las villas y favelas que encarnan las “periferias de la periferia”? Recorriendo una breve historia de estas obras (con especial atención en el análisis de los trabajos de César González y Adirley Queirós), nos proponemos pensar cómo el trabajo de los “cineastas-habitantes” es capaz de transformar las tipologías espaciales en lugares de cine propicios a nuevos relatos cinematográficos.
Palabras claves: Cine argentino y brasileño; Lugar de filmar; “Cineasta–habitante”; Villa; Favela.
------------------------------
Claire Allouche
ESTCA-Université Paris 8, France
Reçu le 11 octobre 2020/Accepté le 12 juillet 2021
Où commence la périphérie ? Horizon commun des cinématographies argentine et brésilienne contemporaines
Introduction
“Aqui a visão já não é tão bela
Não existe outro lugar – Periferia é periferia!”[1]
“Periferia É Periferia” (1997) de Racionais MC's
“¿quién construyó los edificios de la modernidad? ¿quién asfaltó sus calles?”[2]
González (2014: 28)
Conurbano. Suburbio. Villa. Interior. Provincia. Favela. Quebrada. Comunidade. Bairro/barrio popular. Lejos. Longe. Autant de mots argentins et brésiliens qui déclinent un champ lexical possible de la périphérie, autant de mots qui ne s’incarnent pas nécessairement en des images elles-mêmes périphériques, tant l’histoire du cinéma national des deux pays a été structurée par la puissance d’un centre comme inlassable point de départ. Nous pouvons néanmoins tracer un horizon commun de décentralisation comme élan d’expérimentations formelles pour les productions cinématographiques indépendantes contemporaines des deux pays. La théoricienne Lúcia Nagib (Nagib, 2002) et le critique Nicolas Azalbert (Azalbert, 2012) ont relevé dans leurs travaux respectifs un phénomène de réouverture du territoire dans les cinématographies émergentes du Brésil et de l’Argentine du milieu des années 1990 au début des années 2000, les dénommés retomada et Nuevo Cine Argentino. Cependant, des films emblématiques de cette période, comme Central do Brasil (1998) de Walter Salles et Mundo Grúa (1999) de Pablo Trapero mettent en scène des voyages, respectivement dans le Nordeste et en Patagonie, le premier par désarroi économique, le deuxième pour un motif initiatique, selon une logique narrative encore rattachée au centre névralgique du pays, Rio de Janeiro et Buenos Aires demeurant les espaces propulseurs vers des histoires extérieures.
À l’heure du novíssimo cinema brasileiro (Ikeda, 2012) et después del Nuevo Cine Argentino[3] (Bernini, 2018), période qui commence aux alentours de 2010 sans toutefois former un mouvement revendiqué ou identifiable, il nous apparaît que cet élan centrifuge, considéré sur un plan aussi bien géographique qu’esthétique, est d’autant plus exacerbé qu’il a davantage donné lieu à une relocalisation intime des images qu’à une délocalisation filmographique industrielle. Nous relevons de fait une importante production de « cinéastes – habitants », redéfinissant l’imagibilité (Lynch, 1998 : 11) de lieux situés hors de Buenos Aires et de l’axe Rio – São Paulo par un travail de réécriture depuis les espaces vécus. Cette relocalisation s’accomplit parfois même littéralement, comme en atteste l’un des premiers films des Brésiliens Gabriel et Maurílio Martins, Contagem (2010), imprimant sur grand écran le nom de leur banlieue du Minas Gerais qui n’avait jusque-là jamais connu de production cinématographique, ou encore Las Calles (2016) de l’Argentine María Aparicio, qui fictionnalise le processus d’appellation des rues du village de Puerto Pirámides en Patagonie, en filmant les habitants qui ont véritablement vécu cet événement peu de temps avant le tournage. Bien que nous ne pourrons pas développer davantage cet aspect ici, il est primordial de réfléchir au degré de « superposabilité de la géographie artistique et politique » (Castelnuovo et Ginzburg, 1981 : 52) propre au surgissement quantitatif de films décentralisés en Argentine et au Brésil. Pour cela, il conviendrait d’analyser en détails le contexte d’articulation d’une conjoncture technique et politique, notamment à partir de la concomitance de la démocratisation de l’accès aux outils de création numérique[4] ainsi que les transformations en termes de politiques culturelles publiques pendant les gouvernements du Parti des Travailleurs au Brésil (2002 – 2016) (Rubim, 2010) et le Parti Justicialiste en Argentine (2003 – 2015) (Getino, 2012).

Photogramme 1 : Contagem (2010) de Gabriel et Maurílio Martins / Un premier plan pour dire l’existence cinématographique de Contagem.

Photogramme 2 : Las Calles (2016) de María Aparicio / Puerto Pirámides, une spatialité à renommer en la filmant.]
I. Filmer la périphérie par-delà les archétypes
Dès lors, comment appréhender cette vaste périphérie cinématographique binationale sans la cantonner à une typologie spatiale[5] et sans la condamner à rester dépendante à l’instance d’un centre, notamment en termes de critères d’analyse ? Nous nous risquerions de fait à réitérer une lecture restrictive des films, en reléguant leur caractère proprement périphérique à des archétypes, lesquels, selon les mots de Gilles Deleuze et Félix Guattari, « procèdent par assimilation, homogénéisation, thématique, alors que nous ne trouvons notre règle que lorsque se glisse une petite ligne hétérogène, en rupture » (Deleuze et Guattari, 1975: 13). En d’autres mots, il nous apparaîtrait contradictoire de chercher à « recentrer », dans un sens de fixation et de nivellement, des films indépendants qui travaillent à la possibilité d’un devenir périphérique selon un principe d’agencement collectif d’énonciation. En d’autres termes, où commence la périphérie dans la matérialité des images, où commence la périphérie pour les regards qui l’accueillent ?
En exergue à la programmation du cycle Periferia da Imagem à la Caixa Cultural do Rio en avril 2018, ses instigateurs Lucas Andrade, Pedro Lessa et Tomaz Viterbo esquissaient une définition dynamique du terme :
Périphérie : pas seulement à partir de sa spatialité urbaine, sans, évidemment, questionner la validité de ce cheminement et la nécessité de sa discussion permanente comme question politique dans le Brésil d’aujourd’hui. Nous choisissons de rechercher aussi les modes selon lesquels la périphérie -entendue ici dans un sens prioritairement relationnel- vient revendiquer un espace de production et d’invention dans les dynamiques de disputes éthiques, politiques et esthétiques, en liant les images aux questions d’identité, de résistance, de libération et de liberté : ce sont des œuvres qui dessinent de nouvelles politiques du désir et de nouvelles propositions, plus horizontales, de socialisation. (Andrade, Lessa et Viterbo, 2018: 10)
À défaut d’une programmation concomitante pour la cinématographique argentine, nous pouvons mentionner la publication au même moment du premier ouvrage consacré au cine comunitario argentino, Cine comunitario argentino. Mapeos, experiencias y ensayos, dirigé par Andrea Molfetta (Molfetta, 2018) où plusieurs chercheurs ont problématisé un corpus conséquent filmant les périphéries du pays selon des modalités de tournage coopératifs notamment. Ces deux projets diffusés à l’orée de 2020 dénotent l’ampleur et la complexité de l’émergence de corpus nationaux périphériques, lesquels induisent une certaine urgence dans leur diffusion et une restructuration des méthodes d’analyse vis-à-vis des canons du cinéma international.
Dans les deux cas, le travail d’approximation périphérique consiste en une réflexion sur l’articulation entre lieu d’énonciation et topos filmé comme condition d’une incarnation des images par-delà la stigmatisation médiatique ou l’exotisation publicitaire. C’est ce principe de reprise cinématographique des lieux par les cinéastes qui y vivent ou qui ont établi un travail d’avoisinnement (avizinhamento) (Oliveira de Araújo Lima, 2017) qui nous amène à ébaucher l’idée d’un lugar de filmar contemporain pour les cinématographies argentines et brésiliennes décentralisées. La reconfiguration du potentiel fictionnel des périphéries s’aligne sur la capacité de construction, d’émission et de diffusion de discours par les protagonistes périphériques eux-mêmes, prolongeant ainsi le champ du lugar de fala (Ribeiro, 2017), central dans les débats intellectuels et artistiques au Brésil ces dernières années et de la decolonialidad des savoirs[6] et de la création importante en Argentine, notamment à partir du travail de Rita Segato. La connaissance intime des lieux périphériques, inscrite dans une perspective historique de construction sociale des exclusions, par celles et ceux qui les filment est ainsi à la racine des projets de réalisation.
À cet égard, nous pensons avec Jacques Rancière que:
Ce que le singulier de « l’art » désigne, c’est le découpage d’un espace de présentation par lequel les choses de l’art sont identifiées comme telles. Et ce qui lie la pratique de l’art à la question du commun, c’est la constitution, à la fois matérielle et symbolique, d’un certain espace-temps, d’un suspens par rapport aux formes ordinaires de l’expérience sensible. L’art n’est pas politique d’abord par les messages et les sentiments qu’il transmet sur l’ordre du monde. Il n’est pas politique non plus par la manière dont il représente les structures de la société, les conflits ou les identités des groupes sociaux. Il est politique par l’écart même qu’il prend par rapport à ces fonctions, par le type de temps et d’espace qu’il institue, par la manière dont il découpe ce temps et peuple cet espace. (Rancière, 2004: 36)
Dans ce texte, nous souhaitons prolonger ces questionnements en mettant en évidence la transformation historique à l’œuvre dans la construction de ce lugar de filmar par la génération de cinéastes argentins et brésiliens qui ont commencé à réaliser des films ces dix dernières années. Étant donné l’ampleur du sujet, nous nous concentrerons ici sur une déclinaison qui nous semble particulièrement significative en la replaçant dans une perspective historique. Nous nous intéresserons à l’évolution de la prise en charge par les histoires du cinéma nationales respectives des quartiers très populaires, villas et favelas, clichés d’une « périphérie au carré » selon les aspirations d’un centre établi, lieux de vie et de création pour les « cinéastes–habitants » qui déplacent aujourd’hui la stricte soumission à une représentation sociologisante de la misère. Nous souhaitons ainsi montrer que si les histoires croisées des villas et favelas comme « décors périphériques » n’ont pas réellement coïncidé dans le passé en Argentine et au Brésil, l’un des points de convergence majeur aujourd’hui tient à la capacité des deux cinématographies nationales à faire perdre aux villas et favelas cet exposant de marginalité excluante au profit de la mise en scène d’un nouvel espace de protagonisme cinématographique, comme il en est dans les œuvres de César González et d’Adirley Queirós.
II. Au commencement cinématographique des villas et favelas : « la classe moyenne va au peuple »[7]
A. De la naissance d’un mot aux premières images
Bien que le surgissement d’habitations urbaines précaires date probablement du début de la colonisation portugaise (Pereira de Queiroz Filho, 2011: 34), favela désignait initialement des plantes du sertão de Bahia et avait déjà donné son nom au point culminant de la localité de Canudos avant que soldats et femmes ayant survécu à la guerre éponyme ne s’installent à Rio de Janeiro et renomment leur « Morro da Providência » « Morro da Favela » à l’aube du vingtième siècle. Il est intéressant de constater que le mot lui-même a une origine périphérique, se déplaçant de l’interior lointain vers une zone urbaine populaire de la capitale d’alors. S’il est difficile de dater exactement le « premier film de favela », nous pouvons néanmoins citer l’un des succès initiateur réalisé pendant la première vague de cinéma sonore, Favela dos meus amores (1935) de Humberto Mauro (Napolitano, 2009: 137). Il faudra attendre les prémisses du Cinema Novo avec notamment Rio, 40 Graus (1955) et Rio, Zona Norte (1957) de Nelson Pereira dos Santos, influencé par le néo-réalisme italien, pour que la favela soit plus qu’un motif narratif propice à une dramatisation sociale du récit et qu’elle devienne un observatoire privilégié du Brésil inégalitaire.
Un demi-siècle plus tard, peu après la chute du péronisme où surgissent les premiers regroupements politiques d’habitants de zones autoconstruites et autogérées (Aguilar, 2015: 198), la villa dira son nom en Argentine, suite à la publication du roman de Bernardo Verbitsky Villa Miseria también es América en 1957. Ce mot[8] apparaîtra pour la première fois dans le cinéma argentin un an plus tard avec Detrás de un largo muro (1958) de Lucas Demare. Pour le chercheur argentin Gonzalo Aguilar (Aguilar, 2015: 197), l’apparition tardive d’un mot spécifique, doublée d’une certaine permanence en termes de représentation occultée de la villa miseria dans le cinéma national opère comme une marque de distinction de la culture moderne de Buenos Aires, construite sur une aspiration à retrouver son européanité présumée, désavouant au passage ses aspérités latino-américaines les plus dégradantes.
B. Du Nouveau Cinéma Latino-Américain des années 60 à la « reprise » des années 1990-2000
L’éclosion du Nouveau Cinéma Latino-Américain (Del Valle Dávila: 2015) dans les années 60 n’aura de cesse, à travers ses expérimentations cinématographiques mais aussi ses textes manifestes, de questionner les formes cinématographiques à concevoir pour attester des inégalités sociales structurant le continent, sans néanmoins occasionner sa spectacularisation. Dans son Manifeste de Santa Fe publié en 1964, Fernando Birri, réalisateur de Tire Dié (1960) concluait qu’il fallait « disposer une caméra face à la réalité et la documenter, documenter le sous- développement », là où Glauber Rocha, dans son texte fondamental Esthétique de la faim (1965), s’opposait aux « exotismes formels qui vulgarisent les problèmes sociaux », par-delà le primitivisme imposé par le conditionnement colonialiste.
Une partie de la génération naissante du Cinema Novo, Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade et Leon Hirszman vont se réunir autour de la réalisation collective de Cinco Vezes Favela (1962), découpé en cinq épisodes déclinant autant de situations fictionnalisées vécues par des favelados. Dans son ouvrage majeur Brasil em tempo de cinema: ensaios sobre o cinema brasileiro publié deux ans plus tard, le critique Jean-Claude Bernardet insistera sur les limites de traitement de la marginalité par la production brésilienne[9], considérant qu’elle opère de « manière paternaliste » (Bernardet, 2007: 48). Parmi les archétypes de personnages composant le peuple du cinéma brésilien (« prolétaires sans défauts, paysans affamés et victimes d’injustices, ignobles propriétaires terriens et bourgeois fornicateurs »), il accordera une place particulière au favelado : « c’est un marginal social, c’est un paria, il accuse la société en vigueur à travers son indigence et il n’est pas obligé d’affronter ouvertement les problèmes des luttes ouvrières. » (Bernardet, 2007: 50)
En déclarant que « les films de favela prolifèrent » (Bernardet, 2007: 50), Jean-Claude Bernardet augurait un raccord entre les nouveaux cinémas des années 1960 et la reprise cinématographique de la transition démocratique à partir des années 1990. La Cité de Dieu (2002) de Fernando Meirelles et Kátia Lund en a été le triste ambassadeur international[10], suscitant le texte essentiel d’Ivana Bentes, « Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome ». La chercheuse brésilienne y relève entre autres la « démission d’un discours politique moderne au nom de narrations brutales, post-MTV et vidéoclip » (Bentes, 2007: 249). S’en est suivi l’établissement implicite du genre favela movie et de l’efeito favela (effet favela) que la chercheuse brésilienne Natalia Christofoletti Barrenha définit comme : « une dissémination de représentations de la favela pour l’audience globale incorporée avec l’illusion d’une connaissance de la cause » (Christofoletti Barrenha, 2019: 139), c’est-à-dire la favela comme ilot ghettoïsé de la misère brésilienne, déconnectée d’une macrostructure politique et sociale.
À notre connaissance, il n’existe pas réellement d’homologue argentin, le villa movie. S’il fallait établir une correspondance, à défaut de pouvoir trouver un réel équivalent à La Cité de Dieu dans le cinéma argentin, ce serait sans doute Elefante blanco (2012) de Pablo Trapero. Deux prêtres, interprétés par les célèbres acteurs internationaux Ricardo Darín et Jérémie Renier, luttent contre la corruption dans une villa qui encercle le bâtiment Elefante Blanco, projet du plus grand hôpital latino-américain qui restera inachevé. Comme pour La Cité de Dieu, nous retrouvons d’emblée le désir de donner au film une image de marque en convoquant un « nom fantôme »[11], une porno-misère doublée de ruin porn. Le film n’a néanmoins pas connu un succès commercial comparable à son prédécesseur brésilien mais aura gagné le monopole du « film de villa » à gros budget. Une fois de plus, nous notons un écart temporel et quantitatif dans la construction d’une imagibilité de la villa en regard avec la favela. Pour Gonzalo Aguilar, l’inclusion de la villa dans le paysage argentin sous la forme d’une coexistence urbaine aurait véritablement commencé à se dessiner à partir de la crise de 2001.

Photogramme 3 : La Cité de Dieu (2002) de Fernando Meirelles et Kátia Lund

Photogramme 4: Elefante blanco (2012) de Pablo Trapero
Dans La Cité de Dieu comme dans Elefante blanco, villas et favelas n’ont plus valeur de décors de périphéries nationales, elles sont les marqueurs sociaux d’une lisibilité internationale. Ce tourisme social (Freire-Medeiros, 2007) s’exprime notamment par l’insistance de la mise en scène à construire des espaces labyrinthiques qui perdent assurément le spectateur. Villas et favelas se voient institués comme des périphéries au cube de l’ordre du cinéma mondial, puisque les lieux de vie se désapproprient d’eux-mêmes dans la déflagration du découpage, en plus d’être les vecteurs d’un frisson continu. Par quels moyens villas et favelas pourraient se défaire du « fardeau de la représentation » (Natalia Christofoletti Barrenha, 2019: 137), pour incarner pleinement des localités de cinéma périphériques ?
III. La périphérie comme lugar de filmar : dialogue entre les cinémas de César González et Adirley Queirós
Nous ne pourrons pas nous attarder ici sur la sortie en 2010 du film 5 x favela – agora por nós mesmos co-réalisé par Manaíra Carneiro, Wagner Novais, Rodrigo Felha, Cacau Amaral, Luciano Vidigal, Cadu Barcellos et Luciana Bezerra, qui ont en commun d’être favelados[12] de Rio de Janeiro. Il est néanmoins important à considérer comme geste d’autodénomination. En se reconnaissant comme favelados, les cinéastes comme leurs protagonistes opèrent un renversement historique[13] de la violence symbolique, notamment si l’on se rappelle que ce mot était le titre du premier fragment du film de 1962 réalisé par Marcos Farias. Toutefois, les critiques émises par Jean-Claude Bernardet à la sortie de Cinco Vezes Favela résonnent à nouveau en 2010 :
Le film ne laisse pas à la réalité la moindre possibilité d’être plus riche, plus complexe que le schéma exposé ; la réalité ne donne de marge à aucune interprétation par-delà le problème posé, et arrive à donner l’impression d’avoir été inventée spécialement pour le bon fonctionnement de la démonstration. (Bernardet, 2007: 42)
Nous voulons croire que le cinéma périphérique n’est pas un primitivisme[14], ni sur le plan narratif, ni sur le plan esthétique, mais un lieu d’expérimentation et émancipation cinématographique possible, depuis une réalité qui n’a pas à se montrer hégémonique pour être puissante[15]. À cet égard, il nous importe désormais de revenir à notre préoccupation contemporaine et d’examiner des œuvres qui travaillent selon nous à concevoir un cinéma périphérique dans les deux pays au gré de cette nécessaire « petite ligne hétérogène, en rupture » (Deleuze et Guattari, 1975: 13), établissant un lugar de filmar effectif.

Photogramme 5 : 5 x favela – agora por nós mesmos (2010) de Manaíra Carneiro, Wagner Novais, Rodrigo Felha, Cacau Amaral, Luciano Vidigal, Cadu Barcellos et Luciana Bezerra / La favela pris de haut, image aérienne de l’épisode « Arroz e Feijão »
Deux trilogies de longs métrages de fiction, produits de manière très indépendante, « sans formation dans les écoles de cinéma, sans relation économique avec l’État (institut du cinéma), étrangers au modèle de cinéma propre aux festivals internationaux » pour reprendre les critères d’Emilio Bernini (Bernini, 2015: 147), répondent de front à notre préoccupation. Respectivement réalisés dans la villa Carlos Gardel, dans la banlieue de Morón, ouest de Buenos Aires, et dans la ville-satellite populaire de Brasília, Ceilândia[16], les films de César González[17] et d’Adirley Queirós[18] dénotent une singularité certaine dans leur revendication à créer un cinéma périphérique de « cinéastes–habitants », où voisinage et équipe de tournage se confondent, tout en expérimentant des formes qui ne leur sont pas imposées par un cahier des charges centripète. Les histoires qui traversent les quartiers se transforment par un processus de fictionnalisation en surimpression des lieux mêmes, créant une tension entre matérialité effective des espaces et fabrique de fabulations. Les protagonistes périphériques ne sont ainsi pas strictement assujettis à leur condition ordinaire : dans Lluvia de jaulas (2019) de César González, le jeune Alan se réinvente une trajectoire dans le cœur de Buenos Aires tout en participant aux matchs de football sur le terrain de fortune de la villa ; dans A cidade é uma só? (2011) d’Adirley Queirós, en-dehors de ses heures de travail comme homme de ménage, Dildu se lance dans la politique en candidatant comme député.
Si nous ne souhaitons pas confondre cinéma périphérique et trajectoires de cinéastes, considérant qu’un lugar de fala n’assure pas automatiquement un lugar de filmar émancipé formellement, force est de constater que les deux se superposent remarquablement dans le cinéma de César González et d’Adirley Queirós, sans être seulement un motif de légitimité pour filmer[19]. Au premier plan de leur travail réside la nécessité de transformer leurs lieux de vie en lieux de cinéma. Adirley Queirós est né en 1970, en même temps que les premières briques de Ceilândia, avortement urbain de la capitale moderniste, où il continue à vivre aujourd’hui. Il a été joueur de football professionnel pendant plus de dix ans pour gagner sa vie. Il se rend dans une salle de cinéma pour la toute première fois à l’âge de vingt-cinq ans[20] et réalise son premier court métrage, Dias de Greve, en 2009. C’est aussi la toute première occurrence cinématographique de Ceilândia qui narre, par-delà la collectivisation d’une conscience de classe chez des serruriers grévistes, la redécouverte de leur propre ville dans le cadre de cette temporalité. Dans ses trois longs métrages, A cidade é uma só? (2011), Branco Sai, Preto Fica (2014) et Era uma Vez Brasília (2017), il met en place une contre-histoire de Brasília par les descendants de ses constructeurs, à partir d’un mélange d’archives réelles et fictives, filmée à hauteur d’habitant ou de laje, sans ne jamais s’incliner devant la monumentalité de la capitale moderniste, lui préférant le potentiel dystopique inscrit dans les briques périphériques.
Après de nombreux courts métrages[21], César González est le « premier cinéaste villero » à réaliser un long métrage de fiction en Argentine. Il devient pibe chorro à l’adolescence pour subvenir au besoin de sa famille. Il survit in extremis à un affrontement avec la police et il sera incarcéré pendant cinq ans[22]. Suite à sa participation à des ateliers en prison, d’art et de littérature notamment, il se met à filmer régulièrement son quartier. La « trilogie villera », composée des longs métrages Diagnóstico Esperanza (2013), ¿Qué puede un cuerpo? (2014) et Atenas (2017) s’attache à accompagner des personnages villeros de différentes générations, dans leurs recherches d’emploi autant que dans leurs quêtes existentielles, sans peur de mettre en scène des situations non naturalistes, avant de réaliser Lluvia de jaulas (2019), film essai où le cinéaste accompagne la dérive d’Alan, son alter ego, entre la villa et le centre de Buenos Aires. Il préfère le terme de villeritud, construit à partir du courant de la négritude, à l’institution d’un cinéma villero[23] : il ne s’agit pas tant d’affirmer l’appartenance à une catégorie sociale que de revendiquer la construction permanente d’une culture différenciée des courants hégémoniques.

Photogramme 6 : A cidade é uma só? (2011) d’Adirley Queirós / Dildu, en chemin vers un protagonisme politique.

Photogramme 7 : Branco sai, preto fica (2014) d’Adirley Queirós / Marquim do Tropa, activateur et activiste de la mémoire de Ceilândia.

Photogramme 8 : Atenas (2017) de César González / Une trajectoire de Nazarena Moreno dans le quartier.

Photogramme 9 : Lluvia de jaulas (2019) de César González / Alan, dos à l’obélisque, réinvente son Buenos Aires dans la continuité de la Villa Carlos Gardel.
Dans leurs films respectifs, César González et Adirley Queirós œuvrent ainsi au nom d’un lieu de vie et d’agir commun[24], ne limitant pas leurs films à l’expérience de trajectoires exceptionnelles. Leur cinéma se distingue ontologiquement des contrefaçons périphériques précédemment évoquées, parce que, pour penser avec Rancière, « ceux qui « n’ont pas » le temps prennent ce temps nécessaire pour se poser en habitants d’un espace commun et pour démontrer que leur bouche émet bien une parole qui énonce du commun et non seulement une voix qui signale la douleur. » (Rancière, 2004: 38) Nous retrouvons dans les films des deux cinéastes la nécessité de « reconnecter » les espaces de la pauvreté au « centre » qui les exclut autant qu’il les engendre, c’est-à-dire de mener à bien un cinéma périphérique qui exprime le déploiement d’une autre échelle de polis en-dehors des institutions étatiques. Cela s’incarne notamment par une conscience agissante des protagonistes (pensons aux acteurs non professionnels Nazarena Moreno dans Atenas ou Marquim do Tropa dans Branco Sai, Preto Fica) ainsi qu’à leur capacité à subvertir la ségrégation sociale établie par leur présence ponctuelle dans la capitale, périphérisant le centre par la portée de leurs corps dans l’espace public.
IV. Des espaces nécessaires pour la circulation des films périphériques
Dans les histoires du cinéma respectives de l’Argentine et du Brésil, villas et favelas ont d’abord majoritairement été des sujets périphériques et décors thématiques d’une expression du sous-développement, par un processus frôlant l’invisibilisation pour le premier pays, par une exacerbation prolifique pour le deuxième. La cinématographie récente de « cinéaste–habitants, » celle de César González et d’Adirley Queirós en première ligne, ravivent une politique d’attachement à la périphérie comme des lieux de cinéma possible, comme des lieux avant tout, où le protagonisme des personnages prévaut sur toute tentation de typologie spatiale. La périphérie ne se limiterait dès lors plus à une articulation entre esthétique et politique conjuguée au présent, elle serait aussi le cadre producteur de sa propre projection dans un devenir. Cette politique de l’affect est-elle néanmoins suffisante pour permettre une certaine pérennité à cette production cinématographique périphérique indépendante ? Adirley Queirós signalait ce problème structurel : « Comment puis-je affirmer qu’un cinéma de la périphérie peut avoir lieu, si ce n’est pour une question économique ? Vous pouvez seulement avoir un cinéma dans la périphérie s’il devient une possibilité de profession. »[25]
Dans une conjoncture de politiques culturelles publiques actuelle bien plus défavorable que dans les années 2010, il est primordial d’envisager la suite de ce lugar de filmar selon des alliances périphériques à échelle aussi bien nationale que transnationale. Un festival comme CachoeiraDoc, fondé en 2010 dans l’interior de Bahia par la programmatrice et chercheuse en cinéma Amaranta César, a accompagné une nouvelle génération de cinéastes périphériques, portant une vive attention à ce que la pensée du cinéma soit frontalement affectée par les problématiques des Afro-Brésiliens, des femmes, des minorités sexuelles et des peuples autochtones notamment[26]. À Buenos Aires, le festival CineMigrante, fondé la même année avec des valeurs proches, a notamment montré les films de César González et Adirley Queirós. Preuve que, même en pleine capitale, la formation d’un regard ouvert à un cinéma périphérique peut créer des perspectives transnationales de soutien cinématographique.
Notes de fin
[1] « Ici la vue n’est déjà pas si belle / Il n’existe pas d’autre lieu – la périphérie est la périphérie ! » (Nous traduisons)
[2] « Qui a construit les bâtiments de la modernité ? / Qui a goudronné ses rues ? » (Nous traduisons)
[3] Nous reprenons littéralement le titre de l’ouvrage dirigé par Emilio Bernini, à défaut d’un accord terminologique dans les champs critiques et académiques pour désigner le moment postérieur au Nuevo Cine Argentino.
[4] Le réalisateur César González a déclaré que si le cinéma numérique n’avait pas existé, il n’aurait pas non plus existé en tant que cinéaste. (Bosch, 2017: 3).
[5] Cette préoccupation s’est manifestée dans le champ des sciences humaines contemporaines comme une nécessité épistémologique de différencier les périphéries depuis le travail de terrain. C’est notamment le travail dont les anthropologues Maria Gabriela Hita et John E. Gledhill font part dans leur texte « Antropologia na análise de situações periféricas urbanas » : « Pour les individus et familles qui vivent dans ces aires classées de la ségrégation spatiale, toutes les favelas et les quartiers populaires ne sont pas identiques. C’est pour cela qu’il nous faut prêter attention tant à la configuration du contexte social spécifique dans lequel les individus qui forment chaque lieu et les communautés de revenus faibles agissent, en identifiant qui ils sont et comment ils pensent, ainsi que des facteurs plus amples, régionaux, nationaux et transnationaux, qui ont un impact sur ces lieux de différentes manières et nous aident à comprendre comment et pourquoi les contextes de pauvreté diffèrent entre eux. » (Hita et Gledhill, 2010: 190)
[6] Nous pourrions sommairement définir ce courant de pensée comme la prise de conscience agissante depuis l’Amérique latine que la structure sociale, politique et culturelle des pays du continent continue à hériter du joug colonial, principalement à travers un système de valeurs eurocentriste qui légitime l’oppression raciale et sexuelle.
[7] Nous reprenons ici une expression de Jean-Claude Bernardet (Bernardet, 2007: 48).
[8] Comme le rappelle Gonzalo Aguilar, plusieurs mots étaient jusque-là employés pour désigner cette même réalité, dont suburbio qui donnera son titre au film éponyme de León Klimovsky sorti en 1951.
[9] Les films cités sont (Bernardet, 2007: 48) : Gimba (1963) de Flávio Rangel, O Assalto ao Trem Pagador (1962) de Roberto Farias, A grande feira (1962) de Roberto Pires, Os Mendigos (1962) de Flávio Migliaccio, Escravos de Jó (1965) de Xavier de Oliveira, Infancia (1965) d’Antonio Calmon, Garoto de Calçada (1965) de Carlos Federico Rodrigues.
[10] Le film, bien que hors compétition, était en Sélection officielle au Festival de Cannes en 2002.
[11] Le film de Lund et Meirelles n’a de fait pas été tourné dans la véritable Cité de Dieu.
[12] Les ateliers d’écriture des fragments qui apparaissent au générique sont plus précisément localisés dans la Cidade de Deus, Linha Amarela, Parada de Lucas, Complexo da Maré et Vidigal.
[13] À cet égard, nous pouvons ouvrir ce champ à la littérature, en pensant notamment aux recueils de nouvelles Je suis favela, Je suis encore favela et Je suis toujours favela publiés en France aux éditions Anacaona.
[14] Ce terme est effectivement employé par Glauber Rocha dans Esthétique de la faim ainsi que par Jean-Claude Bernardet dans le texte précédemment cité (Bernardet, 2007: p. 38).
[15] Pour approfondir l’analyse des problématiques esthétiques et politiques à l’œuvre dans 5 x favela – agora por nós mesmos, nous invitons à la lecture du texte de Cezar Migliorin (Migliorin, 2010).
[16] Le nom de cette périphérie non planifiée doit son préfixe à la « Compagnie d’Eradication des Invasions ».
[17] À notre connaissance, il n’existe encore aucun texte académique en France portant sur l’œuvre cinématographique de César González. Nous invitons à la lecture du texte de Mariano Veliz en espagnol (Veliz, 2019).
[18] Le cinéma d’Adirley Queirós a été très peu montré en France, au Festival Brésil en Mouvements en 2015 et aux Etats Généraux du film documentaire de Lussas en 2016 notamment. La littérature académique francophone est également encore très restreinte. Nous recommandons la lecture du texte de Vitor Zan (Zan, 2019).
[19] « Le fait d’être villero ne me garantissait en rien de faire un film digne. Il n’y a pas d’absolu. » a déclaré César González lors d’une conversation avec Lucrecia Martel à la Facultad de Bellas Artes de La Plata le 18/10/2018. Source : https://www.youtube.com/watch?v=4S5xjTmjScg [Consulté pour la dernière fois le 10/10/2019]
[20] Source, le Colectivo de Cinema de Ceilândia : http://ceicinecoletivodecinema.blogspot.com/p/o-diretor-adirley-queiros.html [Consulté pour la dernière fois le 02/01/2020]
[21] Ils sont tous accessibles via le canal YouTube de César González: https://www.youtube.com/channel/UCbvewvFcfPeDOw0XHCrkdXg
[22] María Domínguez, « Entrevista con César González : conocer el mundo a través del cine », Festival Cine Radical, 08/09/2017. Source : http://www.festivalcineradical.com/2017/09/08/entrevista-con-cesar-gonzalez-conocer-el-mundo-a-traves-del-cine/ [Consulté pour la dernière fois le 12/12/2019]
[23] Matias Máximo, « Cine Migrante : la construcción de la villeritud », Cosecha roja, 08/09/2017. Source : http://cosecharoja.org/cine-migrante-la-construccion-de-la-villeritud/ [Consulté pour la dernière fois le 12/12/2019]
[24] En effet, comme le signale le critique argentin Pablo Ceccarelli au sujet du travail de César González:
« Il serait injuste de faire retomber seulement sur la personne de César Gonzalez tout le potentiel que contient son œuvre. César Gonzalez fait partie d’une communauté : ses frères et sœurs de quartier, sa famille, les acteurs et les non – acteurs qui participent, son équipe technique, ses collaborateurs ; tous sont membres d’un grand groupe humain qui participe au fil des films. (…) Ils font partie d’un grand personnage collectif toujours présent dans les films du cinéaste, se démarquant de l’usage de protagonismes individuels. » (Ceccarelli, 2017: 31).
[25] Fábio Andrade, Filipe Furtado, Juliano Gomes, Raul Arthuso, Victor Guimarães, « Entrevista com Adirley Queirós », Revista Cinética, 12/08/2015. Source: http://revistacinetica.com.br/home/entrevista-com-adirley-queiros/ [Consulté pour la dernière fois le 12/12/2019]
[26] Pour reprendre les mots d’Amaranta César elle-même. Adriano Garrett, “Os festivais ainda olham pouco para a produção dos novos sujeitos históricos”, CineFestivais, 20/03/2017. Source: https://cinefestivais.com.br/os-festivais-ainda-olham-pouco-para-a-producao-dos-novos-sujeitos-historicos/ [Consulté pour la dernière fois le 12/12/2019]
Bibliographie
Aguilar Gonzalo (2015). Más allá del pueblo: Imágenes, indicios y políticas del cine. Buenos Aires : Ed Fundo Económico.
Andrade Fábio, Furtado Filipe, Gomes Juliano, Arthuso Raul, Guimarães Victor (2015). « Entrevista com Adirley Queirós ». Revista Cinética, [URL http://revistacinetica.com.br/home/entrevista-com-adirley-queiros/ Consulté le 12/12/2019]
Andrade Lucas, Lessa Pedro, Viterbo Tomaz (dir.) (2018). Periferia da Imagem. Rio de Janeiro : Caixa Cultural de Rio de Janeiro.
Azalbert Nicolas (2012). « Histoires du nouveau cinéma argentin. De Historias breves (1995) à Historias extraordinarias (2008) ». Cahiers des Amériques Latines, n°69 : 9-13. Paris : IHEAL CREDA.
Bentes Ivana (2007). « Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome ». Alceu, v.8 nº.15, juillet / décembre : 242 – 255. Rio : PUC.
Bernardet Jean-Claude (2007). Brasil em tempo de cinema. São Paulo : Companhia das Letras.
Bosch Carlos Luis (2017). « La discursividad del Cine Villero ». Imagofagia n°15 : 1 – 28. Argentina : ASAECA.
Bernini Emilio (2018). Después del nuevo cine : diez miradas en torno al cine argentino contemporáneo. Buenos Aires : Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires.
Bernini Emilio (2015). « Que puede un lumpen. Gracia, justicia y heterogeneidad. ». Kilómetro 111 n°13, octobre : 147 – 162.
Calabre Lia (2014). « Política Cultural em tempos de democracia: a era lula. ». Revista do Instituto de estudos brasileiros, n°58, juin : 137-156.
Castelnuovo Enrico, Ginzburg Carlo (1981). « Domination symbolique et géographie artistique [dans l'histoire de l'art italien]. », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 40, novembre : 51-72.
Ceccarelli Pablo (2017). « Una posición subversiva ». Pulsión n°7 : 30 -34.
Christofoletti Barrenha Natalia (2019). Espaços em Conflitos : ensaios sobre a cidade no cinema argentino contemporâneo. São Paulo : Intermédios.
Deleuze Gilles, Guattari Félix (1975). Kafka : Pour une littérature mineure. Paris : Editions de Minuit.
Del Valle Dávila Ignacio (2015). Le nouveau cinéma latino-américain, 1960-1974. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Domínguez María (2017). « Entrevista con César González : conocer el mundo a través del cine », Festival Cine Radical. [URL : http://www.festivalcineradical.com/2017/09/08/entrevista-con-cesar-gonzalez-conocer-el-mundo-a-traves-del-cine/ Consulté pour la dernière fois le 12/12/2019]
Freire-Medeiros Bianca (2007). « A favela que se vê e que se vende. Reflexões e polêmicas em torno de um destino turístico. ». RCBS, vol. 22, n°65, octobre : 61 – 72.
Garrett Adriano (2017). « Os festivais ainda olham pouco para a produção dos novos sujeitos históricos », CineFestivais. [URL : https://cinefestivais.com.br/os-festivais-ainda-olham-pouco-para-a-producao-dos-novos-sujeitos-historicos/ Consulté pour la dernière fois le 12/12/2019]
Getino Octavio (dir.) (2012). Cine latinoamericano, Producción y Mercados en la primera década del siglo XXI. Buenos Aires: Ediciones CICCUS.
González César (2014). Crónica de una libertad condicional. Buenos Aires: Editorial Continente.
Hita Maria Gabriela, Gledhill John E. (2010). « Antropologia na análise de situações periféricas urbanas ». Cad. Metrop., vol. 12, n° 23, janvier/juin : 189 – 209.
Ikeda Marcelo (2012), « Le “novíssimo cinema brasileiro”. Signes d’un renouveau ». Cinémas d’Amérique latine n°20 : 136 – 149. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail.
Lynch Kevin (1998). L’Image de la Cité. Paris : Éd. Dunod.
Matias Máximo (2017), « Cine Migrante : la construcción de la villeritud », Cosecha roja. [URL : http://cosecharoja.org/cine-migrante-la-construccion-de-la-villeritud/ Consulté pour la dernière fois le 12/12/2019]
Migliorin Cezar (2010). « 5 x Favela - agora por nós mesmos e Avenida Brasília Formosa:
da possibilidade de uma
imagem crítica. ». Devires, vol. 7, n°2, juillet – décembre : 38 – 55. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.
Molfetta Andrea (dir.) (2018). Cine comunitario argentino. Mapeos, experiencias y ensayos. Buenos Aires : Teseo.
Nagib Lúcia (2002). O cinema da retomada, Depoimentos de 90 cineastas dos anos 90. São Paulo : Editora 34.
Napolitano Marcos (2009). « O fantasma de um clássico”: recepção e reminiscências de Favela dos Meus Amores (H.Mauro, 1935) ». Significação, n°32 : 137 – 157.
Oliveira de Araújo Lima Érico (2017). « Quando o cinema se faz vizinho ». Significação, n°47 : 51-70.
Pereira de Queiroz Filho Alfredo (2011). « Sobre as origens da favela ». Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 10, n°23, septembre/décembre : 33-48.
Rancière Jacques (2004). Malaise dans l’esthétique. Paris : Galilée.
Ribeiro Djamila (2017). O que é o lugar de fala ? Belo Horizonte : Letramento.
Rubim Antonio Albino Canelas (dir.) (2010). Políticas culturais no governo Lula. Salvador de Bahia : EDUFBA.
Segato Rita (2018). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda. Buenos Aires : Prometeo Libros.
Veliz Mariano (2019). « Dispositivos de percepción de las villas miseria en el cine de César González ». L’Atalante n°28, juillet – décembre : 157 – 170.
Zan Vitor (2019). « Adirley Queirós et l’historiographie périphérique de Ceilândia. » Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Dossier Images, mémoires et sons. [URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/77038 ; Consulté le 15/11/2019]
Pour citer cet article
Claire Allouche, « Où commence la périphérie ? Horizon commun des cinématographies argentine et brésilienne contemporaines. », RITA [en ligne], n° 14 : septembre 2021, mis en ligne le 23 septembre 2021. Disponible en ligne: http://www.revue-rita.com/articles/ou-commence-la-peripherie-horizon-commun-des-cinematographies-argentine-et-bresilienne-contemporaines-claire-allouche.html



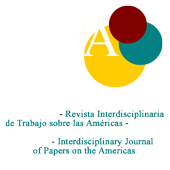




 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8