Exemples d’exploration de la matérialité des plantes dans les récits de Jean-Baptiste Labat (XVIIe - XVIIIe siècle)
Examples of the exploration of plants materiality in the writings of Jean-Baptiste Labat (XVIIth - XVIIIth Century)
Résumé
Cet article apporte un nouveau regard sur l’écriture de l’histoire naturelle, culturelle, matérielle et visuelle des objets végétaux à l’époque moderne dans le cadre du « Nouveau Monde ». Pour cela, nous puisons nos exemples dans les publications des journaux des voyages aux Caraïbes écrits par Jean-Baptiste Labat entre le XVIIe et le XVIIIe siècle en analysant le discours produit par le colon européen sur de tels objets. Nous étudions ainsi les plantes d’une part, traces souvent imperceptibles, témoins muets de l’histoire, et les personnes, d’autre part, exécutant les tâches difficiles des plantations ; autant d’indices des usages et des pratiques des sociétés autochtones et des esclaves amenés par les colons européens sur des objets « non occidentaux ».
Mots clés : Pharmacopée ; Nouveau Monde ; Méthodologie ; Histoire naturelle ; Histoire matérielle et visuelle.
Summary
This article offers a new methodological approach to the writing of natural, cultural, material, and visual histories of plants in early-modern period. For this, we draw on examples from the published journals of Jean-Baptiste Labat regarding his exploration of Caribbean islands and territories in the seventeenth century and eighteenth centuries. On the one hand, our goal is to study plants as objects and their invisible traces as silent witnesses of history. On the other hand, we examine the harsh working conditions on plantations, and the practices of colonists, indigenous Americans and slaves dealing with plants as materials of knowledge in the form of drugs / remedies, food, artisanal and ethnographic objects. This “work-in-progress” research and methodological approach aim at looking anew at the sources, decentering our perception, considering the materiality of these “non-Western” objects, and analyzing the discourse produced by the European colonists concerning such objects.
Keywords: Pharmacopeia; New World; Methodology; Natural history; Visual and material history.
------------------------------
Tassanee Alleau
Doctorante contractuelle en Histoire
Centre d’études supérieures de la Renaissance, UMR-CNRS 732.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Reçu le 11 octobre 2020/Accepté le 12 juillet 2021
Exemples d'exploration de la matérialité des plantes dans les récits de Jean-Baptiste Labat (XVIIe - XVIIIe siècle)
Introduction
Les Mémoires que je donne au Public, ne sont autre chose & que la Relation & Journal du Voyage & du sejour que j’ai fait aux Isles de l’Amérique pendant environ douze années. […] On le verra par le détail dans lequel je suis entré, tant des Arbres, des Plantes, des Fruits, des Animaux, que des Manufactures qui y sont établies & qu’on y pourroit établir (Labat, 1724 : i).
Par ce passage, Jean-Baptiste Labat (1663-1738), missionnaire dominicain, naturaliste, explorateur et propriétaire terrien, montrait qu’il avait le souci du détail et de l’exhaustivité dans les récits de voyage qu’il voulait faire publier. Il développa une expertise en botanique et devint célèbre par les récits qu’il s’attacha à rédiger et à diffuser pour rétablir, selon lui, les erreurs émises par d’autres auteurs de journaux de voyage comme ceux de Jean-Baptiste Du Tertre, dominicain et botaniste français. Dans sa préface, Labat s’empressait de faire la liste de tous les récits de voyages dont l’Histoire de la France Exquinoxiale du prêtre Antoine Biet, critiquant leur manque d’exactitude. L’intérêt d’une telle source réside dans l’étude du discours produit par l’auteur pour décrire des données naturelles. De nombreuses recherches ont été consacrées à Labat, au sujet des rapports entre Indiens caraïbes et colons, de ses connaissances scientifiques et de ses descriptions très techniques des plantations de sucre, de tabac ou de cacao. L'une d'elles porte sur la crédibilité des textes écrits par Labat. Marcel Chatillon pose ainsi une question simple « Peut-on faire confiance à Labat » ?[1]. À son époque déjà, le travail du Père Labat était critiqué comme une œuvre qui ne citait pas suffisamment ses sources et qui n’apportait pas les preuves nécessaires et originales comme le Père du Tertre le faisait :
Les Commissaires du Roi avoient en général évité, dans leur premier Mémoire, de citer le Père Labat, parce que son Ouvrage est moins une Histoire qu’une Relation de Voyage ; qu’il l’a presque toujours tirée de son Confrère le Père du Tertre, dont il a assez souvent copié négligemment les passages, & dont quelquefois il s’est écarté sans aucune preuve […] (Le Long, De Fontette, 1771 : 666).
Pourtant, les études historiques et littéraires sur les voyages le citent souvent tant son cas est à la fois riche d’enseignements et paradoxalement stéréotypé. Les écrits de Labat montrent une vision des plantations coloniales à travers les transformations culturelles et scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles. La rhétorique des journaux ou des mémoires des colons comme Labat se teintait d’exotisme[2], empruntant d’ailleurs à la littérature scientifique (récits ethnographiques, récits d’explorations scientifiques, cas d’études, cas médicaux, descriptions botaniques).
Les plantes sont des témoins du passé que l’histoire cherche à retrouver à l’aide de nouvelles méthodes exploratoires, dont certaines qui s’intéressent aux données épistémologiques par l’étude de la bioprospection[3], c’est-à-dire l’observation et la récolte des données relatives à la biodiversité. Cette bioprospection avait déjà été mise en place dès les premières expéditions dont l’objectif était de décrire les ressources naturelles des territoires explorés. L’objectif n’était pas sans lien avec les ambitions commerciales des colonies, la production de savoirs autour des spécimens et échantillons naturels observés, profitant en effet aux empires marchands européens[4].
Pour comprendre comment était écrite l’histoire culturelle, matérielle et visuelle de l’objet végétal en tant que matériau-savoir chez les colons du XVIIIe siècle, nous nous sommes penchés plus spécifiquement sur les sources imprimées que sont les journaux de Labat, écrits dès 1693 et publiés en 1722 dans le cadre de ses voyages aux Antilles (et plus largement dans les Caraïbes). À travers eux, nous pouvons observer les interactions humaines avec la nature végétale. Les relations complexes entre un être humain et un objet nécessitent de dérouler le long fil des usages particuliers, quotidiens ou exceptionnels, esthétiques ou symboliques, « dans de multiples situations de vie »[5]. La question de la matérialité et des voyages d’exploration du monde a déjà été longuement traitée dans les ouvrages de Marie-Noëlle Bourguet[6], tout comme l’importance de l’historicisation des plantes et des collections naturalistes a été relevée par Dominique Juhé-Beaulaton[7], afin de les appréhender comme des sources d’archives à part entière. L’autre intérêt des sources textuelles et iconographiques est de dévoiler le rôle des intermédiaires dans la construction de ces connaissances et le rôle de ceux et celles par qui le savant tenait ses informations.
Mais le problème des sources qui nous sont parvenues demeure le silence vis-à-vis de sociétés colonisées. L’historiographie récente cherche à déconstruire le mythe des « Grandes Découvertes », expression dont le biais colonialiste porte plus sur la vision des vainqueurs évoquée par Serge Gruzinski : « Une culture historique et une longue tradition d’ethnocentrisme n’incitent guère en effet à prendre en compte le regard des autres, […] »[8], disait-il dans le cas du Mexique. Ce discours était encore bien présent dans les mentalités du XVIIIe siècle et singulièrement chez Labat qui insistait sur les possibilités d’établir des plantations et des colonies supplémentaires, cherchant à fournir une description la plus réaliste et la plus mercantile et rentable possible[9] des plantations et manufactures qui lui appartenaient ou dans lesquelles il séjournait.
Les sources iconographiques et textuelles mises en relation dans cet article nous serviront, dans la première partie, à porter notre analyse sur le discours littéraire et la réception d’un tel ouvrage, afin d’établir le contexte intellectuel de la fabrication des savoirs sur la nature à cette époque. Et dans un second temps, nous nous intéresserons aux exemples précis d’« objets végétaux » comme le manioc ou l’arbre à enivrer dans le texte des Nouveau Voyage aux isles Françoises de l'Amérique (tomes I à VI). Ces objets sont des liens précieux entre des sociétés colonisées et le continent européen, signe d’une forme de rapprochement des « deux mondes », les intégrant dans une histoire globale, une histoire connectée et une histoire de la consommation. Cette approche apporte une vision resserrée du contexte culturel, social et économique du XVIIIe siècle dans lequel s’insèrent les produits végétaux, et permet de recentrer le regard sur les rencontres entre acteurs et intermédiaires étrangers et locaux dans la transmission des savoirs botaniques.
I. Le discours colonial et la naissance d’une attente d’« exotisme » dans les récits de voyage
A. Étudier le contexte littéraire…
Lorsque Jean-Baptiste Labat publia Nouveau Voyage aux isles Françoises de l'Amérique en six volumes, le sous-titre s’intitulait « L’histoire naturelle de ce pays, l’Origine, les Mœurs, la Religion & le Gouvernement des Habitans anciens & modernes. Les Guerres et les Evènemens singuliers qui y sont arrivez pendant le long sejour que l’Auteur y a fait ». Le genre « histoire naturelle » était issu d’une littérature scientifique de l’époque moderne, largement inspiré des auteurs antiques. L’émergence et la forte hausse des parutions d’ouvrages d’histoire naturelle au xviie siècle naissaient de l’ambivalence et de la polysémie du terme historia[10]. Ce genre littéraire convenait en effet à un grand nombre de disciplines (philosophie, grammaire, médecine, botanique ou cosmographie, etc.). La structure des textes et traités des érudits « humanistes » révélait la construction même de la pensée naturaliste. L’examen de la nature ne se faisait jamais sans refléter, implicitement ou explicitement, les usages moraux, politiques et religieux de l’époque moderne.
Les caractéristiques du récit de voyage sont celles du genre littéraire viatique. L’homo viator, l’homme voyageur, y racontait ses pérégrinations. Ces récits n’étaient pas dénués d’impartialité puisque, comme Jean-Baptiste Labat en faisait la démonstration dans ses journaux, il était question, pour les chroniqueurs et relationnaires[11], d’atténuer considérablement la « réussite » coloniale des Espagnols ou de couvrir les échecs coloniaux, commerciaux et scientifiques des Français, accentuant les enjeux de l’acclimatation des plantes. Avec l’usage du pronom « je », le Père Labat était un narrateur actif qui se mettait en scène. Il proclamait d’une part le succès de ses entreprises, racontait quelques actes de bravoure et faits d’arme contre l’attaque d’animaux sauvages[12] et livrait des illustrations graphiques de son expérience. Le récit de voyage de Labat avait l’avantage de suivre une chronologie en partant de l’année 1693, facilitant la contextualisation. Il était également écrit sous la forme de chapitres thématiques successifs, allant du manioc au cacao, en passant par le palétuvier, le café et la description des évènements tels que les guerres, les attaques des Caraïbes, des Anglais, les décès de personnages importants ou l’arrivée d’Européens sur les îles. Le recours à une rhétorique de comparaisons entre les coutumes des Amérindiens et des Européens permettait à l’auteur de donner des ordres de grandeur et des analogies compréhensibles aux lecteurs et lectrices. D’un autre côté, il s’agissait du meilleur moyen de donner une apparence péjorative à certains usages étrangers. Enfin, une autre caractéristique du récit de voyage était de faire un inventaire exhaustif des connaissances par les textes et les gravures.
Du XVIIe au XVIIIe siècle, le nombre de publications de récits de voyage double (Roche, 2011). Ils sont la démonstration de nouvelles pratiques scientifiques et méthodologiques pour la prospection de données naturelles. Dans ce contexte, les « instruments et les mesures dans le cadre des voyages scientifiques […] ont contribué à l’émergence de nouvelles catégories perceptives et esthétiques, d’un nouveau type de rapports entre l’homme et la nature »[13]. Ces considérations, à la fois de l’écriture d’histoires naturelles et des mesures et relevés effectués dans le cadre des voyages, offrent la possibilité de comprendre comment et pourquoi de tels établissements coloniaux étaient construits.
Dans son propos liminaire, Jean-Baptiste Labat dressait une liste d’ouvrages sur les voyages et se plaçait dans une posture historiographique critique. Il citait les travaux publiés de Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les François en 4 tomes, de 1667 à 1671 et de Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, intendant puis gouverneur des Antilles et de la Nouvelle-France. S’ajoutaient à cela les ouvrages des botanistes Charles Plumier, Amédée François Frézier ou Louis Feuillée et d’un copieur, le « Sieur Durret », et son Voyage de Marseille à Lima de 1720, que Labat prenait pour un imposteur qui n’avait peut-être jamais voyagé à Lima.
D’autres ont été plus loin : ils les ont décrites [les îles] sans les avoir vûës, & ont travaillé sur des Mémoires si vieux, si peu exacts, pour ne pas dire quelque chose de pis, qu’ils ont faut autant de faussetez qu’ils ont écrit de lignes, […] » (Labat, 1724 : v).
Sa principale critique envers les relationnaires se retournait parfois contre lui, car il était en effet lui-même sujet au jugement critique d’autres botanistes. On lui reprochait parfois de ne pas être assez exact dans ses descriptions botaniques et d’exagérer. Dans le Journal des beaux-arts et des sciences (Volume 306, 1727), le botaniste en charge de la recension des livres de Labat prétendait qu’il n’avait pas donné une illustration authentique de l’abricotier de Saint-Domingue, ou de l’ananas, et qu’il n’avait pas de connaissances suffisantes au sujet des divers « bois d’Inde », de la plante « Cassier », etc. (Journal des beaux-arts et des sciences, 1727 : 1304-1318).
Tous ces titres sont la preuve d’un succès littéraire auprès d’un lectorat composé de savants et de lettrés. Ils montrent que ces livres ne présentaient pas une image immuable ni exacte des paysages connus et parcourus puisque, comme le rappelait Labat dans sa préface, les nouveaux territoires ne cessaient d’être continuellement explorés. Pour nous, ils sont des indices importants pour l’étude des environnements naturels et notamment des plantes cultivées dans les colonies, éléments récurrents présents dans ces histoires naturelles.
B. … Et les attentes du public
La possibilité de traverser les océans constituait un déplacement important qui transformait les mentalités de l’époque moderne et les territoires explorés qui s’agrandissaient au-delà des horizons connus. L’attrait pour les récits de voyage répondait au besoin des auteurs ou des éditeurs de mettre en avant la « nouveauté » et même l’« exclusivité » du voyage en question. Dans sa dédicace préliminaire, Jean-Baptiste Labat disait :
Quoique le Voyage que j’ai l’honneur de vous présenter, contiennent des observations curieuses & des descriptions nouvelles & intéressantes, je n’oserois me flater que le Public lui fasse un accueil favorable, […] » (Labat, 1722 : iii-iv).
Cette emphase n’était pas neutre car elle s’inscrivait dans une démarche commerciale et scientifique. L’aspect unique et original de l’œuvre relevait ici d’une vérité que peu de gens pouvaient vérifier, à une époque où les voyages transocéaniques étaient encore exceptionnels. Labat indiquait que « Le Ministre Rochefort, qui n’a jamais vû les Isles de l’Amerique que par les yeux d’autrui » (Labat, 1722 : vii) avait commis de trop grandes erreurs dans son in-4° d’histoire de l’Amérique, en plagiant des parties entières des récits de Du Tertre, un autre missionnaire dominicain et botaniste qui précéda Labat à la Guadeloupe, la Martinique, la Grenade, la Dominique et bien d’autres « îles d’Amérique ».
Le succès de l’ouvrage du Père Labat dépassait les frontières françaises, comme en témoignent « trois éditions pirates parues en Hollande dans les dix ans qui suivent » (Chatillon, 1979 : 13). Il était cité dans des notices biographiques dont celle d’Antoine Sabatier de Castres qui notait déjà, à la fin du xviiie siècle, les limites d’une telle source :
Quoiqu’il paroisse tomber quelquefois dans les travers des Ecrivains voyageurs, qui observent mal & exagerent toujours, on trouve néanmoins des détails vrais & intéressans dans son Nouveau voyage aux Isles de l’Amérique. Il y donne une idée assez étendue de l’Histoire Naturelle de ce pays, des Mœurs, de la Religion, du Gouvernement & du Commerce de ses Habitans. Ce Voyage est écrit avec un ton de liberté & de franchise qui plaît, malgré la prolixité de l’incorrection du style. L’Auteur le composa, dit-on, sur les lieux. (Sabatier De Castres, 1779 : 350).
Il était mentionné dans l’ouvrage d’Antoine François Prévost Histoire générale des voïages (1759), dans les chapitres sur les voyages et établissements à Saint-Domingue et dans les Antilles, ainsi que dans le Dictionnaire Universel De Commerce (1742). Labat y était décrit comme ayant une soif inextinguible de voyager et comme quelqu’un de curieux, appréciant à la fois de partir explorer des territoires et de faire des relevés des ressources naturelles et tout autant porté sur l’« amusement », dont la chasse (Prévost, 1759 : 223). Les travaux du botaniste dominicain apparaissaient dans un catalogue aux rubriques « Histoire des différens Etats de l’Asie, de l’Affrique & de l’Amérique » et « Voïages » (De La Porte, 1747 : 40 et 57). Labat est fréquemment présenté comme l’auteur du Voyage des Isles françoises de l’Amerique, par exemple dans le volume 17 du Journal littéraire de 1731. Son œuvre figurait également dans le Catalogue des livres et estampes de defunts M[essieu]rs. Geoffroy, de l'Académie royale des sciences, affichée au prix de 9 livres et 2 sous[14].
Cette « mise en scène progressive de la subjectivité vagabonde et de la mise en forme du moi » (Roche, 2011) façonne de nouvelles règles d’écriture dont Jean-Baptiste Labat ne faisait pas mystère. Son désir de recevoir un « accueil favorable » du public dans son épître dédicatoire indiquait une attente forte de ce dernier. Car ce sont les attentes des lecteurs et des lectrices qui alimentaient le « marché » du livre de voyage. La « connoissance sûre, entière, & parfaite d’un Païs » dont se flattait Jean-Baptiste Labat était confortée par sa volonté d’exactitude et ses intentions lucratives et mercantiles. C’est par cette entrée naturaliste, représentation aussi réaliste que possible de la nature, que Labat préfaçait son étude. Cette préface a donc été pour nous l’occasion de présenter les ambitions du missionnaire dominicain. Sa conception de la nature qui l’environnait dans les colonies nous fournit des cas d’études et des exemples sur lesquels nous allons nous pencher dans la seconde partie de cet article.
II. Observer la matérialité des récits de voyage par l’étude des objets végétaux
A. Premier exemple : le manioc comme source d’une histoire « coloniale »
À travers les usages du manioc apparaissent des rapports flagrants de domination, entre l’esclave astreint à des tâches difficile ou l’Indien caraïbe et le Père Labat. Le manioc a surtout été étudié au sein d’une histoire globale de l’alimentation ou bien d’une histoire des pratiques agricoles, par des anthropologues et ethnographes tels que Milena Estorniolo[15] et des sociologues spécialistes de la biodiversité comme Florence Pinton[16]. Dans le cas du manioc de notre voyageur dominicain, le « découvreur » Jean-Baptiste Labat, ce sont les consommateurs de cette racine qui sont décrits par Labat comme des « habitans blancs, noirs & rouges des Isles, c’est-à-dire aux Europeens, aux Negres & aux Sauvages » (Labat, 1722 : 379). Le manioc, arbrisseau à l’écorce grise, rouge et violette était une ressource alimentaire que les colons s’approprièrent dès le xvie siècle. Cependant le manioc, s’il est mangé tel quel, est toxique. Il a donc fallu que le colon apprenne les techniques spécifiques de sa préparation. Comme Jean-Baptiste Labat le montrait dans son chapitre XV, précédant celui sur le manioc, de nombreuses « tubéreuses », légumes à bulbe et légumes-racines, poussaient déjà en abondance dans les jardins potagers coloniaux, même s’ils n’étaient dotés que de terres pauvres. Cette facilité d’acclimatation ne laissait aucunement présager que les colons européens s’intéresseraient au manioc alors qu’ils ramenaient et plantaient aisément des herbes venues du Vieux Continent. L’intérêt pour le manioc n’apparût que dès lors que les colons apprirent à en faire de la farine.
Il ne faut pas une grande force pour arracher ces sortes d’arbres, car outre que les terres ne sont pas extrêmement fortes, les racines ne sont pas bien avant dans la terre. Quand ces racines sont arrachées, les Negres destinez à cet ouvrage, en gratent ou ratissent l’écorce avec un méchant couteau comme on fait aux navets, & les jettent dans un canot plein d’eau où on les lave bien, après quoi on les grage, c’est-à-dire qu’on les réduit en une espece de farine fort humide qui ressemble à de la grosse scieure de bois, ce qui se fait en passant fortement la racine sur une rappe de cuivre, comme on passe le sucre. (Labat, 1722 : 382)
Ici, c’est par la succession de gestes décrits par Labat que se dessine une pratique et que l’enquêteur peut examiner des rapports sociaux et matériels aux objets végétaux. Le couteau, le canot, la râpe en cuivre, l’eau, les verbes « gratter », « ratisser », « grager » « réduire » sont des indices concernant la matérialité d’un objet végétal tel que le manioc. Mais qui utilisait le manioc ? Le colon qui s’appropriait le manioc étudiait en fin de compte un savoir pluriel et hybride : celui des Amérindiens qu’il observait, consommateurs ancestraux du manioc, et celui des Noirs, esclaves venus d’Afrique, qui apprenaient à maîtriser de nouveaux outils fournis par les colons ou les Indiens. Le manioc, plante à tubercules et à feuilles comestibles, était à l’origine des mutations alimentaires en Amérique comme en Afrique car sa farine était transformable en pain nourrissant. Aux alentours de 1585, le manioc venu d’Amérique apparaissait sur les côtes d’Afrique centrale, remplaçant petit à petit l’igname par son plus grand rendement et sa plus grande résistance face aux aléas climatiques[17]. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, le manioc comblait les échecs d’acclimatations des colons, ou le manque d’attractivité de certaines denrées, par exemple, la vigne et le blé :
[…] & j’ai connu par experience, que la culture du bled & de la vigne étoit inutile, & comme impossible aux Isles, particulièrement celle du bled. Je la regarde comme inutile, parce que très-peu de gens mangent du pain de froment, les Negres, les engagez, les domestiques, les ouvriers ne mangent que de la farine de Manioc ou de la Cassave ; presque tous les Créolles, ceux mêmes qui sont riches & qui font servir du pain sur leurs tables par grandeur ou pour les étrangers, mangent plus volontiers de la cassave & la préfèrent au pain. Il n’y a donc qu’un très-petit nombre de gens qui mangent du pain […]. (Labat, 1724bis : 353)
En évoquant les modes de consommation des différents groupes d’habitants des îles, le Père Labat inscrivait la culture des plantes de subsistance dans un contexte d’« accommodations » aux environnements plutôt hostiles pour les plantes européennes. Labat allait jusqu’à décrire les moyens exercés par les « Negres Marons », c’est-à-dire ceux qui fuyaient les plantations pour se réfugier dans les forêts, afin d’« ôter la mauvaise qualité du manioc en exprimant son suc [au manioc] » (Labat, 1724bis : 395-396). Les techniques de ce groupe particulier lui paraissaient utiles car elles étaient mobilisées sans les outils présents dans les plantations coloniales. La simplicité des gestes mis en œuvre par les esclaves justifiait qu’il s’y intéressât. Il expliquait que les « Negres Marons » coupaient par morceaux le manioc puis les mettaient à tremper pendant sept ou huit heures dans de l’eau courante des rivières ou des ravines. « Le mouvement de l’eau ouvre les pores de la racine, & entraîne ce trop de substance. » (Labat, 1724bis : 396).
Une seconde manière de traiter le manioc pour pouvoir le consommer était, pour les esclavages en fuite, de mettre les tubercules à cuire : « tout entier sous la braise. L’action du feu met ses parties en mouvement, & on le mange comme on fait des châtaignes ou des patates sans aucune crainte. » (Labat, 1724bis : 396). La simplicité de ces gestes autour du manioc contrastait avec la description de la préparation du manioc à l’aide de la râpe que nous avons vue plus haut.
De plus, Labat s’intéressait aux habitudes de consommation des Amérindiens et à leurs gestes techniques. Au chapitre XVII sur les boissons ordinaires des îles, il évoquait ce que les Européens avaient appris « des Sauvages » au sujet d’une boisson appelée l’Ouycou, à base des restes de manioc « qui ont échappé à la grage, les grumeaux qui n’ont pû passer au travers de l’herbichet, & généralement tous les restes qu’on appelle les passures, ne sont pas inutiles » (Labat, 1724bis : 396) :
On se sert pour cela de grands vases de terre grise que l’ont fait dans le pays. Les Sauvages, & à leur imitation les Européens les appellent Canaris ; nom generique qui s’étend à tous les vaisseaux de terre grands & petits, & à quelque usage qu’ils soient destinez. Il y en a qui contiennent depuis une pinte jusqu’à soixante & quatre-vingt pots. On se sert de ces grands pour faire le Ouycou, on les remplit d’eau jusqu’à cinq ou six pouces près du bord ; on y jette deux de ces grosses cassaves rompuës, avec une douzaine de certaines pommes de terre, appelées patates, coupées par quartier, trois ou quatre pots de gros sirop de cannes, […] La liqueur qui est dans les Canaris ressemble pour lors à de la bierre […]. Nos François s’y accoutument aussi facilement qu’à la bierre. (Labat, 1724bis : 397-398)
Le terme d’« imitation » ne concernait ici que l’appellation du vase ou encore le nom de la boisson, et non pas la technique de fabrication du breuvage. Le Père Labat avançait que si cette boisson était bien la préférée des Amérindiens, elle n’était pas exempte de défauts (Labat, 1724bis : 398) : « ils en font qui est terriblement forte, sur tout quand ils veulent faire quelque festin ; c’est avec cela qu’ils s’enyvrent, & que se souvenant alors de leurs vieilles querelles, il se massacrent » (Labat, 1724bis : 399). Ces descriptions des boissons ordinaires comportaient des appréciations sur le goût, l’une proche de la bière, l’autre plus proche du « meilleur poiré que l’on boive en Normandie » (Labat, 1724bis : 399) ainsi que des jugements de valeurs et moraux sur les liquides produits. Ces derniers, parfois décrits comme malfaisants, étaient en effet réservés à ceux qui n’avaient pas de vin sur leur table et à ceux qui voulaient s’enivrer « plus facilement ».
Au cours de la recherche, pour saisir la matérialité des plantes, nous avons examiné des images produites tout au long des xviie et xviiie siècles. Ces dernières offrent un point de vue européanocentré tout en nous informant des gestes et de la position sociale de ceux et celles qui utilisaient les végétaux comme le manioc.

Figure 1 : Manioc, extrait de : Charles de Rochefort, Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l'Amérique : enrichie d'un grand nombre de belles figures en taille douce, des places & des raretez les plus considerables, qui y sont décrites : avec un vocabulaire caraïbe, 1665, p.105. Source : manioc.org
Sur la figure 1, on reconnaît l’esclave par sa tenue et la couleur de sa peau. Si ce dernier paraît trop petit et la plante disproportionnée, le plant de manioc pouvait tout de même atteindre quatre mètres de hauteur, et la racine pouvait faire trente centimètres de long. Les outils que l’esclave manipulait, la râpe par exemple, laissent soupçonner à quel point son travail devait être pénible. Le but de cette technique était de retirer le plus de suc possible du manioc car « on regarde ce suc comme un poison, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les animaux qui en boivent ou qui mangent de ces racines avant que le suc en soit exprimé » (Labat, 1722 : 383). Cette toxicité n’interpelait pas vraiment Labat, qui dressait plutôt une liste de contre-poisons que le Père Du Tertre avait élaboré. Les savants du XVIIIe siècle s’appuyaient sur une philosophie simple : on pouvait trouver dans la nature tous les poisons et tous leurs antidotes. Jean-Baptiste Labat atténuait de lui-même les effets du poison dont il avait entendu parler en expliquant que les animaux s’accoutumaient au manioc petit à petit et que par conséquent il ne paraissait pas si dangereux. Il comparait cette étrange réaction du corps à la consommation d’opium des Turcs, accommodés à la toxicité de cette drogue hallucinogène. Il ajoutait : « Nos Sauvages qui en mettent dans toutes leurs sauces n’en sont jamais incommodez parce qu’ils ne s’en servent jamais que quand il a boüilli » (Labat, 1722 : 383).

Figure 2 : Les étapes de la préparation du manioc, in Jean-Baptiste Labat, Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Tome Premier, chez P. Husson, vol. 1, p. 397.
Sur l’image 2 issue du second volume de Labat est représenté le processus complexe de préparation du manioc. Cette planche dépliable est un argument visuel qui démontre la difficulté de rendre le manioc comestible, par rapport aux usages plus simples des esclaves réfugiés dans les forêts. Nous pouvons voir sur l’image un aperçu de la matérialité des gestes autour du manioc et surtout la diversité des outils mis en avant sur l’illustration : presse, grattoir, râpe à « grager », tamis, corbeille, couteau, baquet, sont mobilisés pour la production de farine alimentaire. Les observations de Labat oscillaient entre simples constatations empiriques et aveu de la maîtrise technique des Amérindiens comme des esclaves qui enchaînaient des gestes et actions bien précis. Ses remarques visuelles ou textuelles nous invitent à considérer l’objet « manioc » comme un élément d’hybridité culturelle[18], permettant de comprendre les techniques et les savoirs détenus par les différents acteurs autour de la plante : esclaves, colons, sociétés amérindiennes.
B. Deuxième exemple : Une histoire du « bois à ennyvrer les poissons », timbo ou cinchona ?
Dans une entrée de son journal de 1694, Jean-Baptiste Labat racontait le moment où il avait assisté à l’enivrement d’une rivière :
Le lendemain nous fîmes ennyvrer la grande riviere, à près de mille pas au dessus de son embouchure. […] On se sert pour ennyvrer les rivières des racines & des feuilles d’un arbre qui n’a point d’autre nom que celui de bois à ennyvrer. (Labat, 1722 : 417-418)
La « nivrée » ou « pêche au poison » est une technique traditionnelle de pêche qui a recours aux plantes toxiques pour les poissons (dites plantes ichtyotoxiques). Elle a été rapportée par les Portugais qui l’étudiaient chez la population wayana (peuple amérindien de Guyane) et l’herbe fut nommée « cipo-timbo » au Brésil dès le XVIe siècle[19]. Elle a par ailleurs été observée dans des sociétés du Pacifique et de l’Océanie ainsi que chez les chamanes des Achuar contemporains que Philippe Descola décrit dans Par-delà nature et culture. Les lianes de Guyane sont des plantes du genre Lonchocarpus et de la famille des Fabaceae tandis qu’au Brésil, les timbo sont des espèces de plantes ligneuses des genres Paullinia et Serjania, de la famille des sapindacées. Au XVIIe siècle déjà, Johannes de Laet, géographe et explorateur néerlandais, directeur de la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, décrivait le timbo comme une « admirable herbe » grimpant au sommet des arbres et dont l’écorce contenait un venin mortel capable de tuer les poissons en très peu de temps (De Laet, 1640 : 502).

Figure 3 : « Guaiana Timbo », dans Willem Piso, Gulielmi Pisonis... De Indiae utriusque re naturali et medica libri quatuordecim, apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, 1658, conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon, p.249.
Sur l’image 3, le timbo de l’ouvrage de Willem Piso, médecin de Leyde, est présenté comme un remède exotique. Le dessin figure trois longs fruits à cosse. Il s’agit de la Paullinia pinnata L., qui diffère de la Guarana ou Paullinia cupana, de la famille des Sapindacées en Amazonie brésilienne, dont le fruit est plutôt rond. Sur l’image n’apparaissaient que les feuilles et les fruits tandis que les effets du poison utilisé pour la nivrée sont expliqués dans le premier paragraphe.
Toujours est-il que la nivrée que décrivait Labat était différente et semblait plutôt inédite, selon les sources que nous avons consultées. De fait, elle nécessitait l’usage d’arbres et non de lianes. Labat, en botaniste scrupuleux, donnait des détails physiques et morphologiques de cet arbre et précisait que les esclaves qu’il possédait refusaient de s’en servir « à cause de la qualité qu’il a d’ennyvrer les poissons » (Labat, 1722 : 418). La méconnaissance du nom de l’arbre « qui n’a point d’autre nom que celui de bois à ennyvrer » montre que Labat ne cachait pas son inaptitude à déterminer si cette plante avait déjà été cataloguée dans la nomenclature botanique de son temps. Lors de notre recherche, nous avons trouvé deux plantes aux noms vernaculaires de « bois à enivrer », l’une qui fut nommée Piscidia carthagenensis Jacq. et l’autre appelée Cinchona caribaea Jacq. en 1760, espèces originaires des Antilles. Il s’agissait d’arbres qui pouvaient rester petits ou bien atteindre sept à huit mètres de haut. Contrairement à l’herbe timbo citée dès le XVIe siècle, considérée comme bois à enivrer pour son écorce, l’arbre était moins connu. Il apparaissait bien une espèce de ce bois en 1723 sous l’appellation d’« Arbre à enivrer », dit Quinquina du Pérou dans le volume 1 du Dictionnaire universel de commerce (A-E)[20], et en 1752 dans le Dictionnaire universel françois et latin de Trévoux. Le Cinchona caribaea n’avait du quinquina du Pérou que l’apparence et c’est par cette similitude qu’il fut nommé ainsi, alors qu’il ne contient en vérité aucune molécule de quinine ni de cinchonine.
C’est donc de l’écorce des racines de l’arbre que l’on tire le fameux poison après les avoir pilées avec les feuilles dans de la chaux vive. Cette drogue était l’instrument principal de la technique de pêche observée par Labat, puisqu’on en jetait dans les rivières après avoir barré le lit de cette dernière avec des broussailles et des pierres. L’étonnement de Labat est appuyé par l’expression de joie qu’il eut lors de la pêche miraculeuse : une « partie de plaisir qu’on fait assez souvent dans les Isles, & qui a ses agrémens » (Labat, 1722 : 419). Son discours nourrit l’attrait pour les voyages et les coutumes extraordinaires. Le récit de la « nivrée » servait une littérature ethnographique qui intéressait les savants européens. Cette littérature naquit de la contribution des explorateurs et plus spécifiquement des missionnaires à la constitution des savoirs anthropologiques, sur les sociétés qu’ils rencontraient lors des voyages. L’ethnographie était la méthode d’enquête sur le terrain qui s’occupait du recueil des données, textuelles ou matérielles. Il s’agissait de récolter des objets et de donner une description des lieux, des mœurs et des coutumes des populations étrangères. Les dictionnaires du XVIIIe siècle qui reprenaient la curieuse découverte du timbo, comme celui de Prévost en 1755, laissaient entendre que les propriétés des lianes/racines utilisées pour la pêche au poison n’étaient peut-être que de simples rumeurs : « On prétend que son écorce [au « timbe »], jettée dans l’eau, y fait mourir tout le poisson » (Prévost, 1755 : 484). Cette assertion montrait bien que l’idée des lianes timbo était trop lointaine pour être vérifiée, ainsi l’emploie du verbe « prétendre » illustre ici la méfiance face aux témoignages que peu de gens pouvaient alors réfuter ou confirmer.
Jean-Baptiste Labat vérifiait lesdites techniques (enivrement, culture du manioc, etc.) en développant ses propres expériences et plantations. Pour autant, sa vision de colon restait assez critique voire péjorative sur les savoirs provenant des esclaves, même si quelquefois il tirait son savoir de l’observation de ces derniers dans les jardins qui leur étaient spécialement alloués pour la culture d’ignames, de patates, de choux caraïbes et autres aliments (Labat, 1722 : 57-58).
Labat abordait aussi la question des savoirs médicinaux des Nègres ou des femmes esclaves noires dont les enfants sont ce qu’il appelait les « Mulâtres », c’est-à-dire les enfants nés d’un parent esclave noir et d’un parent blanc. Ces savoirs relevaient parfois de l’étonnement et de la crainte puisqu’il citait les « avortemens frequens que les Negresses se procuroient » (Labat, 1724bis : 125-126). Un tel savoir sur les avortements ne pouvait être étudié plus avant par le Père Labat et le détail était passé sous silence malgré l’aveu de la maîtrise adroite des simples[21] abortifs par les femmes esclaves noires. Les plantes utilisées entre le XVIe et le XVIIIe siècle étaient alors utilisées selon un système encore proche de la théorie des humeurs, un système « chaud et froid », d’origine hippocratique[22]. Dans un article sur les plantes martiniquaises, Alice Peeters[23] précise que les plantes emménagogues (qui provoquent le cycle menstruel ou le rétablit) et les plantes abortives étaient nombreuses à être connues par les femmes et le sont toujours aujourd’hui. Elle mentionne ainsi des simples comme la menthe-à-femme ou l’herbe-à-femme (Ageratum conyzoïdes L.), l’herbe-puante (Cassia occidentalis L.) et les herbes rouges dont la couleur laissait à penser qu’elles étaient efficaces pour les menstruations[24]. Le silence de Labat sur les plantes entraînant l’avortement montre ici peut-être que la transmission des connaissances qu’il était désireux de produire dans ses mémoires avait des limites que la morale de l’époque et son statut de dominicain lui imposait de ne pas évoquer ni questionner.
Conclusion
Ainsi, c’est en recueillant les détails des gestes et usages observés par Jean-Baptiste Labat que surgissent des pratiques diverses autour des plantes telles que le manioc ou le bois à enivrer. La prise en compte du contexte historique, culturel et littéraire d’une telle production d’écrits de voyage et de récits ethnologiques et botaniques semble être une clé essentielle à la compréhension des usages des végétaux par les hommes et les femmes du XVIIIe siècle. Par ce nouveau regard sur les plantes et cette approche méthodologique des sources iconographiques et textuelles des journaux et récits de voyage, nous pouvons envisager une histoire matérielle et culturelle des plantes, prises comme exemples permettant de saisir les mentalités, les usages, les techniques, les pratiques et les savoirs du XVIIIe siècle.
Néanmoins, par cette méthode et par ce type de sources, nous n’avons pu mettre en avant les usages des végétaux que le prisme du colon. Il existe aussi des incertitudes épistémologiques en ce qui concerne l’inventaire des savoirs végétaux des colonisés, esclaves ou Amérindiens, principalement lorsqu’un colon entrait en contact avec une plante déjà utilisée par des Amérindiens, et tentait de la faire entrer dans le cercle conceptuel des savoirs européens[25]. Pour Jean-Baptiste Labat les questions de la créolisation et du métissage ne se rapportaient guère qu’à des catégorisations sociales liées à la couleur de la peau et à la naissance, dont il fit des descriptions sociologiques et moralisatrices dans ses mémoires. Il évoquait ainsi les « Métifs » et les « Mulatres » ainsi que les « Creolles » sans penser ces catégories par le prisme des syncrétismes et du mélange des savoirs que nous avons aujourd’hui.
Toutefois, cette lecture de l’objet végétal sous l’angle de l’histoire « culturelle » et des métissages peut servir de point d’appui et d’appareil critique à l’examen des relations entre l’homme, la femme et les plantes, notamment dans les échanges, les transferts et bien sûr les silences de la transmission des connaissances, comme pour les plantes abortives. Cette notion des silences reste un champ d’investigation captivant, en considérant d’un côté les silences liés à la question de la morale et d’un autre côté, les silences liés à la question économique et scientifique des secrets. Le croisement de plusieurs approches culturelles, matérielles, scientifiques et de différents angles d’analyses documentaires peut servir à éclairer un passé où les traces invisibles du végétal illustrent la vie quotidienne des colons, des esclaves ou des Amérindiens.
Les cas du manioc, des lianes timbo, de l’arbre à enivrer et des plantes pour avorter que nous avons extraits des journaux de Labat ouvrent des pistes pour réfléchir à ce que pourrait être une histoire culturelle et matérielle des plantes et illustrent les liens entre l’altérité, l’esclavage, la colonisation, la botanique, dans le contexte de la réception de ces journaux, du commerce colonial, de la production et de la circulation des savoirs botaniques. Dans cette perspective, il est envisageable d’appliquer cette méthode à d’autres cas, plus connus encore, tels que le tabac, le sucre, le café, le coton, les produits tinctoriaux ou les épices importées. Il serait par ailleurs intéressant d’étudier précisément la réception de ces savoirs botaniques coloniaux par les populations natives, autochtones ou créoles dans tous les Caraïbes.
Notes de fin
[1] Lire Marcel Chatillon (1979), « Le père Labat à travers ses manuscrits », Société d’Histoire de la Guadeloupe, n°40-41-42. Université de Virginie.
[2] L’exotique était un qualificatif peu utilisé à l’époque moderne, sauf par certains lettrés comme François Rabelais. Nous utilisons le terme d’exotisme pour son acceptation analytique de « ce qui vient d’ailleurs » dans un rapport de confrontation avec « ce qui vient d’Europe ou d’Occident » et qui est regardé par le même prisme que l’orientalisme colonial d’Edward Saïd, entre autres.
[3] Lire Schiebinger, 2004.
[4] Lire Schiebinger, 2005 : 7-22.
[5] Lire « Avant-propos », in Oghina-Pavie, Taïbi, Trivisani-Moreau, 2015.
[6] Lire Marie-Noëlle Bourguet, Christian Licoppe (1997). « Voyages, mesures et instruments : une nouvelle expérience du monde au Siècle des Lumières », Annales, 52-5 : p. 1115-1151.
[7] Juhé-Beaulaton (2018).
[8] Lire Serge Gruzinski (2011). Les Quatre parties du monde : histoire d’une mondialisation. Paris : éditions de La Martinière : 20.
[9] Yves Charbit (2006). « Les colonies françaises au xviie siècle : mercantilisme et enjeux impérialistes européens », Revue européenne des migrations internationales, vol. 22 - n°1 : 183-199.
[10] Selon Pomata et Siraisi (2005).
[11] Les relationnaires sont ceux qui relatent leurs voyages et explorations sous le format textuel de la « relation » de voyage.
[12] Labat, 1724 : 302-303.
[13] Lire Marie-Noëlle Bourguet, Christian Licoppe (1997). « Voyages, mesures et instruments : une nouvelle expérience du monde au Siècle des Lumières ». Annales, n°52-5 : 1115-1151.
[14] Martin, 1754 : 83.
[15] Dans Estorniolo, Milena (2018). « Prendre soin des maniocs et séduire les poissons. Conservation et partage d’aliments chez les Baniwa (Amazonie, Brésil) ». Techniques & Culture, vol. 69, n° 1 : 148-151.
[16] Pinton, Florence (2003). « Savoirs traditionnels et territoires de la biodiversité en Amazonie brésilienne ». Revue internationale des sciences sociales, vol. 178, no. 4 : 667-678.
[17] Voir Bethwell A., Ogot (1999). L’Afrique du xvie au xviiie siècle. Ed. UNESCO : 584 et 618.
[18] Nous utilisons l’expression « hybridité culturelle » comme une grille analytique née des études postcoloniales et transculturelles, dont nous pensons qu’elles sont pertinentes pour cet article. Lire Jeannotte Marie-Hélène (2010). « L’identité composée : hybridité, métissage et manichéisme dans La saga des Béothuks, de Bernard Assiniwi, et Ourse bleue, de Virginia Pésémapéo Bordeleau ». International Journal of Canadian Studies, n°41 : 297-312.
[19] Jacques Savary des Brûlons. Dictionnaire universel de commerce (A-E). Chez Jacques Estienne : 128.
[20] En créole, il s’agit d’une « liane carré », dite « kahapta » ou « kutupu » en wayana, « cururu-ape » ou « cipo-timbo » en portugais. Lire « S-Z (Sapindaceae à Zingiberaceae) ». Dans, (2004) Pharmacopées traditionnelles en Guyane : Créoles, Wayãpi, Palikur. Marseille : IRD Éditions.
[21] Un simple est une plante aux vertus médicinales.
[22] La théorie hippocratique est une doctrine médicale née dans l’Antiquité et basée sur le fonctionnement du corps et du monde selon les quatre éléments terre, eau, air et feu, et les quatre qualités qui leur sont attribuées : chaud, sec, froid et humide.
[23] Voir Peeters Alice (1976). « Le petit paysannat martiniquais et son environnement végétal. Recherches en cours ». Dans, Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée, vol. 23, n°1-3 : 47-56.
[24] Les plantes comme la menthe consommée à haute dose pouvait entraîner de graves accidents vasculaires et de sérieuses atteintes à la santé. Lire « L’avortement en Amérique latine et dans la Caraïbe », Une revue de la littérature des années 1990 à 2005.
[25] Lire Boumediene (2016).
Bibliographie
Anonyme (1727). Mémoires pour l’Histoire des sciences et des Beaux Arts. Journal des beaux-arts et des sciences. Volume 306. Trevoux : Chez les Frères Bruyset, Libraires, ruë Merciere, au Soleil.
Boumediene Samir (2016). La colonisation du savoir : une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750). Vaulx-en-Velin : Éditions des Mondes à faire.
De Laet Johannes (1640). L'histoire du nouveau monde ou description des Indes occidentales, contenant dix-huict livres ... enrichi de nouvelles tables geographiques et figures animaux, plantes et fruicts. Elsevirs.
De La Porte Joseph (1747). Catalogue d’un cabinet de livres choisis. Chez les Frères Duplain, Libraires.
De Rochefort Charles (1665). Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l'Amérique : enrichie d'un grand nombre de belles figures en taille douce, des places & des raretez les plus considerables, qui y sont décrites : avec un vocabulaire caraïbe. Roterdam : Chez Arnout Leers.
Des Bruslons Jacques Savary (1742). Dictionnaire Universel De Commerce. Contenant Tout Ce Qui Concerne Le Commerce Qui Se Fait Dans Les Quatre Parties Du Monde, par terre, par mer, de proche en proche, & par des voyages de long cours. Cramer.
Ebert Christopher (2011). « From Gold to Manioc: Contraband Trade in Brazil during the Golden Age, 1700-1750 », Colonial Latin American Review, Vol. 20, n°1 : 109-130.
Holtz Grégoire, Masse Vincent (mai 2012). « Étudier les récits de voyage. Bilan, questionnements, enjeux », La littérature de voyage, Revue Arborescences, n°2.
Juhé-Beaulaton Dominique, Leblan Vincent (2018). « Introduction ». Dans, Le spécimen et le collecteur : Savoirs naturalistes, pouvoirs et altérités (xviiie-xxe siècles). Paris : Publications scientifiques du Muséum.
Juhé-Beaulaton Dominique (2014). « De l’igname au manioc dans le golfe de Guinée : traite des esclaves et alimentation au royaume du Danhomè (XVIIe-XIXe siècle) », Afriques, n° 05 [URL : http://journals.openedition.org/afriques/1669 Consulté le 19/03/2021].
Labat Jean-Baptiste (1722). Nouveau voyage aux isles de l'Amérique. T. 1, contenant l'histoire naturelle de ces pays, l'origine, les moeurs, la religion et le gouvernement des habitans anciens et modernes, les guerres et les événemens singuliers qui y sont arrivez... le commerce et les manufactures qui y sont établies... Paris : Chez Guillaume Cavelier.
Labat Jean-Baptiste (1724). Nouveau Voyage aux isles Françoises de l'Amérique, volume II. A la Haye : P. Husson et J. Van Duren.
Labat Jean-Baptiste (1724bis). Nouveau voyage aux isles de l'Amerique, Tome Premier. chez P. Husson, T. Johnson. P. Gosse. J. Van Duren. R. Alberts, & C. Levier.
Le Long Jacques, De Fontette Charles (1771). Bibliothèque Historique De La France. Contenant Le Catalogue des Ouvrages, imprimés & manuscrits, qui traitent de l'Histoire de ce Royaume, ou qui y ont rapport : Avec Des Notes Critiques Et Historiques. Herissant.
Martin Gabriel (1747). Catalogue des livres et estampes de defunts M[essieu]rs. Geoffroy, de l'Académie royale des sciences dont la vente se fera en détail le 5 fevrier 1754 & jours suivans, rue Bourtibourg. Chez Gabriel Martin.
Oghina-Pavie Cristiana, Taïbi Aude-Nuscia, Trivisani-Moreau Isabelle (2015). « Avant-propos ». Traces du végétal. Angers : Presses universitaires de Rennes.
Pomata Gianna, Siraisi Nancy G. (2005). Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern Europe. Cambridge : The MIT Press.
Prévost Antoine-François (1755) Manuel lexique, ou dictionnaire portatif des mots françois dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Tome Premier. Paris : Chez Didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d’Or.
Prévost Antoine-François (1759) Histoire générale des voyages, ou, Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre (…), Volume 59. Chez Didot.
Roche Daniel (2011). Les circulations dans l'Europe moderne : xviie-xviiie siècle. Paris : Fayard.
Sabatier De Castres Antoine (1779). Les trois siècles de la littérature françoise, ou tableau de l'esprit de nos écrivains. Chez Moutard, Imprimeur-Libraire de la Reine, de Madame, & de Madame Comtesse D'Artois, rue des Mathurins, Hôtel de Cluny.
Schiebinger Londa (2004) Plants and Empire. Colonial Bioprospecting in the Atlantic World, Cambridge (Mass.) & Londres : Harvard University Press.
Schiebinger Londa (2005) Colonial Botany. Science, Commerce, and Politics in the Early Modern World. Philadelphia : University of Pennsylvania Press.
Pour citer cet article
Tassanee Alleau, « Exemples d’exploration de la matérialité des plantes dans les récits de Jean-Baptiste Labat (XVIIe - XVIIIe siècle) », RITA [en ligne], n°14 : septembre 2021, mis en ligne le 23 septembre 2021. Disponible en ligne: http://www.revue-rita.com/articlesvaria14/exemples-d-exploration-de-la-materialite-des-plantes-dans-les-recits-de-jean-baptiste-labat-xviie-xviiie-siecle-tassanee-alleau.html



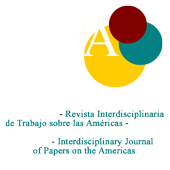




 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8