Equal Rights Amendment : près d’un siècle de (sur)vie d’un combat pour l’égalité
Equal Rights Amendment: The life and survival of an age-long struggle for equality
Résumé
Le 30 mai 2018, les élus de l’assemblée de l’État d’Illinois donnèrent un nouveau souffle à un projet d’amendement constitutionnel vieux de près d’un siècle. Ce fut à l’occasion de la ratification passée relativement inaperçue en dehors des États-Unis de l’ERA (Equal Rights Amendment). Introduit en 1923 après l’obtention du droit de vote des femmes, ce projet vise à inscrire l’égalité femmes-hommes dans la Constitution américaine. Cette 37e ratification par l’État d’Illinois donne tout lieu de croire que l’ERA est potentiellement le futur 28e amendement. Bien que son adoption définitive ne soit pas encore acquise, cette ratification n’en reste pas moins importante surtout dans une période de renouveau du mouvement féministe américain. L’ERA ressurgit aussi à l’heure où Donald Trump et son administration essaient de détricoter les droits des femmes en remettant en cause certains de leurs acquis. Cet article interroge les circonstances dans lesquelles le projet d’amendement fut lancé ainsi que les débats qu’il a suscités. La réflexion porte aussi sur les multiples rebondissements du débat autour de l’ERA et les enjeux passés et actuels de ce projet égalitaire au moment où l’administration américaine essaie de mettre en pratique un agenda antiféministe assumé par un parti républicain devenu au fur du temps hostile à toute idée d’égalité.
Mots clés : ERA ; Ratification ; Féminisme ; Egalité ; Antiféminisme.
Abstract
On May 30, 2018, the Illinois State Legislature members gave new momentum to a bill that is almost one hundred years old. They did so by passing the ERA (Equal Rights Amendment) bill, an event that went relatively unnoticed outside the USA. The bill had been first introduced in Congress in 1923 following the passing of the woman suffrage Amendment in 1920. It aimed at including gender equality in the country’s Constitution. The 37th ratification by Illinois Legislature leads anyone to believe that the ERA is potentially the XVIIIth Amendment. Although the final vote of the ERA is not really won yet, the fact is that this ratification is all the more important that it happens in a period when the American feminist movement is in a process of revitalization. The ERA appears again at the very moment when Donald Trump and his administration are trying to deny women’s rights by questioning some of their political gains. This article examines the circumstances under which the bill was launched, and the debates it raised. The analysis also focuses on the unexpected developments the ERA gave way to, and on the past and current issues that are encompassed by such an equalitarian project. The latest ratification coincides with attempts by the Trump administration to put into practice an overtly antifeminist agenda that the Republican Party has been identifying itself with, which made it more and more hostile to any idea relating to equality.
Keywords : REA; Ratification; Feminism; Equality; Antifeminism.
------------------------------
Salian Sylla
Docteur en anglais
Université Paris Nanterre
Equal Rights Amendment : près d’un siècle de (sur)vie d’un combat pour l’égalité
Introduction
Le mercredi 30 mai 2018, par un vote de 72 voix pour et 45 contre, la chambre basse de l’assemblée d’État de l’Illinois décidait de ratifier l’ERA (Equal Rights Amendment), visant à inscrire l’égalité femmes-hommes dans la Constitution américaine (State of Illinois, 2018). Par ce vote historique, l’Illinois devenait le 37e État américain à adopter ce projet d’amendement introduit plusieurs décennies auparavant auprès du Congrès. La nouvelle arrivait comme une éclaircie dans le ciel bien chargé d’un féminisme américain plus que jamais sur la sellette depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Il ne reste donc plus qu’un État pour que l’ERA devienne le XXVIIIe amendement à la Constitution américaine. Cette décision emblématique intervient alors que ce vieux projet avait fini par tomber dans l’oubli, tant il était devenu difficile d’atteindre le quorum exigé, c’est-à-dire trois-quarts des États. L’histoire du pays est donc à nouveau convoquée par cet évènement éclipsé la nouvelle lutte contre l’immigration engagée par l’administration Trump.
Le premier acte en direction de l’ERA survint en 1923, trois ans après la ratification du XIXe amendement qui garantissait le suffrage féminin. Dans la foulée de son adoption en 1920, Alice Paul (1885-1977), figure marquante du combat des femmes et dirigeante du National Woman’s Party (NWP), déclarait en 1923 au cours de la célébration du 75e anniversaire de la première Convention des femmes américaines à Seneca Falls en 1848 son intention d’introduire un projet.
L’idée d’une égalité des droits était défendable à plus d’un titre : la majorité des femmes venait d’entrer dans la vie civique et il fallait désormais aller plus loin en s’attaquant à certaines inégalités encore prégnantes dans la société américaine. Le monde du travail offrait une parfaite illustration de ces déséquilibres. En 1920, sur une population de 106 021 537 habitants et un nombre d’actifs s’élevant à 41 236 185 travailleurs, elles étaient 8 429 707 à travailler, soit 20,44 % des effectifs au plan national. Plus significatif encore : 23,3 % des femmes de 14 ans et plus avaient un emploi salarié (The United States Women's Bureau, 1947). Malgré ces progrès, les femmes ayant un travail salarié restaient cantonnées dans les secteurs qui leur étaient traditionnellement réservés, avec des salaires beaucoup plus bas, et étaient souvent considérées comme des variables d’ajustement dans les moments de crise comme à la fin des années 1920 [1]. En outre, certains secteurs restaient hostiles qui y subissaient une discrimination qui s’articulait autour du mariage (hire bar) et du célibat (retention bar) [2]. Assurément, les revendications des femmes américaines ne se résumaient pas à l’emploi. Ainsi, des sujets comme le mariage, le divorce, la garde des enfants, la contraception ou encore la durée du temps de travail, restaient plus que jamais d’actualité dès l’acquisition du suffrage. La réponse à toutes ces interrogations dépendait en partie de la réactivité d’une partie de la société alors marquée par le patriarcat.
Nonobstant tous les arguments qui plaidaient largement en faveur de l’égalité qu’elles réclamaient, Alice Paul et ses camarades n’obtinrent pas gain de cause car les élus du Congrès s’empressèrent de rejeter le projet d’amendement. D’ailleurs, à quelle égalité Alice Paul et ses camarades pouvaient-elles aspirer et pour quelles femmes la revendiquaient-elles ? Quels obstacles internes se posaient sur le chemin de l’égalité réclamée par Alice Paul et ses camarades activistes du NWP ? Pourquoi l’ERA peine-t-il encore à se concrétiser au niveau des États au vote duquel il est encore soumis ? Quels changements ce projet qui date de près d’un siècle peut-il encore apporter au quotidien des Américaines à l’heure d’un regain d’intérêt pour les revendications féministes ?
I. Angle mort d’une idée d’égalité
Le rejet du projet d’amendement par le Congrès était prévisible en l’absence d’une campagne dûment menée au sein des organisations féministes, qui s’étaient pour certaines volontairement sabordées ou réorientées dès la victoire de 1920. Ainsi, la NAWSA (National American Woman Suffrage Association), s’était transmuée en League of Women Voters et ses dirigeantes historiques, comme Carrie Chapman Catt ou Anna Howard Shaw, avaient pratiquement disparu de la scène publique.
D’ailleurs, quelle était le bien-fondé d’une revendication égalitaire puisque le NWP s’était plusieurs fois illustré par des pratiques racistes, notamment à l’encontre des femmes noires reléguées en bordure des cortèges lors de manifestations ou refoulées pendant les conventions annuelles de l’organisation (Terborg-Penn, 1998) ? Cette tradition de l’invisibilisation permettait de ne pas compter les femmes noires comme composante à part entière du mouvement féministe. Ainsi de cette délégation d’une soixantaine de militantes afro-américaines qui se rendit à Washington en février 1921 dans le cadre de la convention annuelle du NWP. Elles entendaient obtenir le soutien de l’organisation dans le cadre d’une action en faveur des femmes noires du Sud exclues du vote malgré l’adoption du XIXe amendement. Elles espéraient parvenir à faire voter une résolution condamnant l’injustice criante dont elles avaient réuni les preuves :
Nous ne pouvons donc nous résoudre à croire que vous puissiez permettre que [le XIXe] amendement soit foulé aux pieds dans son interprétation, au point de perdre toute crédibilité dans son application. Cinq millions de femmes américaines ne peuvent être privées de leurs droits sans que toutes les femmes américaines ressentent les effets de cette injustice. Aucune femme ne sera libre tant que toutes ne seront pas libres. (Kirchwey, 1921 : 332)
En paraphrasant Marx, qui préconisait au XIXe siècle la solidarité ouvrière avec les esclaves comme préalable à la disparition de l’esclavage, les militantes afro-américaines pensaient pouvoir compter sur un soutien de l’organisation d’Alice Paul. La radicalité dont les membres de la défunte Congressional Union (ancêtre du NWP) avaient fait preuve dans le passé en usant de tactiques militantes héritées de l’expérience d’Alice Paul et de Lucy Burns (1879-1966) lors de leur séjour en Angleterre aux côtés d’Emmeline Pankhurst ou de Flora Drummond, s’était quelque peu estompée. Les deux étudiantes avaient alors entrepris d’importer les techniques de lutte des suffragettes anglaises. Dès le mars 1913, la première grande marche des femmes fut organisée sur Washington à l’occasion de la prise de pouvoir de Woodrow Wilson, nouvellement élu président. Ce jour-là, des milliers de militantes prirent d’assaut la Pennsylvania Avenue pour rappeler à Wilson leur revendication (Women’s Journal and Suffrage News, 1913). La lutte des femmes entra dès lors dans une nouvelle phase. Elle s’exprimait désormais à travers des occupations de lieux publics ou picketings, une interpellation publique des élus, des campagnes contre les candidats opposés au vote féminin ou encore des grèves de la faim. Tout ceci contribuait à exposer les militantes à des arrestations violentes, mais attirant davantage de sympathie pour leur cause.
Après l’obtention du vote par la grande majorité des femmes du pays, les priorités avaient bien changé en cet hiver 1921 quand les déléguées afro-américaines insistèrent pour se faire entendre à la convention du NWP : « L’attitude d’Alice Paul et de ses soutiens vis-à-vis de ces trouble-fête ─ militantes noires comme activistes du contrôle des naissances ─ était celle de toutes les autorités établies. » (Kirchwey, 1921 : 333)
Bien plus marquante est la nouvelle posture du NWP devenu adversaire de ses alliées potentielles :
Pourquoi ces personnes nous harcèlent-elles ? demanda Alice Paul. Pourquoi veulent-elles saboter notre convention ? » La réponse qui ne lui traversa jamais l’esprit, était la suivante : « Pour les mêmes raisons qui vous ont poussée à troubler l’ordre public et à harceler les autorités de la façon particulièrement efficace mais irritante que vous aviez à l’époque. (Kirchwey, 1921 : 333)
L’ironie de la situation tient en un seul fait : Alice Paul et ses camarades se retrouvent ici dans la même situation que les autorités qu’elles dénonçaient et vouaient aux gémonies quelques années plus tôt avec la même technique d’occupation des rassemblements de candidats ou de conventions de partis. Mais l’organisation était maintenant dans une logique de défense d’un ordre qu’elle n’avait pourtant eu de cesse de dénoncer par le passé. Militante du NWP, Ella R. Murray n’avait pas la même analyse de la question des femmes encore laissées en marge du vote :
J’ai réussi à mettre sur la table de la Convention une motion afin que le rapport majoritaire de la Commission des Résolutions soit amendé de la façon suivante : « Attendu que la Commission des Résolutions propose que le nouveau NWP nomme un comité spécial dans le but de pousser le Congrès à ouvrir une enquête sur les cas de violation de l’esprit et de la lettre du XIXe amendement à travers des stratégies d’esquive ou de contournement de la loi électorale au niveau local. » La motion était soutenue par plusieurs déléguées, mais a été mise en échec par une courte majorité. (Murray, 1921 : 260)
Nul doute que le peu d’enthousiasme, voire l’hostilité avec lesquels Alice Paul avait accueilli la délégation afro-américaine à la veille de la convention, expliquait en partie l’échec de cette initiative qui n’eut pas la chance de bénéficier de son soutien. Au demeurant, cette défaite n’était qu’une nouvelle occasion manquée chez les suffragists de se montrer solidaires de leurs sœurs afro-américaines, angle mort des revendications féministes dans presque toute l’histoire du féminisme américain. (Newman, 1999). Ceci traduisait d’ailleurs davantage les contradictions inhérentes non seulement au NWP mais à toute une époque tournée vers la célébration d’un acquis (le suffrage) dont la validité reposait aussi sur l’abandon d’un principe d’égalité pour toutes. Plus précisément, la décision du NWP répondait, semble-t-il, à une question stratégique en direction des États du Sud régis par un système de ségrégation raciale : « Une militante du Sud a confié à un soutien actif des femmes de couleur […] que le NWP s’était engagé à ne pas soulever la question raciale dans le Sud ; c’était le prix à payer pour la ratification [du XIXe amendement]. » (Kirchwey, 1921 : 333)
Les principes qui faisaient encore le bien-fondé de l’existence même de l’organisation se voyaient sacrifiés sur l’autel des calculs stratégiques, ce qui revenait à renvoyer la question du droit pour toutes les femmes à des considérations assez éloignées des préoccupations de l’heure. En effet, pour le NWP, la question du vote des femmes noires relevait moins du genre que de l’appartenance ethno-raciale. Les Afro-américaines étaient encore privées de vote non pas parce qu’elles étaient femmes, mais parce qu’elles étaient noires. C’est par un contournement discursif de même nature que l’organisation jugeait la question de la contraception insuffisamment féministe et l’excluait de sa plateforme qui tenait en un seul mot d’ordre : éliminer les derniers obstacles à l’avènement d’une égalité femmes-hommes. (Cott, 1984) Mais au-delà de cette invisibilisation des femmes noires dans le NWP, l’ERA posait encore d’autres difficultés.
II. Querelles dans les rangs et désaccords en-dehors du NWP
L’ERA dont le NWP était le porte-étendard était loin de faire l’unanimité parmi les militantes de l’organisation. À l’occasion de la Convention de réorientation de février 1921, il fut largement débattu, mais aussi déjà farouchement combattu. Le débat se poursuivit au sortir des discussions en l’absence de consensus au sein du mouvement. Ainsi, Florence Kelley, membre active du NWP, mais aussi dirigeante de la National Consumers’ League, se démarquait des positions de certaines intervenantes. Elle le fit savoir dans un courrier à Elise Hill, nouvellement élue à la tête du comité exécutif de l’organisation : « Hurler Égalité, Égalité quand il n’y a point d’égalité, quand la nature elle-même a créé des inégalités physiques permanentes, peut quand même être aussi stupide et cruel que de crier Paix, Paix quand il n’y a guère de paix. » (Sklar & Palmer, 2009 : 203)
Cette égalité proclamée posait d’autant plus problème à Kelley qu’elle était elle-même engagée sur le front des batailles sociales (égalité salariale, journée de huit heures) en vue de l’amélioration des conditions de vie des femmes mais l’envisageait autrement. Comme pour illustrer les désaccords et les interrogations au sein du NWP, Florence Kelley et Elise Hill signèrent une tribune qui se terminait par une série de questions à l’attention de la direction de l’organisation :
Est-ce que le NWP est pour ou contre des mesures de protection pour les femmes salariées ? Se prononcera-t-il publiquement sur les huit heures de travail hebdomadaires et des négociations sur le salaire minimum pour les femmes ? Se prononcera-t-il publiquement sur les huit heures de travail hebdomadaires et des négociations sur le salaire minimum pour les femmes ? Oui ou non ? Non ? (Kelley et Hill, 1922)
En martelant ces questions, les deux militantes entendaient mettre le NWP en demeure de clarifier sa position sur une problématique cruciale pour le présent des travailleuses. Les interrogations subsistaient aussi en-dehors du NWP car aussi bien la très active National Women’s Trade Union League, que la très célèbre Woman’s Christian Temperance Union (qui rendit effective la Prohibition) ou que la très sélective General Federation of Women’s Club, avaient des arguments pour corroborer leurs récriminations à l’encontre du projet. (Cott, 1984)
C’est en partie pourquoi des lois de protection des femmes travailleuses furent mises en place pour assurer la sécurité de cette catégorie de travailleuses perçues comme particulièrement vulnérables. C’est au nom de ces avantages que le parti communiste américain (PCUSA), bien que prônant la solidarité des classes laborieuses et l’égalité, s’opposa dès les années 1930 à l’ERA jugé défavorable aux droits des travailleuses. C’est ainsi qu’il lança, en compagnie d’autres organisations comme la LWV (League of Women Voters), la NCL (National Consumers’ League), ou l’YWCA (Young Women's Christian Association) une initiative dénommée Women’s Charter Campaign destinée à offrir une alternative pus clairement tournée vers la classe ouvrière féminine. Dirigée par Mary van Kleeck alors plus connue pour ses actions à la faveur du Women’s Bureau dont la création dans les années 1920 permettait de mieux cerner les questions de genre dans le monde du travail, cette campagne offrait en 1936 des garanties explicites pour les droits des femmes :
Partout où il y aura une exploitation spéciale des femmes travailleuses comme de bas salaires qui ne garantissent pas le minimum de subsistance, des conditions de travail dégradantes, ou de longues journées de travail, toutes choses qui conduisent à un épuisement physique et à la négation du droit au repos. De telles conditions corrigées à travers le vote de mesures sociales et de réformes dont la nécessité n’est plus à démontrer à travers le monde. (Christman, 1936 : 1)
L’argumentaire ne se contentait pas de prôner une égalité purement formelle, mais spécifiait la correction des cas d’inégalités par des dispositifs particuliers en faveur des femmes. Le parti communiste misait sur cette initiative pour servir de rempart contre la montée d’un fascisme divisant les travailleurs en fonction du genre et de l’origine ethnique (Lynn, 2014 : 707). Mais au-delà du parti communiste, l’ERA continua de diviser pendant longtemps les militantes, les organisations de femmes ou les figures féministes les plus connues. (Steiner, 1985 : 10) Cette division était symptomatique de la bataille entre les féministes et leurs adversaires au sujet de questions allant bien au-delà de l’égalité. Il s’agissait aussi de revendiquer de nouveaux droits comme ceux relatifs à la contraception, à la redéfinition des termes du mariage et du divorce, toutes choses qui touchaient à la conception même de la famille et des relations matrimoniales. Les oppositions furent à la mesure des peurs et souvent des fantasmes (suppression de la séparation des toilettes entre hommes et femmes, légalisation du viol), que ce projet ne manqua pas d’engendrer au cours des décennies.
Pour toutes ces raisons, et nonobstant l’enthousiasme suscité au sein d’une partie du NWP par le projet d’amendement Mott, les élus n’eurent aucune difficulté à le rejeter une fois la demande introduite auprès du Congrès en 1923. Il s’ensuivit une bataille de près d’un demi-siècle au Congrès où chaque nouvelle session se prononça sur la question de l’ERA qui ne put pourtant jamais réunir le nombre de votes requis pour faire l’objet d’un projet d’amendement en bonne et due forme. (Neale, 2013 : 4)
L’ascension fulgurante d’une nouvelle vague féministe représentée par de nouvelles organisations comme la NOW (National Organization for Women, créée en 1966) y contribua de façon décisive, ce qui accéléra davantage la marginalisation d’un NWP alors en perte de vitesse. Il fallut donc attendre le 22 mars 1972 pour voir le Congrès adopter définitivement, et par un vote massif, le principe d’un amendement sous condition de ratification par les États. Les termes dudit texte, bien que généraux, constituaient une réelle avancée pour l’ensemble des militantes :
Article 1 : L’égalité des droits devant la loi ne sera pas niée ou amendée par les États-Unis ou par l’un des États qui les composent sur la base du sexe.
Article 2 : Le Congrès aura le pouvoir d’appliquer par une législation appropriée, les dispositions du présent article.
Article 3 : L’amendement prendra effet deux années après la date de ratification (House of Representatives, 1972).
En insistant sur une égalité effective entre femmes et hommes, ce projet se voulait un prolongement de l’acquisition du vote, insuffisante à éliminer les nombreux effets d’une domination masculine encore prégnante dans la société américaine. Mais cette égalité revendiquée soulevait déjà une opposition parmi les femmes.
III. D’avancées en reculs : du sort improbable d’un projet
Suivant un mouvement souvent oscillatoire permanent entre résurgence de forces progressistes et renaissance conservatrice, la vague contestataire des années 1960 et le sursaut féministe avec la création de la NOW en 1966, donnèrent l’occasion à une forte mobilisation des militantes défendant un agenda de type conservateur et traditionnaliste. L’opposition d’une partie de la société à l’idée d’égalité se traduisit donc par un affrontement de plusieurs décennies dont l’aboutissement fut l’échec paradoxal des féministes de la deuxième vague, et le reflux non moins surprenant de la dynamique favorable à l’adoption définitive de l’ERA.
La fin des années 1960 et le début des années 1970 furent des moments forts du débat suscité par l’ERA dans la société américaine. Deux visions d’une société plus que jamais clivée s’affrontaient à l’heure de l’opposition à la guerre du Vietnam. (Zinn, 1980 : 491) D’une part, les tenants de l’ERA retrouvaient une certaine vitalité depuis l’émergence d’un réformiste tourné vers la gauche de l’échiquier. De l’autre, le courant conservateur se remobilisait autour de la défense d’un modèle de société présenté comme naturel et immuable menacé par les mouvements féministes.
A. Phyllis Schlafly, rempart antiféministe
Phyllis Schlafly (1924-2016) symbolisait à elle seule l’hostilité à toute forme d’égalité. Juriste de formation et militante très tôt engagée dans la politique, elle s’imposa très vite dans le camp conservateur comme figure de l’opposition à l’ERA. Alors que le Congrès relançait le débat sur l’ERA en 1972 en approuvant le projet ouvrant la voie à une série de ratifications [3], l’égérie conservatrice lançait une nouvelle organisation nommée STOP (Stop Taking Our Privileges) ERA. Schlafly se voulait désormais l’égérie d’un nouvel antiféminisme conservateur dont elle était également porte-parole :
La loi exige du mari qu’il prenne en charge sa femme autant que sa situation financière le permet, mais la femme n’est pas obligée de subvenir aux besoins de son mari (à moins qu’il soit menacé de recourir à l’assistance publique). Un mari ne peut pas obliger sa femme à travailler pour participer aux dépenses de la famille. C’est lui qui a la responsabilité d’entretenir la famille selon la loi et les usages. Pourquoi devrions-nous abandonner ces lois qui obligent le mari à entretenir femme et enfants juste pour voir la femme avoir une « égale » obligation de trouver du travail ? (Schlafly, 1972 : 3)
La vieille antienne qui opposait espace public et espace privé et qui définissait le deuxième comme sphère dévolue aux femmes revenait brutalement ainsi dans le débat à la faveur du postulat d’un devoir naturel des hommes de nourrir et d’entretenir épouses et enfants. Schlafly revendique donc une division immuable du rôle dévolu aux genres dans la société. C’est pourquoi la famille, le foyer et l’opposition à l’avortement (pro-life) étaient d’ailleurs le triptyque sur lequel reposait l’argumentaire de ces militantes dont la plus grande réussite, sous la houlette de Schlafly, fut alors de remobiliser l’électorat de droite sur ses thématiques habituelles :
C’est contre la famille, contre les enfants et pour l’avortement […] Elles voient la maison comme une prison, et la femme et la mère comme des esclaves. Pour ces féministes, mariage rime avec vaisselle sale et linge sale. Un de leurs articles salue le refus d’une femme de faire la lessive pour la famille et y voit un « acte de courage suprême ». Un autre nous apprend à quel point il est agréable d’avoir une vie de lesbienne. (Schlafly, 1972 : 3)
En caricaturant la pensée de ses adversaires à dessein, Schlafly assumait ses idées au milieu des revendications égalitaires perçues comme socialistes, adjectif disqualifiant en cette pleine Guerre froide. Alors que la Cour suprême venait d’apporter un argument de plus aux militantes de l’égalité par sa décision favorable à l’avortement de 1973 (Roe vs. Wade), les militantes de STOP ERA tentèrent de discréditer l’ERA devant une opinion divisée et des féministes pourtant revigorées par un arrêt qui tranchait (provisoirement) la question de l’avortement en leur faveur [4]. Schlafly n’hésita pas, en novembre 1977, alors que les regards étaient tournés vers Houston au Texas où se tenait une grande (et très officielle) Conférence nationale des femmes (National Women’s Conférence), à organiser une contre-conférence pour exposer son point de vue sur la famille, l’avortement et l’égalité telle que promue par l’ERA qui devint un des pôles d’attraction des deux rencontres. (Kenney, 1979)
Malgré donc le regain de dynamisme qu’a connu l’ERA dans les années 1970 et la ratification de l’amendement dans de nombreux États, il ne put jamais atteindre la barre fatidique des trente-huit ratifications. Cet échec est en partie dû au fait que, malgré les victoires remportées çà et là, la poussée féministe de cette période ne résista pas longtemps aux assauts d’une révolution conservatrice dont le point d’orgue fut l’arrivée de Reagan au pouvoir. Pourtant, l’ERA, tel un serpent de mer, revenait sur le devant de la scène à chaque fois. Pendant trois décennies, les avancées et les régressions se succédèrent, les rebuffades laissèrent place aux rebondissements d’un État à l’autre. La justice, quand elle était interpellée, donnait des avis contradictoires selon le cas, le contexte et bien entendu, la composition et les convictions politiques des membres de la Cour suprême fédérale [5].
La ratification de l’ERA connut plusieurs rebondissements une fois l’épreuve du Congrès franchie. Cette ratification devait se faire dans un délai de sept ans. À l’expiration de cette échéance le 22 mars 1979, le Congrès décida de le reconduire jusqu’en 1982, mais à l’issue d’un nouveau prolongement, seuls trente-cinq États avaient adopté l’amendement. Alors que la question de la limitation du temps se posait de nouveau, l’adoption définitive du XXVIIe amendement introduit par James Madison en 1789 et adopté seulement 202 ans plus tard, en 1992 ! Ce cas fit jurisprudence pour le sénateur Ted Kennedy qui, dès 1993, décida de relancer la question de la limitation temporelle concernant l’ERA. Cette initiative sauva de nouveau l’ERA d’une mort certaine. Depuis, aucun État n’est venu compléter la liste des trente-cinq ayant déjà adopté le texte, jusqu’au 15 mars 2017 quand le Nevada signa à son tour le texte, devenant ainsi le trente-sixième État à approuver l’ERA, plus de quarante ans après la dernière ratification.
B. Ultime sursaut ou dernier soubresaut ?
Assurément, les conditions de vie des femmes américaines ont bien changé depuis l’introduction de l’ERA auprès du Congrès en 1923. Pourtant, à l’heure où les élus de l’État décident de donner leur approbation à l’ERA, certaines questions sont encore d’une brûlante actualité. En effet, les écarts de salaire, malgré les progrès réalisés depuis plusieurs décennies, continuent de pénaliser les femmes. L’entrée remarquée de 127 femmes au Congrès – 106 démocrates et 21 républicaines, soit un total de 23,4 % du nombre total d’élus – à l’issue des élections de mi-mandat de novembre 2018 entraîna des commentaires enthousiastes (Center for American Women and Politics, 2017). Pourtant, ce chiffre montre à lui seul le chemin qui reste à parcourir dans une démocratie représentative. En outre, il y eut le récent tumulte mondial suscité par les révélations sur le comportement de pontes d’Hollywood, de personnalités publiques du monde politique ou médiatique. Ceci est révélateur de la survivance des vieux rapports de subordination entre hommes et femmes, mais aussi de la surreprésentation masculine encore persistante dans les instances décisionnelles du pays, sont deux illustrations d’une réalité indéniable à même de susciter une question. Au regard de tout cela, la nature même de la domination masculine peut-elle être bouleversée par le vote d’un amendement dont la portée devrait, si l’on en croit certains responsables politiques, au mieux rester symbolique ? Au lendemain de la ratification de l’ERA décidée le 21 mars 2017 par l’État du Nevada, l’élue républicaine Robin L. Titus, qualifia le vote de « vaudeville politique » (political theatrics) et de « vote symbolique ou d’un scrutin autour d’un scrutin concernant une législation sociale résolue de longue date ». (Richardson, 2017) Quant à sa collègue républicaine Jill Tolles, seule élue de son parti à l’assemblée à avoir approuvé la ratification, elle expose une autre vision du caractère symbolique de l’ERA :
Je dirais que cette chambre est remplie de symboles […]. Je porte à ma main gauche une bague qui symbolise ma promesse d’amour, de respect et de fidélité à un homme pour le reste de ma vie. Nous nous tenons sous un sceau qui nous rappelle que nous sommes un État gagné de haute bataille qui veut dire Nevada. Nous prêtons allégeance à un drapeau chaque jour pour célébrer la liberté pour laquelle nous nous sommes battus si vaillamment. (Richardson, 2017)
Le GOP (Grand Old Party) étalait au grand jour ses contradictions internes au sujet de l’égalité qui fut pourtant introduite au Congrès par deux de ses élus, le sénateur Charles Curtis et le représentant Daniel R. Anthony Jr., tous deux du Kansas. Le temps était désormais bien loin où la formation était sur tous les fronts pour vote des hommes noirs (1870), puis celui des femmes (1920). C’est aussi le parti qui élit en 1916 la première femme au Congrès en la personne de Jeannette Rankin (Montana). Malgré toutes ces réalisations, les actions progressistes menées depuis les années 1960 par le rival démocrate en direction des femmes et des minorités ethno-raciales (Equal Pay Act en 1963, Civil Rights Act en 1964, Economic Opportunity Act en 1964, Voting Rights Act en 1965) avaient fini par créer une alliance tacite entre ce dernier et ces groupes. Pendant ce temps, les Républicains montraient des positionnements de plus en plus conservateurs et hostiles auxdits groupes. C’est ainsi que malgré son opposition de principe à l’ERA, Reagan promit pendant l’élection présidentielle de 1981 de promouvoir l’égalité femmes-hommes, avant d’engager une politique allant dans le sens inverse sitôt installé au pouvoir. (Schafran, 1981) À l’inverse, les mesures initiées par les Démocrates dès les années 1960 permirent par exemple une réduction progressive des écarts de revenus entre femmes et hommes. Si en 1960 les salariées percevaient 62 % des revenus de leurs homologues masculins, en 2005 elles en gagnaient plus de 75 %. (Goldin, 1988 : 13)
C’est pourquoi quelque chose semblait avoir déjà changé depuis que le Nevada décida, contre toute attente, de ratifier l’amendement. Les partisans de l’ERA étaient de nouveau mobilisés et pouvaient entrevoir la perspective d’une victoire définitive. C’était d’autant plus inattendu que c’était exactement au moment où les femmes se mobilisaient pour défendre le droit à l’avortement fortement menacé par l’arrivée au pouvoir d’une administration peu encline aux sympathies féministes. En effet, comme une loi de balancier presque systématique, c’est à l’installation de Trump que le Congrès décidait dès janvier 2017 d’introduire une loi permettant un prolongement du délai de ratification de l’ERA par les États.
L’ERA est-il vraiment utile en renaissant subitement de sa très longue léthargie en 2017 ? La question est presque rhétorique tant sa formulation semble orientée. Pourtant, force est de constater que l’ERA renaît paradoxalement à l’heure où une administration s’emploie à détricoter le droit à l’avortement, à décrier la politique de santé reproductive (planned parenthood) avec la réactivation d’une règle (gag rule) jadis utilisée sous Reagan avec les mêmes objectifs. Ladite règle permet aux autorités fédérales ou d’État de refuser d’attribuer des financements publics à toute organisation ou service de santé pratiquant l’interruption volontaire de grossesse. En prenant une telle décision l’administration Trump, à peine installée, se montrait nostalgique des années 1980 qui virent le pays entamer sa longue révolution conservatrice. Le nouveau président infligeait ainsi un énième affront aux féministes désormais revigorées par tant d’hostilité, regain de combativité ponctuée d’une mobilisation exceptionnelle lors de la Women’s March du 21 janvier 2017[6].
Conclusion
Le vote de l’ERA par l’assemblée d’État de l’Illinois passerait pour un épiphénomène sans incidence sur la vie politique du pays. Pourtant, au contraire, l’adoption de ce projet emblématique de la période du NWP constituerait une victoire très importante pour les féministes et leurs alliés progressistes. Cela se pourrait se traduire par plus d’égalité salariale entre hommes et femmes, une plus grande représentativité des femmes au niveau des institutions politiques du pays, une application moins problématique de l’avortement qui constitue une pomme de discorde continue dans le débat public, etc. Dans un contexte si favorable à la réactivation du clivage entre conservateurs et progressistes, rendue possible par une polarisation politique accrue, l’avancée des uns ne signifie pourtant pas le recul des autres. En effet, nonobstant l’hypothèse d’un cycle de batailles juridiques au sein d’une Cour suprême aujourd’hui acquise aux conservateurs, et les incertitudes quant au futur État qui bouclerait la liste, le vote de l’Illinois passe aujourd’hui pour une petite révolution à même de précipiter une trente-huitième et dernière ratification. Tout indique que rien n’est encore acquis puisqu’après une première victoire au sénat de l’État de Virginie le 15 janvier 2019, l’ERA fut mis en échec quelques jours plus tard par la chambre des représentants ceci, en dépit d’une coalition en faveur de la réforme allant au-delà des clivages partisans, et d’une mobilisation exceptionnelle dans les rangs de l’antenne locale de la NOW.
La course contre la montre se poursuit donc dans l’un des treize États restants. Quoi qu’il en soit, la victoire définitive de l’ERA, au-delà des changements espérés dans les domaines tant économique que politique, serait un signal fort en direction des tenants d’un pouvoir qui n’a eu de cesse d’afficher son mépris pour l’idée d’égalité, a fortiori entre femmes et hommes.
Notes de fin
[1] En 1920, selon un rapport du U.S. Women’s Bureau de 1947, les femmes travaillaient principalement comme serveuses, enseignantes, employées agricoles (terres familiales), sténographes, employées de bureau, lavandières, vendeuses, libraires, cuisinières et employées agricoles (grandes fermes).
[2] Selon une définition de Claudia Goldin. Dans le premier cas, les femmes mariées ne pouvaient pas être embauchées dans les entreprises parce que leur place était à la maison. Dans le deuxième cas, celles qui en étant employées décidaient de se marier étaient le plus souvent sous la menace d’un licenciement.
[3] L’ERA fut ratifié dans vingt-deux États dès 1972, six autres suivirent en 1973 et cinq avant le 22 mars 1979, en tout 35 assemblées d’États avaient fini de ratifier l’amendement. https://www.equalrightsamendment.org/era-ratification-map (Consulté le 10 février 2019).
[4] L’ERA avait d’ailleurs vraisemblablement partie liée avec la question de l’avortement : « (…) l’ERA ne peut pas entrer en vigueur rapidement sans un compromis sur l’avortement. Mais une majorité considérable de soutiens de l’ERA pense que tout compromis comme contraire à l’esprit et à la lettre de l’amendement. » (Steiner, 1985 : 107)
[5] Voir les affaires suivantes : Dillion v. Gloss ; (256 U.S. 368, 1921) Coleman v. Miller (307 U.S. 433, 1939) ; Goessaert v. Cleary (365 U.S. 468, 1948) ; Frontiero v. Richardson (411 U.S. 677, 1973) ; Reed v. Reed (404 U.S. 71, 1971) ; Khan v. Shevin (416 U.S. 351, 1971) ; NOW v. Idaho (459 U.S. 809, 1982).
[6] Les marcheuses étaient 1 000 000 à Washington, 500 000 à Los Angeles, 250 000 à Chicago, 200 000 à New York, etc. (Booth et Topping, 2017)
Bibliographie
Booth Robert & Topping Alexandra (2017). « Two Million Protest Trump’s Inauguration », Londres : The Guardian (24 janvier).
Christman Elizabeth (1936). « Press Release ». Mary van Kleeck Papers, Sophia Smith Collection, Smith College, 28 décembre.
Center for American Women and Politics. Results: Women Candidates in the 2018 Elections. 29 novembre 2017. [URL : https://www.genderwatch2018.org/home-2. Consulté le 10 février 2019]
Cott Nancy (1984). « Feminism in the 1920s: The National Woman’s Party ». Journal of American History, Vol. 71, n° 1, 43–68.
Goldin Claudia (1988). « Marriage Bars: Discrimination Against Married Women Workers, 1920’s to 1950’s » NBER Working Paper, Vol. 2747.
Held Alison L, et al (1997). « The Equal Rights Amendment: Why the ERA Remains Legally Viable and Properly Before the States ». William & Mary Journal of Women and the Law, Vol. 3, n° 1 : 113-136.
House of Representatives (1972). House Joint Resolution 208: Proposed Amendment to the Constitution of the Constitution of the United States. Washington D.C., 22 mars.
Kelley Florence, Hill Elise (1922). « Shall Women Be Equal Before the Law? ». The Nation, 12 avril.
Kenney Anne R. (1979). « The Papers of International Women’s Year, 1977 ». The American Archivist, Vol. 42, n° 3.
Kirchwey Freda (1921). « Alice Paul Pulls the Strings ». The Nation, 2 mars, 332-333.
Lynn Denise (2014). « The Women’s Charter: American Communists and the Equal Rights Amendment Debate ». Women’s History Review, Vol. 23, n° 5, 707-722.
Murray Ella Rush (1921). « The Woman’s Party and the Violation of the 19th Amendment ». Baltimore : The Crisis, Vol. 21, n° 4, 259-261.
Neale Thomas E. (2013). The Proposed Equal Rights Amendment: Contemporary Ratification Issues. Washington D.C. : Congressional Research Service.
Newman Louise Michele (1999). White Women’s Rights: The Racial Origin of Feminism in the United States. Oxford : Oxford University Press.
Richardson Seth A. (2017). « Equal Rights Amendment passes Nevada Assembly; Senate likely to concur ». Reno : Reno Gazette Journal, 22 mars.
Schafran Lynn H. (1981) « Reagan vs. Women ». New York Times, 13 octobre.
Schlafly Phyllis (1972). The Phyllis Schlafly Report, Vol. 5, n° 7, 1-4.
Sklar Kathryn K., Palmer Beverly W. (2009). The Selected Letters of Florence Kelley, 1869-1931. Urbana et Chicago : University of Illinois Press.
Steiner Gilbert Y. (1985). Constitutional Inequality: The Political Fortunes of the Equal Rights Amendment. Washington D.C. : Brookings Institution.
State of Illinois (2018). U.S. Constitutional Equal Rights Amendment, One Hundredth General Assembly Bill. Springfield, 30 mai.
The United States Women's Bureau (1947). Bulletin of the Women's Bureau, n° 218. Washington D.C. : U.S. Government Printing Office.
Terborg-Penn Rosalyn (1998). African American Women in the Struggle for the Vote, 1850–1920. Bloomington : University of Indiana Press.
U.S. Government (1972). Congressional Records, Vol. 117. Washington D.C. : U.S. Government Printing Office.
Woman’s Journal and Suffrage News (1913). 8 mars.
Zinn Howard (1980). A People’s History of the United States. New York: Harper & Row.
Pour citer cet article :
Salian Sylla, « Equal Rights Amendment : près d’un siècle de (sur)vie d’un combat pour l’égalité », RITA [en ligne], n°12 : septembre 2019 . Mis en ligne le 12 septembre 2019. Disponible en ligne: http://revue-rita.com/dossier-12/equal-rights-amendment-pres-d-un-siecle-de-sur-vie-d-un-combat-pour-l-egalite-salian-sylla.html



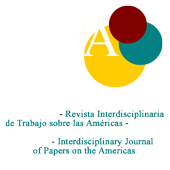















 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8