Enquêtes sur le féminicide à Ciudad Juárez (Mexique) : les légendes urbaines chez Maud Tabachnik, Alicia Gaspar de Alba et Kama Gutier
Investigaciones sobre el feminicidio en Ciudad Juárez (Mexico): las leyendas urbanas en las obras de Maud Tabachnik, Alicia Gaspar de Alba y Kama Gutier
Résumé
S’appuyant sur trois polars – Desert Blood : The Juárez Murders (2005) de l’écrivaine chicana Alicia Gaspar de Alba, J’ai regardé le diable en face (2005) de la Française Maud Tabachnik et Ciudad final (2007) de l’auteure espagnole Kama Gutier, pseudonyme de Josebe Martínez –, le présent article se propose d’analyser le tournage de snuff movies, le trafic d’organes et l’existence de rites sataniques à Ciudad Juárez à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ces trois légendes urbaines qui ont fleuri pour expliquer le féminicide sexuel systémique, c’est-à-dire, selon Julia Estela Monárrez Fragoso (2009 : 86), « l’assassinat d’une enfant/d’une femme commis par un homme, dans lequel se retrouvent tous les éléments de la relation inégalitaire entre les sexes », semblent cacher les véritables racines du mal : le laxisme de l’État qui permet la perpétuation des meurtres à l’encontre des femmes.
Mots-clés : Féminicide ; Polar ; Ciudad Juárez ; Légendes urbaines ; Impunité.
Resumen
Apoyándose en tres novelas negras – Desert Blood :The Juárez Murders (2005) de la escritora chicana Alicia Gaspar de Alba, J’ai regardé le diable en face (2005) de la francesa Maud Tabachnik y Ciudad final (2007) de la autora española Kama Gutier, seudónimo de Josebe Martínez –, este artículo se propone analizar el rodaje de snuff movies, el tráfico de órganos y la existencia de ritos satánicos en Ciudad Juárez en la frontera entre los Estados Unidos y México. Estas tres leyendas urbanas que florecieron para explicar el feminicidio sexual sistémico, es decir, según Julia Estela Monárrez Fragoso (2009 : 86), « el asesinato de una niña/mujer cometido por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos », parecen ocultar las verdaderas raíces del mal: el laxismo del Estado que permite la perpetuación de los homicidios en contra de las mujeres.
Palabras clave : Feminicidio; Novelas negras; Ciudad Juárez; Leyendas urbanas; Impunidad.
--------------------------
Nicolas Balutet
Maître de conférences habilité à diriger des recherches
Université de Toulon
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Enquêtes sur le féminicide à Ciudad Juárez (Mexique) : les légendes urbaines chez Maud Tabachnik, Alicia Gaspar de Alba et Kama Gutier
Introduction : le féminicide à Ciudad Juárez
Ciudad Juárez est une ville de plus de 1,3 million d’habitants située au nord de l’État mexicain de Chihuahua, à la frontière avec les États-Unis. Fondée le 8 décembre 1659 comme mission évangélisatrice (Barrios Rodríguez, 2014 : 103), elle est qualifiée dès le début du XXe siècle (en 1915) de « ville la plus perverse d’Amérique » par le journal Boston Herald (Ronquillo, 2004 : 13-14) ou bien de « lieu le plus immoral, dégénéré et pervers » et de « Mecque des criminels et des dégénérés » selon le Consul des États-Unis en poste en 1921 (Fernandez et Rampal, 2005 : 228). Elle doit alors cette réputation sulfureuse – qui ne s’est pas démentie depuis – à l’omniprésence des bars, des discothèques, des hôtels de passe, des points de revente de drogue, etc., qui attirent une faune humaine prompte à la violence.
Si Ciudad Juárez est désormais connue bien au-delà des frontières mexicaines, c’est que la ville est directement associée à la mort. Lieu placé sous le sceau de la sexualité à outrance, Ciudad Juárez est devenue, en effet, depuis le début des années 1990 « la ville qui tue les femmes », pour reprendre le titre de l’ouvrage de Marc Fernandez et Jean-Christophe Rampal. Ce titre, qui pourrait paraître quelque peu racoleur de prime abord, traduit pourtant une terrible réalité : depuis janvier 1993 et la reconnaissance d’une première victime officielle – la jeune Alma Chavira Farel, treize ans – et 2013, entre 380 et 700 meurtres de femmes auraient été commis, auxquels il convient d’ajouter 700 disparitions (Hallberg, 2012 : 1 ; Fourez, 2012 : 228 ; Labrecque, 2012 : 83 ; Barrios Rodríguez, 2014 : 111 ; Large, 2016 : 181-182).
Ces meurtres ont été qualifiés de « féminicides » (Monárrez Fragoso, 2009 ; Fregoso et Bejarano, 2010 ; González Rodríguez, 2012 : 82-83). Il s’agit d’un néologisme qui s’inspire de l’anglais femicide, un mot utilisé pour la première fois en Angleterre en 1801 pour désigner le « meurtre d’une femme » (Russel, 2001 : 15). Ce n’est qu’en 1976 que la sociologue Diana Russell le reprend à son compte en y ajoutant une connotation sexiste : « assassinats de femmes par des hommes en raison de la haine, du mépris, du plaisir ou d’un sentiment de possession des femmes » (Hallberg, 2012 : 9)[1]. En 1992, avec la publication de Femicide : The Politics of Woman Killing, Diana Russell, Jane Caputi et Jill Radford prolongent la réflexion initiale. Pour ces auteures, les femmes sont victimes d’un continuum d’abus physiques et verbaux comme la torture, le viol, l’inceste, la prostitution, le harcèlement, l’excision, la stérilisation forcée, etc. Le féminicide désigne alors tout ce qui, dans cette terrible liste, entraîne la mort des femmes (Caputi et Russell, 1992 : 13-21). Il s’agit donc du « meurtre misogyne des femmes par des hommes » (Radford et Russell, 1992 : xi)[2]. Le terme s’est popularisé en espagnol quelques années plus tard sous l’impulsion de l’anthropologue mexicaine Marcela Lagarde, ancienne députée fédérale du Parti de la révolution démocratique (PRD) entre 2003 et 2006 et Présidente d’une Commission parlementaire chargée de suivre les enquêtes sur les meurtres de Ciudad Juárez : « Le féminicide est l’une des formes extrêmes de la violence de genre ; il recoupe l’ensemble des actes misogynes violents contre les femmes impliquant la violation de leurs droits fondamentaux, la menace contre leur sécurité et leur vie. Sa manifestation ultime est l’assassinat de certaines enfants et femmes » (1996 : 66)[3].
Pour intéressantes qu’elles soient, ces définitions présentent l’inconvénient d’être trop générales. Partant de cette constatation, la sociologue mexicaine Julia Estela Monárrez Fragoso (2006) a donc proposé de faire la distinction entre plusieurs formes de féminicides : 1) le féminicide intime, c’est-à-dire la maltraitance et le meurtre de femmes et de petites filles commis par un membre de la famille ; 2) le féminicide en raison de métiers stigmatisés (prostituées, danseuses, serveuses, etc.) ; et 3) le féminicide sexuel systémique qu’elle définit ainsi :
Le féminicide sexuel systémique est l’assassinat d’une enfant/d’une femme commis par un homme, dans lequel se retrouvent tous les éléments de la relation inégalitaire entre les sexes : la supériorité genrée de l’homme face à la subordination genrée de la femme, la misogynie, le contrôle et le sexisme. Avec la passivité et la tolérance d’un État absent, c’est le corps biologique de la femme qui est tué mais également ce qu’a représenté la construction culturelle de son corps. Le féminicide sexuel systémique possède la logique irréfutable du corps des fillettes et des femmes qui ont été séquestrées, torturées, violées, assassinées et jetées dans des espaces sexuellement transgresseurs. Les assassinats au moyen d’actes cruels renforcent les relations sociales inégalitaires de genre qui font la différence entre les sexes : altérité, différence et inégalité. (Monárrez Fragoso, 2009 : 86)[4].
C’est cette dernière catégorie qui correspond au phénomène qui a prospéré dans la ville de Ciudad Juárez depuis le début des années 1990. De cette époque à la fin des années 2000, le féminicide sexuel systémique représenterait environ 20% de tous les crimes commis dans la ville contre environ 57% pour les assassinats liés à la violence générale, 20% pour la catégorie des féminicides intimes et 3% pour le féminicide en raison de métiers stigmatisés (Falquet, 2014). Marco Kunz (2016 : 140-141) rejoint les chiffres donnés par Jules Falquet pour la période 1993-2010 et rappelle, par ailleurs, qu’en 2008 et 2010, les assassinats de femmes à Ciudad Juárez représentent 10,7% de l’ensemble des meurtres commis (89,3% des victimes sont donc des hommes). Sans sous-estimer le phénomène du féminicide sexuel systémique, le chercheur met donc en garde contre une tendance fort répandue qui consiste à considérer tout meurtre de femmes à la frontière mexicaine comme relevant de cet unique fléau.
Pour expliquer ces assassinats, l’anthropologue Patricia Ravelo Blancas, s’appuyant sur le dépouillement de plus de 200 coupures de journaux publiés en 2001, est allée jusqu’à dénombrer pas moins de 32 théories différentes qu’elle a regroupées en cinq axes (Labrecque, 2005 : 53 ; 2012 : 142-143 ; Huerta Moreno, 2012 : 4) : 1) le crime organisé (trafic d’organes, snuff movies, messages des narcotrafiquants aux autorités, exécutions relatives au narcotrafic, vengeances entre bandes rivales, corruption des policiers, sélection de victimes à partir de catalogues de photos de travailleuses des maquiladoras, création d’un climat d’insécurité pour favoriser une culture de la terreur et corruption profitant à des familles de l’oligarchie) ; 2) les pathologies psychiques et sociales (enlèvements par des « juniors » pour des orgies, rites sataniques exigeant le sacrifice de femmes, crimes par imitation, nature des hommes, crimes « passionnels », vengeances entre familles, assassins en série provenant des États-Unis et fétichisme) ; 3) les hypothèses sociologiques et de genre (frustration masculine en raison de la compétition des femmes sur le marché du travail, augmentation de la présence des femmes dans les espaces publics, réaction du patriarcat devant la menace de l’augmentation de l’influence féminine, misogynie, racisme et volonté de réduire l’immigration en provenance du Sud) ; 4) les crimes d’État (absence ou inefficacité des services publics, pauvreté, climat d’impunité et absence de planification et de prévention) ; et 5) le point de vue moral/chrétien (perte des valeurs morales, façon de se vêtir des femmes, présence des femmes dans des lieux inappropriés pour elles, relâchement de la pudeur des femmes et désintégration familiale).
Dans le cadre de cette étude, je vais m’intéresser aux légendes urbaines qui ont prospéré à Ciudad Juárez pour expliquer l’assassinat de nombreuses femmes. Il s’agit du tournage de snuff movies, du trafic d’organes et de l’existence de rites sataniques, dont parle, par ailleurs, le journaliste Sergio González Rodríguez qui a popularisé le sujet dans le monde hispanique avec sa chronique Huesos en el desierto (2002 ; Benmiloud, 2009). J’aurais pu appréhender ces différentes hypothèses de multiples façons. J’ai choisi la voie de la littérature et, plus précisément, celle du polar, car les « récits crépusculaires » de ce genre, pour reprendre une expression de Jean-François Vilar (1987 : 9), emplis de violence (individuelle ou institutionnelle), de meurtres, de cruauté, de corruption, etc., permettent de mettre à nu « les grandes cicatrices de la nation » et rendent visible, selon moi, ce qui fait tout l’intérêt de la fiction : son apport à la connaissance du réel, parfois inexprimable par un autre moyen. Si la « grande » œuvre traitant du féminicide à Ciudad Juárez est 2666 (2004) de Roberto Bolaño où la ville apparaît sous les traits de sa transposition littéraire Santa Teresa, mon corpus se compose de trois polars moins connus, écrits entre 2005 et 2007 par trois femmes : Desert Blood de l’Américaine chicana Alicia Gaspar de Alba, J’ai regardé le diable en face de la Française Maud Tabachnik et Ciudad final de l’Espagnole Josebe Martínez qui a choisi le pseudonyme de Kama Gutier.
I. Le tournage de snuff movies
Parmi les hypothèses évoquées pour expliquer le féminicide à Ciudad Juárez figure une légende urbaine déjà ancienne car on la retrouve au début du XXe siècle dans une nouvelle de Guillaume Apollinaire intitulée « Un beau film » (Dominguez Leiva et Laperrière, 2013 : 12). Je parle de l’existence de snuff movies, un terme qui désigne des « films dans lesquels une ou plusieurs personnes subissent des tortures, puis sont violées et assassinées » (Fernandez et Rampal, 2005 : 72). De l’anglais to snuff out, « éteindre, moucher une chandelle, étouffer la flamme d’une bougie » (Finger, 2001 : 11) – ce qui n’est pas sans évoquer le dernier souffle d’une personne –, le terme a été popularisé aux États-Unis au milieu des années 1970 par la confluence de plusieurs facteurs : découverte supposée par la police de New York de plusieurs films pornographiques sud-américains présentant des meurtres réels (Labelle, 2006 : 371) ; publication d’un livre d’Ed Sanders sur Charles Manson (Bou, 2005 : 452) ; sortie en 1976 du film argentino-américano-canadien Snuff réalisé par Michael et Roberta Findlay dans lequel seraient exposés les véritables assassinat et démembrement d’une jeune femme par un groupe vouant un culte au meurtrier de Sharon Tate (Stine, 1999). À l’exception de la publication de The Family. The Story of Charles Manson’s Dune Buggy Attack Battalion, tout n’était que canular. Néanmoins, le succès du film va durablement installer dans les mentalités la possibilité que de tels documents existent. D’ailleurs, le thème ressort périodiquement dans des films grand public comme l’excellent Tesis (1996) d’Alejandro Amenábar ou le plus discutable 8 millimètres (1999) avec Nicolas Cage dont Josebe Martínez remémore une partie du tournage dans Ciudad final (Gutier, 2007 : 131).
Selon Sarah Finger, la littérature s’est rarement inspirée du mythe des snuff movies, « sans doute parce que la langue écrite se prête mal à la description d’images qui, pourrait-on dire, se passent de commentaires… Un snuff est conçu pour être vu, et toute son intensité réside dans les images qu’il livre. Le décrire, c’est lui ôter cette fameuse force de frappe » (2001 : 54). La journaliste a certainement raison. Néanmoins, deux romans de mon corpus – Josebe Martínez ne l’évoque que brièvement (Gutier, 2007 : 131, 172-173) –, s’attachent longuement à cette hypothèse. Desert Blood et J’ai regardé le diable en face évoquent tout d’abord le prix, souvent très élevé, de ce genre de film : « Ça se vend cinq mille dollars la cassette. Tu vois la masse de pognon que représentent les copies ? » (Tabachnik, 2007 : 274) ; « La vidéo qu’ils ont tournée avec Ignacio était déjà sur le marché et suscitait les enchères » (Tabachnik, 2007 : 346) ; « On est censé diffuser un streaming en direct, pas un enregistrement. Les gens paient pour du direct » (Gaspar de Alba, 2005 : 197)[5]. La raison de ce coût est simple. Le snuff movie relève de l’interdit, de l’irreprésentabilité du corps passant de vie à trépas (Finger, 2001 : 24) : ce qui est rare est cher. Cette situation implique que seule une poignée d’initiés, souvent aisés, a accès à ces films, justifiant ainsi leur production – la mort contre de l’argent – mais aussi, pour les autorités, la difficulté – pour ne pas dire l’impossibilité – de mettre la main dessus et in fine la rumeur (Laperrière, 2013 : 4-5). Le snuff movie traduit également les inégalités économiques et, surtout, l’impunité que l’argent confère aux puissants (Kunz, 2008 : 124).
Dans les deux romans, les bourreaux – sans parler des clients jouisseurs et voyeurs qui, confortablement lovés dans leurs canapés, orchestrent tout autant cette barbarie –, présentent des caractéristiques associées à la mort. Dans Desert Blood, le violeur se fait appeler Dracula lors du tournage du snuff movie, alors que son surnom habituel dans le roman n’est autre que « El Diablo » (Gaspar de Alba, 2005 : 267-268), reprenant en cela le véritable surnom de Sergio Armendáriz, chef supposé du groupe des Rebelles. Dans J’ai regardé le diable en face, le bourreau est comparé à un pirate à la poitrine velue portant foulard, bottes, gilet de cuir sans manches (Tabachnik, 2007 : 272). Du heavy métal, probablement du Marilyn Manson, dont le nom fait référence au tueur en série Charles Manson, assure le fond sonore de la scène du viol et du meurtre de la très jeune Doris (Gaspar de Alba, 2005 : 267-268). Les victimes, quant à elles, ressemblent au profil type dressé par Sarah Finger dans son excellent ouvrage La mort en direct. Il s’agit de femmes, « toujours jeune[s], parfois adolescente[s] [...] souvent issues de milieux défavorisés ou de familles modestes » (2001 : 69), ce qui n’est pas sans renforcer l’immoralité du snuff. Dans Desert Blood, Dracula se plaint ainsi que la jeune fille n’ait pas de seins – elle a six ans… (Gaspar de Alba, 2005 : 268) –, cependant que Bike et José, dans J’ai regardé le diable en face, se délectent de la vision de « malheureuses gamines » (Tabachnik, 2007 : 272), « deux filles, des adolescentes [qui] pouvaient avoir entre treize et quinze ans » (Tabachnik, 2007 : 271-272).
Alicia Gaspar de Alba fait de l’hypothèse des snuff movies une des causes principales du féminicide à Ciudad Juárez, ce que découvre Ivon, le personnage principal du roman, lorsque le garde-frontière Jeremy Wilcox, chef d’un réseau pornographique, la force à regarder une vidéo dans laquelle est présentée la mort d’une enfant prénommée Doris (Gaspar de Alba, 2005 : 281). J’ai regardé le diable en face de Maud Tabachnik semble accorder également quelque crédit à l’hypothèse des snuff movies, parmi d’autres. Le film que regarde avec fascination le couple de serial killers Bike et José se termine cependant au moment où une jeune fille est sur le point de se faire assassiner par un de ses violeurs. On ne connaît donc pas le dénouement :
Puis le pirate invita les trois hommes à s’approcher, prit dans un étui un poignard qu’il montra à la caméra sous divers angles, ce qui permit aux spectateurs de constater que sa lame, effilée comme un rasoir, était enchâssée dans un manche en or, puis il s’empara de la seconde fillette qu’il attacha sur une chaise, à la droite du chevalet où gisait son amie, fit signe à la caméra d’approcher pour un gros plan, lui releva la tête pour bien montrer son visage ravagé, et la courba pour mettre en évidence son dos lacéré par la badine.
Enfin, lui maintenant d’une main la tête tournée vers sa compagne évanouie, il tendit le poignard à l’un des vieillards qui, gêné, se tourna vers ses complices qui riaient moins fort à présent et reculaient à demi, tandis que le « pirate » encourageait le sacrificateur de la voix et du geste à se rapprocher du chevalet.
– Allez, vas-y ! criaient ses compagnons, soulagés peut-être de seulement regarder.
Comme on se jette dans une eau que l’on sait trop froide, le vieillard leva brusquement son poignard au-dessus de la fillette suppliciée.
L’écran s’éteignit et la lumière revint dans la salle. (Tabachnik, 2007 : 273-274)
Dans ce roman, on voit bien l’effet érotique que provoque le snuff movie sur les spectateurs : le narrateur les décrit comme « hypnotisés », ne pouvant quitter des yeux l’écran où se déroule le spectacle sanglant. Bike, de son côté, lance trois fois un « Putain, le pied ! » tout en se masturbant (Tabachnik, 2007 : 271-273). Ce n’est pas tant l’acte sexuel qui va provoquer la jouissance dans le snuff movie mais plutôt, semble-t-il, la destruction de l’autre et la monstration non simulée de la mort : il faut voir la victime en train de mourir. Mais le snuff movie est paradoxal : il se présente comme la vérité, la réalité, comme un objet proche du documentaire (Kamieniak I., 2006 : 409 ; Kamieniak J. P., 2006 : 400). En même temps, on assiste dans les deux romans à une véritable mise en scène « cinématographique » et donc fictionnelle de ce spectacle de la mort. J’ai regardé le diable en face évoque des chevalets ou des autels sur lesquels étaient attachées les jeunes victimes (Tabachnik, 2007 : 317). Le roman s’appesantit d’ailleurs sur l’un d’entre eux, un énorme cactus vierge, sur lequel est empalée Matilda après avoir été violée, « un supplice connu au Moyen Âge sous le nom de Vierge de Nuremberg » (Tabachnik, 2007 : 312). De son côté, la spontanéité de Dracula dans Desert Blood est feinte puisqu’il répond au scénario imaginé et fantasmé par le réalisateur Junior :
– Retourne-la ! Montre-moi son cul ! OK, mets-la sur le lit et attache-la sur le ventre. Dracula, tu vas me donner une fessée à cette vilaine petite fille. Ensuite, tu me la prends comme une chienne. […] Fais-lui sa fête, à cette chienne.
– Dans le cul, patron ?
– Je veux que tu la défonces ! Caméra deux, gros plan sur la bite. Caméra un, plan moyen de derrière. C’est ça. Baise cette petite salope. Je veux voir du sperme. Et fissa. (Gaspar de Alba, 2005 : 268)[6]
Parmi toutes les hypothèses avancées pour expliquer la situation que connaît Ciudad Juárez, Alicia Gaspar de Alba et Maud Tabachnik privilégient donc la moins crédible et la plus sensationnaliste car, comme le remarque le criminologue mexicain Óscar Máynez, il n’existe pas aujourd’hui de preuves tangibles de l’existence de snuff movies en tant que tels, ce qui n’exclut nullement que des assassins aient pu filmer leurs crimes pour un « usage privé » : « Je ne pense pas que cette hypothèse sur la commercialisation de films à caractère pornographique et violent soit la cause principale de tous ces assassinats, même si je ne doute pas que ceux qui commettent ces crimes possèdent quelques enregistrements vidéo de leurs actes. Mais ils les font pour eux, comme une sorte de divertissement personnel macabre, pas pour les commercialiser » (Fernandez et Rampal, 2005 : 72-73).
Que dit la rumeur des snuff movies sur notre société ? Alors même que ces films n’ont aucune existence réelle, ils imprègnent notre imaginaire collectif. Nous savons, en effet, de quelle violence l’homme est capable : les snuff movies ne sont donc pas perçus comme des produits chimériques. Par ailleurs, ils s’inscrivent dans cette liste de « spectacles » comme les exécutions publiques qui projettent nos propres fantasmes, pulsions et peurs face à la mort (Finger, 2001 : 7 ; Bou, 2005 : 454 ; Laperrière, 2013 : 8-9).
II. Le trafic d’organes
Une autre hypothèse, soutenue par certaines associations et journalistes (Labrecque, 2012 : 142-143), évoque le trafic d’organes humains. En effet, certaines victimes ont été retrouvées mutilées d’une partie de leurs organes. Les trois romans le rappellent (Gaspar de Alba, 2005 : 95 ; Gutier, 2007 : 126) mais c’est J’ai regardé le diable en face qui s’appesantit le plus sur cet aspect dans des termes très crus suscitant le malaise chez le lecteur : « des filles démembrées, ouvertes du sternum au pubis, vidées de leurs organes » (Tabachnik, 2007 : 98) ; « D’autres que l’on a éviscérées pour leur voler leurs organes. Disparus les foies, les reins, les yeux… » (Tabachnik, 2007 : 134). Comme pour les snuff movies, l’hypothèse est peu crédible car ce trafic nécessiterait une infrastructure et une logistique difficile à réunir. C’est ce qu’ont bien compris les deux héroïnes de Desert Blood et de Ciudad final qui dressent la liste des éléments indispensables aux opérations chirurgicales :
– Une des théories à propos de ces crimes est qu’il existe un marché de trafic d’organes, et que ces gens-là se concentrent sur les jeunes filles parce qu’elles sont en bonne santé et qu’elles n’ont pas encore développé les mauvaises habitudes qui nuisent à leurs organes. Selon nos sources, certains des corps ont été retrouvés vidés de leurs organes. Et comme on les déniche toujours dans le désert mais pas trop loin, dans des zones où un hélicoptère peut se poser facilement, on suppose que les trafiquants prélèvent les cœurs ou les foies sur place, pour les embarquer aussi tôt que possible après la mort de leur propriétaire.
– C’est absurde ! Il faudrait un environnement stérile pour que ça fonctionne ! (Gaspar de Alba, 2005 : 95)[7]
– C’est plus difficile, car vous avez besoin de personnes très qualifiées pour effectuer une telle intervention, vous avez besoin de médecins, vous avez besoin d’une équipe chirurgicale bien préparée, vous avez besoin d’une compatibilité sanguine entre patients et donneurs... bref, une série de choses qui ne sont pas faciles à rassembler et à synchroniser. (Gutier, 2007 : 173)[8]
Le criminologue Óscar Máynez a aussi écarté cette hypothèse devant les journalistes Marc Fernandez et Jean-Christophe Rampal, expliquant que ses services avaient réalisé « une enquête sur les ressources financières nécessaires à la mise en place de ce genre de choses, mais [qu]’elle n’a[vait] rien donné » (2005 : 67). Cela ne veut pas dire pour autant que des femmes n’aient pas vendu, à titre individuel, un de leurs organes – comme un rein par exemple – à des mafias opérant dans des conditions précaires ou bien qu’elles n’aient pas été assassinées par la suite en raison de complications sanitaires ou autres. C’est d’ailleurs ce thème du don volontaire d’organes qui explique combien l’idée du trafic n’apparaît pas aux yeux des gens comme une affabulation, alors que les snuff movies suscitent tout de même plus de réserve. Pourtant, l’un comme l’autre sont des légendes urbaines. Véronique Campion-Vincent (1997 : 34), dans son ouvrage La légende des vols d’organes, a bien montré comment cette rumeur est partie d’Amérique latine suite au croisement de deux situations : le don volontaire d’organes pour des raisons économiques et des disparitions d’enfants. Après être passés sur des tables d’opération, des enfants auraient été retrouvés avec un organe en moins, quelques dollars en poche et un mot de remerciement. Le contexte de doute quant à la probité des institutions et la désinformation-spectacularisation d’une certaine presse auraient fait le reste.
Dans son roman, Maud Tabachnik développe le thème du trafic organisé et du marché noir. Son héroïne pense ainsi qu’il pourrait s’agir d’ « une des raisons de tous ces crimes » (Tabachnik, 2007 : 47), confortée en cela par les déclarations d’une autre journaliste qui évoque le trafic géré par une Moldave – pour plus d’exotisme… – arrivée à Ciudad Juárez en 2000 après avoir fait fortune en Europe de l’Est (Tabachnik, 2007 : 157-158). À la différence de la Moldavie où les donneurs n’étaient pas tués, les meurtres au Mexique seraient liés à l’idée que, dans ce pays, la vie des femmes ne compte pas.
III. Les rites sataniques
La dernière légende urbaine renvoie à l’existence d’une secte satanique vénérant la « Santa Muerte », une croyance populaire fruit d’un syncrétisme subtil entre des éléments préhispaniques et catholiques (Fernandez et Rampal, 2005 : 74 ; Kunz, 2008 : 123). Apparue dans les années 1960, cette « Faucheuse » mexicaine est aujourd’hui vénérée par les délinquants et ceux qui se sentent délaissés par la société. À l’instar des deux autres légendes urbaines, les trois romans de mon corpus évoquent le satanisme, dont l’existence semble plausible pour certains personnages dans la mesure où les sacrifices humains étaient une coutume des anciens Mexicains. La journaliste Isabel Arvide ne dit-elle pas dans J’ai regardé le diable en face : « Vous savez, nos ancêtres ont procédé à des sacrifices humains. Qui sacrifiait-on aux dieux, d’après vous ? Des vierges » (Tabachnik, 2007 : 159) ? Par ailleurs, Kama dans Ciudad final se souvient d’une sordide histoire – bien réelle celle-ci – qui s’est déroulée en 1989 à la frontière entre Brownsville (Texas) et Matamoros au Mexique. Une quinzaine de cadavres – dont celui de Mark Kilroy, un jeune étudiant états-unien venu passer un week-end au Mexique avec sa confrérie – ont été découverts dans une cabane dans laquelle se trouvait un chaudron empli de cervelles humaines et de sang. Les coupables, deux tueurs en série et narcotrafiquants, Adolfo de Jesús Constanzo et Sara María Aldrete, pratiquaient une sorte de vaudou satanique (Carlander, 1991 : 28 ; González Rodríguez, 2002 : 68-69) :
J’avais entendu parler d’une secte vaudou à Matamoros, liée au trafic de drogue aux États-Unis et accusée d’être à l’origine de quinze à vingt meurtres. Apparemment, le groupe pratiquait le vaudou comme une forme de protection commerciale. Selon eux, l’impunité s’obtenait en faisant cuire le cerveau de la victime, préalablement frit, avec du sang, des herbes, des pattes d’oie et des têtes de chèvre ou de tortue. L’histoire a été découverte lorsqu’ils ont supplicié un petit gringo. Pas question que les gringos abandonnent un des leurs (si c’est un Blanc) ! (Gutier, 2007 : 129-130)[9]
Dans Desert Blood, un médecin légiste mentionne la présence d’un pentagramme, symbole satanique, sur le sein droit de certaines victimes (Gaspar de Alba, 2005 : 247), cependant que Ciudad final rappelle l’existence d’un triangle de pierres, autre symbole de Satan, près du corps de victimes (Gutier, 2007 : 21). Dans J’ai regardé le diable en face, Isabel Arvide évoque de même l’existence de « messes noires organisées dans les bunkers où vivent les narcos et les patrons locaux » (Tabachnik, 2007 : 199). De son côté, Ciudad final s’appesantit sur un article évoquant un pasteur baptiste qui, lors d’une fouille organisée par un groupe de volontaires, serait tombé sur une « cabane, remplie de bougies noires, [qui] contenait à l’intérieur un panneau de 2 mètres de haut pour 1,5 de large et arborait, parmi d’autres, l’adroit dessin d’un scorpion que trois femmes nues observaient, assises sur des bancs, et au bout duquel gisait une autre femme nue et menottée. Dans la partie supérieure, quelques soldats apparaissaient derrière des plants de cannabis » (Gutier, 2007 : 130)[10]. Ce récit s’inspire vraisemblablement des propos de deux journalistes, Víctor Ronquillo et Diana Washington Valdez, qui, dans deux ouvrages publiés en 2004 et 2007, parlent d’une découverte similaire par un groupe d’habitants. Dans une cabane abandonnée – « autre station de l’enfer dans lequel sont tombées les victimes », écrit emphatiquement Víctor Ronquillo (2004 : 133)[11] –, à côté de restes de cuirs chevelus, de sang et de douilles de balles, aurait été découvert un panneau de bois d’un mètre à un mètre cinquante de hauteur pour quatorze centimètres de large (notons la précision…), sur lequel seraient peints, dans un sordide pêle-mêle, dix femmes numérotées et nues – dont une possédant précisément les traits d’une des victimes (mais la plupart ont les mêmes caractéristiques physiques) –, des soldats, la zone montagneuse de Ciudad Juárez, des plants de cannabis, l’as de pique, un scorpion, l’étoile de David et des croix gammées (Ronquillo, 2004 : 133-136 ; Washington Valdez, 2007 : 38). Bien que le récit de Víctor Ronquillo en particulier se veuille fidèle à la réalité (par l’utilisation de témoins et de propos très précis), rien ne permet de confirmer l’existence de ce panneau qui aurait disparu après avoir été confié à la police judiciaire de Chihuahua, renforçant ainsi la thèse de ceux qui pensent que la police et la justice tentent de cacher la vérité.
Si on ne peut pas exclure que le crime organisé fasse appel à des rites de passage consistant à tuer des femmes et des hommes pour tester la valeur de ses membres ou bien que des individus, comme dans le cas de Matamoros, s’adonnent à des pratiques vénérant le Malin, aucun indice concret ne permet d’attester cependant de la véracité d’une sorte de « narcosatanisme » à grande échelle : c’est principalement une théorie qui « fait vendre du papier et des livres », comme le rapporte un spécialiste du narcotrafic (Fernandez et Rampal, 2005 : 74).
Conclusion
À côté de ces légendes urbaines, Desert Blood, J’ai regardé le diable en face et Ciudad final présentent des hypothèses plus crédibles : existence de tueurs en série, en raison de la récurrence du même profil de victimes (Barrón Cruz, 2004), ou essor des bandes rivales de narcotrafiquants dont certaines feraient passer des épreuves d’initiation (viols et meurtres) aux personnes souhaitant les intégrer ou utiliseraient les femmes comme des « messages » destinés aux autorités pour faire pression sur elles, pour faciliter les négociations. Au-delà de ces conjectures, le féminicide, quelles qu’en soient les causes exactes, est une conséquence du laxisme de l’État qui permet sa perpétuation :
Le féminicide se produit parce que les autorités, qui font preuve d’omissions, de négligences ou agissent de concert avec des agresseurs, exercent une violence institutionnelle sur les femmes en entravant leur accès à la justice, contribuant ainsi à l’impunité. Le féminicide implique la rupture partielle de l’état de droit, car l’État est incapable de garantir la vie des femmes, de respecter leurs droits fondamentaux, d’agir en suivant les lois et en les faisant respecter, de rechercher et de rendre la justice, et de prévenir et d’éradiquer la violence qui en est à l’origine. Le féminicide est un crime d’État. (Lagarde, 1996 : 66)[12]
Nombreux sont les chercheurs qui partagent ce point de vue, à l’instar de Rosa Linda Fregoso et Cynthia Bejarano (2010, de Marie-France Labrecque (2012 : 68-69) ou bien de Julia Estela Monárrez Fragoso pour qui « l’État, secondé par les groupes hégémoniques, renforce la domination patriarcale et place les membres de la famille des victimes et toutes les femmes dans une insécurité permanente et intense, due à une période continue et illimitée d’impunité et de complicités où les coupables ne sont pas punis et la justice n’est pas rendue aux victimes » (2009 : 86)[13]. Plus que de la négligence, les trois romans de mon corpus s’arrêtent également sur la manipulation des faits et des « preuves » qui semble être l’une des pratiques récurrentes des autorités mexicaines, éloignant ainsi la vérité et offrant, au contraire, une totale impunité aux véritables coupables. Là se trouve l’une des racines du mal.
Notes de fin
[1] « asesinatos de mujeres por hombres con motivo de odio, desprecio, placer o una sensación de posesión de mujeres ». Toutes les traductions sont de l’auteur.
[2] « misogynist killing of women by men ».
[3] “El feminicidio es una de las formas extremas de violencia de género; está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en el asesinato de algunas niñas y mujeres”.
[4] “El feminicidio sexual sistémico es el asesinato de una niña/mujer cometido por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No sólo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un estado ausente. El feminicidio sexual sistémico tiene la lógica irrefutable del cuerpo de las niñas y mujeres que han sido secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas y arrojadas en escenarios sexualmente transgresores. Los asesinos por medio de los actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad.”
[5] “Our shows are supposed to stream, that means live cabrón, not prerecorded. People are paying to see live action”.
[6] “Turn her around ! Let me see her ass”, Junior says. “Okay, let’s tie her to the bed facedown. Dracula, give that bad little girl a spanking and then show me some doggie action. […] Let her have it !” “In the ass, boss ?” “Fuck the shit out of her, man. Camera Two, keep tight on that prick. Camera One, body shot from behind. That’s it. Hump the little bitch. I want to see some spunk in one minute.”
[7] “One of the theories behind the crimes is that there’s a black market on human organs, and they target young women because they’re healthy, they haven’t developed bad habits yet that will have a negative impact on their organs. According to our sources, some of the bodies were found with their insides carved out of them. And since those bodies were all found near areas in the desert that are used as landing strips, the theory goes, those healthy hearts and livers and whatever else the human organ market needs get harvested fresh from the kill and taken away immediately on helicopters.”
– “That’s ridiculous. That requires a sterile environment at the very last.”
[8] “– Eso es más difícil, porque se necesita gente muy cualificada para llevar a cabo una intervención de este tipo, necesitas doctores, necesitas un equipo quirúrgico preparado, necesitas compatibilidad de sangres entre pacientes y donantes… en fin, una serie de cosas que desde luego no son fáciles de conjuntar y sincronizar.”
[9] “Yo había oído hablar de una secta vudú en Matamoros, relacionada con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, a la que se le imputan de quince a veinte víctimas. El grupo, al parecer, practicaba vudú como forma de protección para su negocio. La impunidad se conseguía, según ellos, cocinando los sesos de la víctima, fritos previamente, con sangre, hierbas, patas de gallo y cabezas de cabra o tortuga. Se descubrió el pastel en cuanto agarraron a un gringuito como víctima. ¡Ni modo que los gringos se queden quietos con uno de los suyos (si es blanco)!”
[10] “cabaña, llena de velas negras, [que] tenía en su interior una tabla de 2 metros de alto por 1,50 de ancho, y contenía, entre otros, el diestro dibujo de un escorpión al que miraban tres mujeres desnudas, sentadas en bancos, a cuyo pie yacía otra mujer desnuda y maniatada. Mientras en el área superior un puñado de soldados asomaba detrás de unas plantas de marihuana”.
[11] “otra de las estaciones del infierno en las que pararon las víctimas”.
[12] “El feminicidio se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con agresores, ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura parcial del estado de derecho, ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de respetar sus derechos humanos, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar y administrar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado.”
[13] “el Estado secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas”.
Bibliographie
Barrios Rodríguez David (2014). Las ciudades imposibles. Violencia, miedos y formas de militarización contemporánea en urbes latinoamericanas: Medellín – Ciudad Juárez. Mexico : UNAM.
Barrón Cruz Martín Gabriel (2004). “Violencia en Ciudad Juárez: asesinos seriales y psicópatas”. Dans Cervantes, G. et Ruiz Mena R. Homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Análisis, críticas y perspectivas. Mexico : Instituto Nacional de Ciencias Penales : 213-290.
Benmiloud Karim (2009). “Huesos en el desierto de Sergio González Rodríguez: de la investigación a la novela”. Dans Barrientos Tecún D. Escrituras policíacas, la historia, la memoria (América Latina). Bologne, Aix-en-Provence : Astraea, Université de Provence : 23-38.
Bolaño Roberto (2004). 2666. Barcelona : Anagrama.
Bou Stéphane (2005). « Snuff ». Dans Di Folco P., Dictionnaire de la pornographie. Paris : PUF : 452-454.
Campion-Vincent Véronique (1997). La légende des vols d’organes. Paris : Les Belles Lettres.
Caputi Jane et Russell Diana (1992). “Femicide : Sexist Terrorism against Women”. Dans Radford J et Russell D. Femicide : The Politics of Woman Killing. New York : Twayne Publishers : 13-21.
Carlander Ingrid (1991). « Essor de la violence satanique aux États-Unis », Le Monde Diplomatique. Février : 28.
Dominguez Leiva Antonio et Laperrière Simon (2013). Snuff movies. Naissance d’une légende urbaine. Paris : Le Murmure.
Falquet Jules (2014). « Des assassinats de Ciudad Juárez au phénomène des féminicides : de nouvelles formes de violences contre les femmes ». Contretemps [URL : http://www.contretemps.eu/interventions/assassinats-ciudad-juárez-phénomène-féminicides-nouvelles-formes -violences-contre-femm Consulté le 15 octobre 2014].
Fernandez Marc et Rampal Jean-Christophe (2005). La ville qui tue les femmes. Enquête à Ciudad Juarez. Paris : Hachette.
Finger Sarah (2001). La mort en direct. Les snuff movies. Paris : Le Cherche Midi Éditeurs.
Fourez Cathy (2012). Scènes et corps de la cruelle démesure : récits de cet insoutenable Mexique. Paris : Mare & Martin.
Fregoso Rosa-Linda et Bejarano Cynthia (2010). Terrorizing Women. Feminicide in the Americas. Durham : Duke University Press.
Gaspar de Alba Alicia (2005). Desert Blood : The Juárez Murders. Houston : Arte Público Press.
González Rodríguez Sergio (2002). Huesos en el desierto. Barcelone : Anagrama.
González Rodríguez Sergio (2012). “El feminicidio de Ciudad Juárez: Fenómeno y concepto cultural”. Dans Bernabéu Albert S. et Mena García C. El feminicidio de Ciudad Juárez. Repercusiones legales y culturales de la impunidad. Sevilla : Universidad Internacional de Andalucía : 79-100.
Gutier Kama (2007). Ciudad final. Barcelone : Montesinos.
Hallberg Nathalie (2012). El feminicidio en Ciudad Juárez (México). 20 años aterrorizando a las mujeres. Travail de recherche sous la direction de María Luisa Bartolomei. Stockholm : Stockholms Universitet.
Huerta Moreno Lydia Cristina (2012). Affecting Violence : Narratives of Los Feminicidios and their Ethical and Political Reception. Thèse de Doctorat sous la direction de Hector Domínguez-Ruvalcaba. Austin : The University of Texas at Austin.
Kamieniak Isabelle (2006). « Le snuff movie : rumeur, illusion et paradoxe ». Dans Gagnebin M. et Milly J. Les images honteuses. Seyssel : Champ Vallon : 409-418.
Kamieniak Jean-Pierre (2006). « Le snuff movie : un simulacre paradoxal ». Dans Gagnebin M. et Milly J. Les images honteuses. Seyssel : Champ Vallon : 400-408.
Kunz Marco (2008). “Femicidio y ficción: los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez y su productividad cultural”. Connotas. Revista de crítica y teoría literarias, Vol. 6, n°11 : 117-153.
Kunz Marco (2016). “Las ‘muertas de Ciudad Juáre’: construcción e impacto cultural de un acontecimiento serial”. Dans Kunz M., Bornet R., Girbés S. et Schultheiss, M. Acontecimientos históricos y su productividad cultural en el mundo hispánico. Zurich : Lit Ibéricas : 137-156.
Labelle Beverly (2006). “Snuff : lo último en odio contra las mujeres”. Dans Russell D. et Radford J. Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. Mexico : UNAM : 371-380.
Labrecque Marie-France (2012). Féminicides et impunité. Le cas de Ciudad Juárez. Montréal : Éditions Écosociété.
Lagarde Marcela (1996). Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid : Horas y Horas.
Laperrière Simon (2013). La légende urbaine des snuff movies. Histoire, théorie, esthétiques, technologies. Mémoire de Maîtrise sous la direction d’André Habib. Montréal : Université de Montréal.
Large Sophie (2016). « Féminicide ou génocide ? Le traitement narratif des meurtres de femmes à Ciudad Juarez ». Dans Lavaud-Fage E. et Orsini-Saillet C. Des génocides dans le monde hispanique contemporain ? Réalités et représentations, Binges : Éditions Orbis Tertius : 181-197.
Monárrez Fragoso Julia Estela (2006). “Las diversas representaciones del feminicidio y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 1993-2005”. Sistema socioeconómico y geo-referencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Propuesta para su prevención. Ciudad Juárez : El Colegio de la Frontera Norte : Tome 2 : 353-398.
Monárrez Fragoso Julia Estela (2009). Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Mexico : El Colegio de la Frontera Norte, Porrúa.
Radford Jill et Russell Diana (1992). Femicide : The Politics of Woman Killing. New York : Twayne Publishers.
Ronquillo Víctor (2004). Las muertas de Juárez. Crónica de los crímenes más despiadados e impunes en México. Mexico : Booket.
Russell Diana (2001). “Defining Femicide and Related Concepts”. Dans Russell D. et Harnes R. Femicide in Global Perspective. New York : Teachers College Press : 15-25.
Stine Scott Aaron (1999). “The Snuff Film : The Making of an Urban Legend”. Skeptical Inquirer. [URL : http://www.csicop.org/si/show/snuff_film_the_making_of_an_urban_legend Consulté le 2 juillet 2015].
Tabachnik Maud (2007). J’ai regardé le diable en face. Paris : Le Livre de Poche.
Vilar Jean-François (1987). « Préface ». Dans Mendel E. Meurtres exquis. Histoire sociale du roman policier. Montreuil : La Brèche.
Washington Valdez Diana (2007). Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano. Mexico : Océ
Pour citer cet article
Nicolas Balutet, « Enquêtes sur le féminicide à Ciudad Juárez (Mexique) : les légendes urbaines chez Maud Tabachnik, Alicia Gaspar de Alba et Kama Gutier», RITA [en ligne], n°12 : septembre 2019, mis en ligne le 12 septembre 2019. Disponible en ligne: http://revue-rita.com/dossier-12/enquetes-sur-le-feminicide-a-ciudad-juarez-mexique-les-legendes-urbaines-chez-maud-tabachnik-alicia-gaspar-de-alba-et-kama-gutier-nicolas-balutet.html



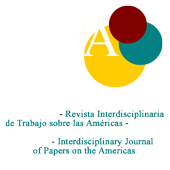










 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8