« Les femmes dans les migrations Mexique-États-Unis, le regard d’une chercheure française » - Entretien avec Anna Perraudin
------------------------------
Cléa Fortuné
Doctorante en civilisation américaine
CREW (Center for Research on the English-speaking World), EA 4399, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Guillaume Duarte
Doctorant en histoire
IHEAL-CREDA UMR 7227, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
« Les femmes dans les migrations Mexique-États-Unis, le regard d’une chercheure française »
Entretien avec Anna Perraudin
Anna Perraudin est chercheuse au CNRS depuis 2016, chargée de recherches à l’Université de Tours au sein du laboratoire CITERES, et associée au laboratoire URMIS de l’Université Paris 7. Docteure de l’EHESS en sociologie, ses recherches portent sur les circulations migratoires, le genre, et la sociologie urbaine en Amérique latine et aux États-Unis. Sa thèse, soutenue en 2011, sous la direction d’Yvon Le Bot, s’intitule Mobilités et ethnicité : l’expérience migratoire des Indiens mexicains, de la migration interne à la migration internationale. En 2018, elle a publié l’ouvrage Esquiver les frontières aux Presses Universitaires de Rennes, qui s’interroge sur les relations ethno-raciales, de genre, et de statut migratoire des Indiens du Mexique qui migrent aux Etats-Unis.
Dans cet entretien, Anna Perraudin relate son parcours de chercheuse à travers la « rencontre » avec son sujet de recherche à Mexico, la construction de rapports sociaux avec ses enquêtés sur ses terrains mexicains et étatsuniens, et expose son approche sur l’état de la recherche des migrations féminines dans les Amériques.
Entretien réalisé entre mai et juin 2019 par Cléa Fortuné, doctorante en civilisation américaine au sein du CREW EA 4399, à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et Guillaume Duarte, doctorant en histoire à l’IHEAL – CREDA UMR 7227, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, membres du comité de rédaction de RITA.
Cléa Fortuné, Guillaume Duarte : Pouvez-vous nous présenter votre parcours de recherche ?
Anna Perraudin : Tout a commencé par un heureux malentendu : alors que je cherchais un stage de fin de 4e année à Sciences Po, dans un parcours « métiers du développement », j’ai atterri au Mexique, à l’Institut de Recherche sur le Développement (IRD) – et réalisé que ce n’était pas du tout une ONG, mais un centre de recherche. Catherine Paquette, mon encadrante, m’a offert un beau sujet de mémoire : le centre historique de Mexico était en pleine transformation. Il faisait l’objet d’un projet de réhabilitation très ambitieux qui annonçait une gentrification et une mise en tourisme importante, alors que c’était jusque-là un quartier populaire, lieu d’arrivée de nombreux migrants des campagnes dans la ville, avec des logements bon marché et une foule d’emplois non qualifiés, dans le commerce informel en particulier. Mon stage visait à comprendre si les populations indiennes qui y résidaient étaient affectées par ces changements, et comment elles y réagissaient. J’ai trouvé passionnant de découvrir la société mexicaine par le prisme de la question indienne. Cela donnait à voir, d’emblée, ses richesses, ses inégalités, sa violence, ses contradictions. J’ai fait de belles rencontres, je me suis immiscée dans certaines associations indiennes[1], si bien qu’à la fin de ces six mois de stage, j’étais « mordue ».
À cette période – le milieu des années 2000 – on parlait énormément au Mexique de l’émigration vers les États-Unis, et pour cause : un Mexicain sur dix y vivait, tout le monde y avait de la famille. Pourtant, pour les populations indiennes du centre historique de Mexico, installées en ville dans les années 1990, le sujet n’était jamais évoqué. La question n’était pas posée de savoir si eux-aussi, comme semblait-il, la plupart des Mexicains, envisageaient d’améliorer leur vie aux États-Unis. Cependant, ils vivaient dans des conditions très précaires à Mexico – la plupart travaillaient dans le commerce informel, habitaient des bicoques regroupées en petits bidonvilles abrités des regards en plein cœur de la cité, dans le quartier de la Roma[2]. De surcroît ils avaient déjà une expérience de la migration, de la campagne vers la ville, ce qui au vu des travaux d’Alain Tarrius (2000) par exemple, sur le « savoir-circuler », en faisaient plutôt de bons candidats pour se lancer dans la traversée de la frontière vers les États-Unis. Partaient-ils vraiment moins que les autres, ou le regard des universitaires et des institutions était-il biaisé, à force d’être focalisé sur la problématique de l’intégration des minorités dans la ville ? S’ils partaient aux États-Unis, où allaient-ils ? Est-ce qu’une communauté ethnique se reconstituait là-bas, agrégeant des membres du village auparavant établis dans plusieurs villes mexicaines ? Que signifiait être indien dans ces nouvelles conditions de vie ? C’est à partir de ces questionnements que j’ai commencé une thèse, sous la direction d’Yvon Le Bot[3]. J’ai fini par resserrer l’analyse sur un groupe en particulier, provenant de Santiago Mexquititlán (Etat du Querétaro) et identifié comme otomi[4], et l’enquête m’a menée de Mexico vers le Wisconsin, où arrivaient beaucoup de gens de ce village, mais aussi à Los Angeles, New York, dans l’Illinois, et bien sûr dans le lieu d’origine. Aucun des migrants que j’ai rencontrés n’avaient de titre de séjour aux États-Unis. L’enquête m’a amenée à questionner la façon dont se reconstituaient les frontières de genre, d’ethnicité, de classe sociale, de citoyenneté, au cours de cette double migration, de la campagne vers la ville puis de la ville vers les États-Unis.
CF, GD : Quand la question des migrations féminines est-elle apparue dans cette recherche ?
AP : Outre mon intérêt initial pour les travaux sur la place des femmes dans les migrations, c’est d’abord le terrain qui m’a poussée vers cette thématique. Je me suis vite aperçue que les groupes indiens de Mexico rêvaient eux-aussi des États-Unis, même si cette migration était très peu visible. Le contexte urbain contribuait à cette invisibilité : dans les campagnes, certaines maisons à l’architecture ostentatoire sont tout de suite identifiables comme appartenant à des migrants – elles sont d’ailleurs construites pour cela, comme l’analyse Frida Calderón Bony (2008). Dans les villes, il n’y a pas de traces aussi tangibles. En revanche, quand les hommes partent – et dans le groupe qui m’intéressait, la migration vers les États-Unis était encore surtout initiée par des hommes – les femmes, les enfants, sont là. Comme par ailleurs ces femmes étaient isolées du reste du groupe et qu’elles avaient souvent cessé de travailler, elles étaient à la fois plutôt libres de leur temps et désireuses de partager leur expérience et leur quotidien avec moi. Elles sont rapidement devenues des piliers de mon travail de terrain. Je commençais souvent par réaliser un entretien formel, enregistré, chez elles, et puis je revenais pour leur donner le texte de l’entretien, prendre des nouvelles, partager un repas… De fil en aiguille des liens très forts se sont noués. Ce sont elles qui m’ont donné le contact de leurs époux partis aux États-Unis et c’est grâce à elles que j’ai pu comprendre comment se réorganisait la vie des Santiaguenses là-bas. À Mexico, il était très difficile d’avoir accès à ces informations si ce n’est par des biais plus classiques (en passant par des institutions, des associations ou par les « leaders » des groupes indiens). Ces femmes étaient concernées par la migration de deux façons, comme migrantes, puisqu’elles-mêmes avaient quitté leur village pour s’installer à Mexico, et comme épouses de migrants, devant gérer l’absence de leur compagnon. Le fait d’être dans ces deux positions simultanément rendait leur point de vue et leur expérience particulièrement riches.
CF, GD : Pensez-vous que les relations et les pratiques d’échanges auraient été différentes si vos enquêtés[5] avaient été confrontés à un enquêteur ?
AP : Assurément. La complicité qui s’est nouée avec les femmes tenait sans doute à ce que nous avions le même âge, le même sexe, mais des vies très différentes – je n’avais pas d’enfants, elles en avaient souvent au moins trois ; je voyageais et vivais seule. C’était source d’une curiosité et d’un intérêt mutuel, avec une liberté de parole qui n’aurait pas été la même si j’avais été un homme. J’ai partagé beaucoup de moments avec elles, leurs enfants, leurs parents. Avec les hommes, en revanche, c’était plus compliqué d’avoir accès à une parole intime. J’ai aussi réalisé assez vite que les rumeurs circulaient beaucoup dans le groupe avec lequel je travaillais. C’est un mécanisme de contrôle social courant dans la migration, comme l’a montré par exemple Victoria Malkin (2004). Je devais donc faire attention à protéger ma réputation, mais aussi celle des personnes qui faisaient des entretiens avec moi. J’ai alors évité d’en faire seule avec des hommes. À Mexico, j’ai tâché de contourner ce biais en animant des groupes de parole non-mixtes, destinés aux hommes, sur la migration et les masculinités, pour Le Colibri[6], une association de quartier qui travaillait avec les migrants indiens. Et j’ai multiplié les échanges informels dans les espaces ouverts (la rue, la cour des bidonvilles, les stands des commerçants ambulants). Cette nécessité d’adapter l’entrée sur le terrain en fonction du sexe de mes enquêtés a eu une incidence forte sur mon séjour aux États-Unis : j’y ai partagé le quotidien de deux familles, chez qui je suis restée pendant plusieurs semaines, et j’ai énormément appris en partageant ce quotidien, en écoutant les gens parler entre eux. C’est le principe de l’ethnographie bien sûr. Mais la condition pour avoir accès à ces espaces était qu’il y ait une autre femme dans la maison. En résumé, oui, le genre joue un rôle crucial dans l’accès aux données, et c’est important d’en tenir compte, dans une démarche réflexive sur les conditions et les limites de l’accès au terrain.
CF, GD : Dans le même ordre d’idée, comment vos enquêtés se positionnaient-ils vis-à-vis d’une enquêtrice non-mexicaine ?
AP : C’est aussi une question importante, qui comporte deux aspects. J’étais non seulement étrangère, mais aussi plus précisément européenne, et considérée comme blanche. Cette racialisation, couplée à cette origine géographique spécifique, était source d’une double valorisation. Il est possible qu’elle ait eu pour effet de rendre plus difficile le partage avec moi d’expériences de racisme, puisqu’il était implicite et que je n’y avais jamais été confrontée. Maud Lesné et Patrick Simon (2012) ont développé des réflexions intéressantes sur ce point. Au-delà de cette limite, être étrangère a plutôt été un atout, contre toute attente. J’ai d’abord cru que le silence que je rencontrais à Mexico quand je posais des questions sur ceux qui étaient aux États-Unis était lié à la méfiance qu’inspirait mon statut d’étrangère, avant de réaliser que ce silence opérait aussi entre Mexicains. Finalement, il était peut-être plus facile de me parler, une fois les premiers liens de confiance établis, parce qu’être Française me situait dans une position relativement neutre, par rapport à d’autres identifications que l’histoire coloniale a davantage chargé. Pour autant j’ai aussi pris conscience au cours du terrain des images que les enquêtés projetaient sur moi. À Mexico, une rumeur a circulé, selon laquelle j’avais aidé un membre du groupe à trouver du travail à Tijuana, dans une ONG. Ce soupçon de favoritisme a changé mon rapport avec certaines familles, qui se sont montrées plus distantes, envieuses. Aux États-Unis, c’était plus compliqué encore. Certains enquêtés m’ont présenté à d’autres comme « une missionnaire », et j’ai dû interrompre un entretien avec un homme qui redoutait que je ne fasse partie de la police migratoire. Dans l’ensemble, ces moments où les projections des enquêtés sur soi deviennent apparentes sont très utiles dans le travail de terrain, parce qu’ils renseignent sur la relation qui se noue avec eux, mais aussi sur l’univers subjectif de ces derniers. Il faut dire aussi que pour les populations avec qui je travaillais, « sociologue » n’avait pas beaucoup de sens et pouvait laisser matière à de vastes réinterprétations !
CF, GD : Justement, comment construire ce lien de confiance pour enquêter sur les migrations avec des populations vulnérables ?
AP : De façon très classique, je suis entrée sur le terrain en m’appuyant sur des ONG – Caritas, l’association Colibri dont je parlais plus haut. Et à Mexico il existe plusieurs associations de migrants indiens. Le premier contact a eu lieu avec les porte-paroles de ces groupes. En revanche, je ne souhaitais pas me limiter à leur discours, et l’enjeu du travail de terrain a été de multiplier les contacts en dehors de leur possible contrôle. Cela m’a demandé du temps, et a rendu indispensable le recours aux méthodes de l’enquête ethnographique. Je suis revenue, le plus souvent possible, dans les bidonvilles, sous des prétextes divers. J’ai « perdu » beaucoup de temps à jouer avec les enfants, à faire des photos, que j’imprimais pour les distribuer. À multiplier les échanges informels avec ceux qui étaient là. Mais ce qui a surtout été décisif, je crois, c’est le fait de rentrer en France puis de retourner au Mexique, année après année, de 2003 à 2009. Au fil des ans, j’ai vu grandir les enfants, bouger les familles, évoluer mes enquêtés, et cela m’a à la fois permis de mieux comprendre les choses, d’être peut-être plus juste, et aussi d’être mieux acceptée. Comme certains me l’ont dit, cela signifiait pour eux que je ne les oubliais pas. Je crois donc beaucoup aux effets de la répétition sur le travail de terrain, plus que de mener de longs entretiens formels, par exemple. Une autre thématique qui me tient à cœur est celle de la restitution. Je n’ai jamais réussi à trouver une forme de restitution qui me permette d’être utile aux personnes avec qui j’ai travaillé, de changer leur quotidien, sinon de façon très indirecte. Mais j’ai essayé le plus possible de distribuer les textes des entretiens, d’être transparente sur mes intentions et mes premières analyses, d’organiser des ateliers à mon retour des États-Unis pour partager ce que j’y avais vu. Je pense qu’au-delà de l’importance, sur un plan éthique, de réfléchir à ces questions – même s’il n’est pas facile d’apporter des solutions concrètes – cela a aussi facilité le lien de confiance établi au fil des ans.
CF, GD : Comment se passe la rencontre avec les enquêtés dans un espace aussi vaste que les États-Unis et le Mexique ? Comment se construit le réseau d’enquêtés ?
AP : C’est une question qui a eu beaucoup d’importance dans mon travail. On sait qu’a priori les migrants issus d’un même lieu ne se diffusent pas sur l’ensemble du territoire migratoire mais tendent à se regrouper dans quelques lieux, mis en rapport par les réseaux migratoires, selon le principe des « communautés jumelles ou satellites » identifiées par Roger Rouse (1992). Mon idée était donc de dérouler les réseaux migratoires constitués depuis les groupes otomis installés à Mexico et de voir où ils me conduiraient aux États-Unis – à la différence d’une autre démarche de recherche qui aurait pu consister à trouver des migrants ou des associations de migrants aux États-Unis et de voir d’où ils provenaient. À Mexico, on me parlait beaucoup de Chicago (Illinois), et j’étais donc confiante sur le fait que mon travail de terrain se déroulerait dans cette ville. Une grosse partie de mon travail d’approche a donc consisté à obtenir les adresses précises des migrants établis aux États-Unis auprès de leurs familles. Pour motiver les familles et apporter quelque chose en échange, je leur ai proposé de mettre à leur disposition un appareil photo ou une caméra et d’emmener les images à leurs proches aux États-Unis. À l’époque, en 2007, il n’y avait pas de smartphones et pas d’accès internet dans les campements otomis, les images étaient donc précieuses. Plusieurs familles ont refusé et c’était intéressant d’analyser les raisons de leur refus. D’autres ont accepté, et leur accord m’a fait réfléchir aussi. Le matériau filmique a été précieux, d’abord parce qu’il établissait tout de suite un lien de confiance avec les migrants aux États-Unis – c’était la meilleure carte de visite possible ! Ensuite parce que souvent les migrants ont souhaité renvoyer par mon biais des vidéos au Mexique, et c’était émouvant et passionnant de voir ce que les uns et les autres souhaitaient montrer de leur quotidien de part et d’autre de la frontière, et aussi d’entrevoir comment je m’insérais, sans vraiment en avoir mesuré la portée au début, dans un imbroglio de relations, d’émotions, de nostalgie, reproches, culpabilité, manque, etc. Je n’ai jamais montré ces images, trop intimes, à de tierces personnes, mais elles m’ont servi dans l’analyse. Je suis donc partie pour « Chicago » avec quatre, cinq numéros de téléphone en poche, sûre que j’allais trouver aux États-Unis des regroupements de migrants otomis provenant de Santiago, unis par des sociabilités fortes, avec peut-être des clubs de football, etc., conformément à tout ce que j’avais pu lire dans la littérature sur les « communautés ethniques transnationales »[7]. L’arrivée aux États-Unis a été une double déconvenue. D’abord, les migrants ne vivaient pas du tout à Chicago mais à Peoria (Illinois), Madison (Wisconsin), Wausau (Wisconsin), Knoxville (Illinois)… et de multiples autres villes ou bourgades que l’on pouvait, certes, de très loin, rattacher à Chicago. Je n’avais ni le temps ni le budget pour aller dans toutes ces villes, j’ai donc fait un choix et privilégié celles qui étaient à une distance raisonnable de Chicago, en particulier Wausau, dans le Wisconsin, dont plusieurs personnes m’avaient parlé en m’indiquant que c’était un lieu important dans ces réseaux migratoires. Ensuite, à Wausau, j’ai découvert qu’il y avait certes un nombre significatif de Santiaguenses, mais qu’ils se fréquentaient peu. C’est devenu mon questionnement de thèse : pourquoi cet écart par rapport au modèle de la communauté ethnique transnationale, et le contraste avec les formes de sociabilité que j’avais pu observer à Mexico chez les Santiaguenses ? Comment expliquer cette dispersion géographique, doublée d’une forme de distance sociale ? Dans quels contextes et par qui les liens ethniques étaient-ils activés ou désactivés ? Par quels liens sociaux et quelles identifications étaient-ils remplacés ?
CF, GD : Comment des migrant sans titre de séjour accueillent-ils le chercheur ?
AP : Dans l’ensemble, j’ai trouvé les migrants plutôt désireux de partager une expérience dont ils avaient conscience qu’elle était extraordinaire, tout en étant très largement partagée. La traversée de la frontière, en particulier, était un moment traumatique et fondateur dont, à ma surprise, beaucoup avaient envie de parler. En revanche, le fait d’être sans-papiers créait des contraintes très fortes sur leur rythme de vie : ils travaillaient énormément - beaucoup avaient deux emplois -, comme une majorité travaillait dans la restauration ils n’avaient jamais de jour de congé le week-end et, soumis aux desideratas des managers, ne connaissaient pas leur jour de pause à l’avance. D’ailleurs, le jour de pause, c’était le seul moment pour faire les courses, laver le linge, appeler au Mexique, se reposer un peu… c’était compliqué de leur demander du temps pour les entretiens et je suis très reconnaissante à ceux qui m’en ont accordé. Je dois beaucoup en particulier à Ana, une femme qui non seulement m’a hébergée pendant quinze jours mais qui en plus, le jour de mon arrivée à Wausau, a démissionné de son travail de serveuse, et m’a accompagnée pendant tout mon séjour à Wausau pour tenter d’ouvrir les portes. C’est aussi à elle, que je dois d’avoir été admise par mes enquêtés.
CF, GD : Revenons aux migrations féminines. Pourquoi les étudier ? Qu’est ce qui a changé dans la représentation des femmes latino-américaines dans les études migratoires ?
AP : Je crois que les transformations des études des migrations féminines en Amérique latine sont celles qui s’observent également dans d’autres aires régionales. Les femmes sont devenues visibles dans le champ des études migratoires, grâce aux travaux pionniers d’auteures comme Pierrette Hondagneu-Sotelo (2003). Elle bouscule l’image qui pouvait prévaloir de femmes suivant leur conjoint, migrant par défaut. Pour la migration mexicaine aux États-Unis, elle a montré comment des réseaux féminins d’entraide se mettaient en place pour financer le passage de la frontière aux nouvelles candidates à la migration, en faisant fi du refus des hommes de leur famille de payer le passeur. Les migrations contemporaines donnent à voir que les femmes sont souvent les moteurs du projet migratoire. Le marché du travail des pays récepteurs participe de ce processus – les sociétés réceptrices sont demandeuses de femmes employées dans les secteurs du care ou du nettoyage – c’est très notable en Espagne, mais aussi dans les migrations internes en Amérique latine, avec la figure de la « domestique », souvent issue du monde rural, ethnicisée ou racisée – on peut penser au personnage principal du film Roma, d’Alfonso Cuarón (2018). Mais les transformations des sociétés des pays d’origine expliquent aussi que l’on observe davantage de femmes qui se lancent dans un parcours migratoire de façon autonome. Beaucoup de Centraméricaines qui se dirigent aujourd’hui vers les États-Unis migrent ainsi seules ou avec leurs enfants, pour échapper à la violence sociale ou à celle de leur compagnon. Il est cependant difficile pour les femmes d’entreprendre un projet migratoire, parce que les normes de genre leur attribuent le rôle d’élever les enfants, au quotidien. Elles rencontrent donc des obstacles supplémentaires, et subissent un jugement moral – celui d’être une mauvaise mère, qui abandonne ses enfants ou les expose au danger de la traversée de la frontière – un jugement qu’elles incorporent souvent, d’ailleurs, si elles persistent à partir. Mais même dans le cas de figure où c’est d’abord l’homme qui part, les représentations classiques de l’épouse qui attend passivement son retour, souvent sous l’emprise de la belle-mère, doivent être revues. Patricia Arias (2016) a montré qu’à la suite des séparations dans les couples, c’est de plus en plus souvent auprès de leur propre famille, et non celle du conjoint, qu’elles vont chercher du soutien. Par ailleurs, l’absence des hommes permet aux femmes d’endosser d’autres rôles : d’accéder au travail rémunéré, à l’espace public et à la politique parfois. Ces transformations ne se font pas du jour au lendemain, elles ne sont pas linéaires et peuvent être très douloureuses. Mais elles contribuent à questionner, petit à petit, l’ordre de genre, au sein du couple, si ce n’est au sein de la société. Par ailleurs, même les femmes qui « restent » sont prises dans des formes de mobilité géographique – c’était un des résultats intéressants de ma thèse. Certaines de mes enquêtées sont retournées au village à la suite du départ de leur mari, d’autres ont fait le choix de rester à Mexico, mais ont été rejointes par une sœur, un frère, qui se sont installés chez elles et les ont aidé s’occuper des enfants. Les arrangements consécutifs au départ des hommes montrent qu’il est important de ne pas cloisonner mobilités internes et internationales : les systèmes familiaux se reconfigurent pour faire face au départ de l’un des membres et mettent en mouvement plusieurs personnes, sur des distances très variables.
Une précision enfin : on observe de façon générale une tendance à mettre l’accent sur les migrations des femmes quand on cherche à comprendre les transformations des rapports sociaux sexués. Mais les migrations des hommes aussi bousculent l’ordre du genre. Les travaux sur les masculinités en migration, comme ceux de Carolina Rosas (2008), sont nécessaires pour comprendre les répercussions sur les vies et les représentations des femmes. Il est donc essentiel, à mon sens, de ne pas entendre les migrations des femmes de façon fermée, exclusive.
CF, GD : Quel est l’état actuel du champ de recherche sur les « migrations féminines » dans les Amériques ?
AP : À cause de l’importance des flux migratoires, mais aussi de la diversité des phénomènes sociaux dont on a parlé à l’instant, les recherches sur les migrations féminines dans les Amériques sont nombreuses et novatrices, en particulier sur deux points, à mon sens. D’abord sur le thème des familles transnationales : comment vivre la maternité à distance ? Au passage, il y a moins d’études sur les effets de l’absence des pères, alors que c’est un sujet tout aussi important. Avec la migration, les familles sont dispersées géographiquement. Savoir qui va s’occuper des enfants de ceux qui partent, ou qui va prendre soin des parents vieillissants, est une source de préoccupation récurrente, qui retombe souvent sur les femmes puisque l’ordre de genre leur assigne ce rôle. Lorsqu’elles même ont émigré, souvent pour s’occuper des parents ou enfants d’autres femmes, il leur faut déléguer ces tâches à d’autres membres de la famille ou à des personnes extérieures, en constituant des « chaînes du soin globales » (global care chains). Gioconda Herrera (2016) propose des réflexions intéressantes sur ce point, et plusieurs documentaires donnent à voir de façon poignante ces vies en équilibre entre plusieurs lieux et fuseaux horaires. En otra casa, de Vanessa Rousselot (2015), par exemple, suit des femmes uruguayennes employées dans le service domestique à temps complet à Madrid, donc logeant chez leurs employeurs, élevant leurs enfants, et montre leurs efforts pour maintenir un lien avec leur propre famille en Uruguay.
Mais l’Amérique latine est aussi importante parce que la grande diversité de ses sociétés amène à penser les migrations féminines au prisme du genre, de la classe sociale, de la racialisation, du statut migratoire, de la sexualité. Elle se prête particulièrement bien à une approche intersectionnelle des rapports sociaux, qui propose d’analyser comment se réagencent les rapports sociaux de domination pour chaque configuration sociale, sans que leur interaction soit figée. L’importance sur le continent de dynamiques de racialisation ancrées dans l’histoire longue et renouvelée du colonialisme a aussi vu émerger des voix alternatives, que l’on peut rassembler sous l’étiquette du féminisme décolonial. Jules Falquet (2016) fait office de passeuse pour diffuser ces approches en Europe. Ce sont des espaces de pensée et de militantismes importants, qui résonnent avec des mouvements que l’on peut observer aussi en Amérique du Nord ou en Europe, en questionnant les prises de position de branches plus établies du féminisme, en rappelant les logiques de domination et la pluralité qui le structurent.
CF, GD : Y-a-t-il des distinctions notables entre la migration féminine et masculine ?
AP : Oui, à toutes les étapes du projet migratoire. Outre les difficultés plus grandes pour les mères à envisager un projet migratoire que pour leur conjoint, que l’on a déjà mentionné, on sait bien aussi que celles qui doivent traverser des frontières sans documents migratoires s’exposent à des violences terribles et spécifiques (féminicides, viols, etc.). Sur ce point, le témoignage d’Ilka Oliva Corado (2017), une migrante centraméricaine, sur sa traversée du Mexique et de la frontière Sud des États-Unis, il y a dix ans déjà, est édifiant. Tout au long du processus migratoire en outre, les femmes courent le risque d’être salies, discréditées, accusées d’être de mœurs légères. La nécessité de protéger leur réputation a des effets concrets sur leur vie quotidienne, et génère des obstacles spécifiques. Dans le Wisconsin, par exemple, les restaurants chinois ou mexicains étaient pourvoyeurs de la plupart des emplois accessibles aux immigrés latino-américains. Ils étaient jugés attractifs par les migrants parce que les employeurs fournissaient l’hébergement, dans des chambres partagées entre plusieurs employés, ce qui permettait de réduire les frais sur place et d’épargner davantage. Mais pour les femmes, il était impossible d’envisager d’être logées de cette façon. Elles se seraient exposées à trop de rumeurs. Il leur fallait trouver un logement, partagé avec d’autres femmes, si possible provenant du même lieu, afin qu’elles attestent de leur bonne conduite. C’était coûteux et cela rendait beaucoup moins attractifs ce type d’emplois dans la restauration. Mais cela soulevait aussi un autre problème, celui de la distance entre le lieu de travail et le logement, dans de petites villes où le système de transport est peu développé et inadapté aux horaires des travailleurs immigrés. Pour pouvoir travailler, les femmes devaient alors trouver quelqu’un qui les conduise en voiture à leur emploi, un ridero, en spanglish, souvent un homme. Car l’accès au permis de conduire et à une automobile étaient aussi soumis à des obstacles genrés : conduire une voiture était une prise de risque pour tous – risque d’avoir un accident, d’être arrêté pour une infraction mineure et d’être expulsé –, à laquelle s’ajoutaient des représentations négatives des compétences des femmes au volant. Les femmes se retrouvaient alors dépendantes de leurs rideros, avec un accès à l’emploi très contraint, comme conséquence, finalement, de la nécessité qui leur était faite, en tant que femme, d’avoir une conduite sexuelle irréprochable. La maternité aussi, faut-il le rappeler, crée des inégalités énormes. Les Mexicaines que j’ai rencontrées dans le Wisconsin avaient cessé de travailler les premières années après la naissance de leur enfant, faute de pouvoir en financer la garde. Cela créait des relations de dépendance économique envers le conjoint. Enfin, une autre différence que l’on peut souligner a trait au registre discursif par lequel les hommes et les femmes justifient leur projet migratoire. Ainsi, les travaux de Raquel Martínez Buján (2016) ou Sonia Parella et Alicia Petroff (2014) sur les migrations de retour des Latino-américains à la suite de la crise économique en Espagne montrent qu’une écrasante majorité des femmes justifient le retour dans leur pays d’origine par leurs obligations familiales, tandis que les hommes mettent en avant leur espoir d’y trouver de meilleures conditions économiques grâce à l’expérience acquise sur le marché de l’emploi espagnol. Le projet migratoire n’est ainsi pas interprété de la même façon. Tout au long du processus migratoire, on observe donc des différences dans les positions sociales, les obligations, les potentialités, les sentiments et les représentations des hommes et des femmes.
CF, GD : Comment définiriez-vous la position de la société mexicaine et son évolution sur les questions de genre et sur les violences sexuelles ?
AP : La société mexicaine est si diverse et inégale que j’aurais du mal à tirer des conclusions très stables. On observe des courants progressistes, en particulier à Mexico, capitale libérale qui a légalisé le mariage homosexuel, dépénalisé l’avortement, sensibilisé au harcèlement des femmes en créant des espaces non-mixtes dans le métro, condamné les féminicides… Ce dernier sujet, celui des féminicides, permet toutefois de saisir les contradictions qui perdurent autour de ce sujet. La notion de féminicide désigne des assassinats de femmes commis pour des raisons spécifiques liées au sexe de la victime – « des femmes assassinées par des hommes parce qu’elles sont des femmes », selon la définition qu’en donnent Diane Russell et Jill Radford (1992 : p. xiv). Ces morts s’inscrivent dans un continuum de violences subies par les femmes, insérées dans une culture des violences machistes. Elles mettent en cause l’État, dans son incapacité à protéger les femmes et condamner les responsables. Les disparitions et assassinats de femmes à Ciudad Juárez dans les années 1990 ont vite placé le Mexique sous les projecteurs des organisations internationales et associations civiles. Depuis, la société civile s’est étoffée. Au-delà des mobilisations des mères des victimes, de groupes féministes, ou d’organisations internationales comme ONU mujeres[8], l’Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio[9] (une coalition d’associations) produit des chiffres, de même que le très officiel Instituto Nacional de Estadística y Geografía[10] (INEGI) qui distingue dans ses statistiques de mortalité les crimes à l’encontre des femmes. Une militante, María Salguero, a créé une carte interactive qui recense et localise les féminicides depuis 2016[11]. Les mobilisations sont sorties de la zone de Ciudad Juárez et s’organisent en dehors du 8 mars, jour des combats féministes : en juillet 2018 des manifestations ont eu lieu à Chalco, dans la périphérie de Mexico, à la suite de l’assassinat d’une lycéenne[12]. Pourtant, la plus grande visibilité des féminicides, leur constitution en problème public, n’empêchent pas les violences contre les femmes d’augmenter : plus de sept féminicides par jour en 2018 selon ONU-femmes[13]. Le président de la République mexicaine, Andrés Manuel López Obrador[14], vient de lancer un plan national d’action contre les féminicides[15], avec des volets sur la prévention, le soin aux victimes et la lutte contre l’impunité. Mais il annonce en même temps la fermeture des centres privés d’accueil des femmes victimes de violence, en justifiant cette fermeture par la volonté de lutter contre la corruption et de remplacer les structures privées par des structures publiques. La mesure cause beaucoup de remous dans la société civile. Par ailleurs l’existence même des caravanes de migrants qui traversent depuis quelques mois le Mexique vers les États-Unis montre bien que la question des violences sexuelles est loin d’être résolue, et bénéficie encore d’une très large impunité.
CF, GD : Que pouvez-vous nous dire de ces caravanes et des violences sexuelles ? Quelle est la position du gouvernement mexicain quant à l’accueil de ces migrants et vis-à-vis des États-Unis ?
AP : Les caravanes de migrants sont une forme de migration groupée, allant de quelques centaines à quelques milliers d’individus. Elles représentent une stratégie nouvelle, qui fait le choix de rendre visible, par l’effet de masse, des migrants qui jusqu’alors privilégiaient l’invisibilité, la dispersion. Pour cette raison, elles sont un phénomène très intéressant à observer. La première caravane médiatisée est partie en octobre 2018 du Honduras[16]. Au fur et à mesure, s’y sont agrégés des Guatémaltèques, des Nicaraguayens, des Salvadoriens, si bien que ce groupe a atteint les 7 000 personnes, et a été suivie par au moins six autres caravanes. Le choix de migrer en groupe se justifiait par la possibilité de s’aider mutuellement et de limiter les difficultés du voyage. Cela a permis d’exposer les dangers multiples auxquels étaient exposés les Centraméricains lors de leur traversée du Mexique, à cause du crime organisé, de la corruption des policiers mexicains, et des violences sexuelles spécifiques dont on a déjà parlé pour les femmes. Dans les caravanes, on a pu voir beaucoup de femmes, d’enfants, de personnes âgées, peut-être surreprésentées justement à cause de la forme de protection offerte par le groupe. En réalité, les femmes restent tout de même des publics vulnérables, surtout celles qui voyagent enceintes, ou avec de très jeunes enfants : le voyage est plus éprouvant physiquement pour elles, les enfants tombent parfois malades, elles se trouvent ralenties et parfois isolées.
L’autre effet de la caravane, au-delà de la protection relative qu’elle offre aux migrants, est de politiser cette migration en interpellant les médias, les sociétés civiles et par conséquent les États et la communauté internationale. On peut considérer que le succès est mitigé sur ce point. Les États-Unis ont d’abord accueilli une partie des Centraméricains qui demandaient l’asile, puis en janvier 2019 ils ont obtenu que cette demande d’asile soit posée et examinée depuis le Mexique, selon le principe de l’externalisation de la procédure d’asile, devenue la norme aussi en Europe – même si un juge fédéral des États-Unis a retoqué en avril cette mesure[17]. Cela bloque les Centraméricains au Mexique. Parmi eux, une partie peut souhaiter rester au Mexique. Le gouvernement mexicain progressiste dirigé par Andrés Manuel López Obrador s’est d’abord montré accueillant, en promettant de donner des visas de travail spécifiques (visas humanitarias), en garantissant les droits et la sécurité aux migrants des caravanes. Mais on observe depuis quelques mois une inflexion dans cette politique. Entre décembre 2018 et avril 2019, les expulsions de Centraméricains ont été multipliées par trois, pour atteindre un total de 45 000 expulsions, dont 15 000 au seul mois d’avril[18]. Par ailleurs, à Tapachula, les bureaux dans lesquels sont déposées les demandes d’asile ont été fermés pendant deux mois entre la mi-mars et la mi-mai, un blocage bureaucratique qui a créé une vraie « cocotte-minute », selon le titre d’un article du quotidien El País[19], avec des milliers de migrants centraméricains, mais aussi cubains, africains, haïtiens, bloqués à la frontière sud. Ces situations de blocages, imputables aux actions – et inactions – des pouvoirs publics et à une médiatisation qui amplifie l’effet de masse des caravanes, ne sont pas sans rapport avec la montée de mouvements xénophobes à Tijuana (Basse Californie) et à Tapachula (Chiapas), un phénomène inédit dans deux villes frontalières qui étaient caractérisées par leur tradition d’accueil. En définitive, même si les expulsions, la xénophobie, les blocages aux frontières, mais aussi les solidarités étaient déjà dans le panorama des migrations entre l’Amérique centrale et les États-Unis depuis longtemps, on peut considérer que la conjonction de Donald Trump et des caravanes ont sérieusement transformé la situation migratoire au Mexique, et ouvrent de nouvelles perspectives de recherche.
Notes de fin
[1] Nous avons choisi de garder le terme « indien » pour qualifier les populations revendiquant un passé préhispanique ou ayant été catégorisées comme telles, les alternatives – « autochtones » ou « originaires » nous paraissant risquer de créer de la confusion en évoquant une sédentarité et un ancrage de ces populations qui ne correspondent pas aux mobilités géographiques analysées ici.
[2] Le quartier de la Roma est mis à l’honneur dans le film éponyme d’Alfonso Cuarón (2018), primé aux Oscars, qui dépeint le quotidien d’une employée domestique mixtèque. Les Mixtèques ou Ñuu savi, le « peuple de la pluie », forment une population indienne originaire de territoires situés à cheval sur trois États de l’actuelle République fédérale du Mexique : Oaxaca, Guerrero et Puebla. En 2010 le mixtèque était la troisième langue indienne la plus parlée au Mexique (INEGI 2010).
[3] Voir la thèse d’Anna Perraudin (2011). Mobilités et ethnicité : l’expérience migratoire des Indiens mexicains, de la migration interne à la migration internationale.
[4] Les Otomis ou Ñhañhús sont un groupe indien originaire des États d’Hidalgo, de Querétaro, de Mexico, du Michoacán, de Tlaxcala, du Veracruz, de Puebla et de Guanajuato. L’otomi était en 2010 la septième langue indienne la plus parlée au Mexique, et la seconde plus parlée dans la ville de Mexico, après le nahuatl (INEGI 2010).
[5] Nous avons choisi de ne pas utiliser l’écriture inclusive afin de fluidifier la lecture.
[6] Le Colibri ou Centro CIDES est une association fondée en 1995 pour travailler avec les Otomis du quartier de la Roma, à Mexico, initialement autour de la problématique des enfants des rues. Elle développe des activités périscolaires, des ateliers sur la violence, la santé, les addictions, pour les femmes, et est très bien implantée dans les groupes indiens. En 2006, un atelier spécifique a été ouvert pour les hommes.
[7] Note d’Anna Perraudin. J’avais aussi d’autres contacts, obtenus auprès de migrants indiens établis à Mexico mais provenant d’autres villages d’origine et d’autres groupes ethniques : à Los Angeles, une famille zapotèque et deux familles nahuas, à New York un homme mazahua, etc. J’ai réalisé un travail de terrain dans ces deux villes, mais je l’ai finalement peu exploité dans ma thèse : il était trop difficile de reconstituer une cohérence entre des villes et des parcours si disparates. J’ai finalement choisi de me concentrer sur les Otomis de Santiago. Mais ces expériences auprès d’autres familles et groupes m’ont beaucoup aidée à mieux comprendre, par opposition, la spécificité de ce que j’avais pu observer dans le Wisconsin.
[8] Voir le site : http://www.unwomen.org/fr
[9] Voir le site : https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/
[10] Voir le site : https://www.inegi.org.mx/
[11] Pour consulter la carte interactive sur les féminicides au Mexique voir le site : https://www.awid.org/es/recursos/mapa-de-feminicidios-en-mexico
[12] Voir le site : https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/marcha-piden-chalco-frenar-violencia-feminicida ; https://elpais.com/internacional/2017/03/09/mexico/1489029996_606059.html
[13] Voir le site : https://www.mediapart.fr/journal/international/050319/au-mexique-peut-mourir-juste-parce-qu-est-une-femme
[14] Andrés Manuel López Obrador a été élu président de la République fédérale mexicaine aux dernières élections présidentielles de 2018. Il était le candidat du parti d’opposition Mouvement de régénération nationale (MORENA).
[15] Il s’agit du « Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México », présenté par le gouvernement mexicain le 6 mars 2019.
[16] Voir l’article de Miriam Jordan, « A Refugee Caravan is Hoping for Asylum in the U.S. How Are These Cases Decided? ». The New York Times. 30 avril 2018.
[17] Voir l’article de Pablo Ximémez de Sandoval: « Un juez federal prohíbe que Estados Unidos obligue a los migrantes centroamericanos a esperar en México ». El País. 9 avril 2019.
[18] Voir l’article de Jon Martín Cullell: « México triplica las deportaciones de migrantes centroamericanos con López Obrador ». El País. 9 mai 2019.
[19] Voir l’article de Elena Reina « La frontera sur de México es una olla a presión ». El País. 19 avril 2019.
Bibliographie indicative
Arias Patricia (2016). « El regreso inesperado. Migración y nuevos arreglos residenciales ». Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, n° 31. Paris : Association Alhim et Université Paris 8 [URL : http://journals.openedition.org/alhim/5476. Consulté le 16 juin 2019]
Calderón Bony Frida (2008). « L’espace d’habitation comme miroir identitaire. Le cas des migrants de Patamban (Michoacán, Mexique) aux États-Unis ». Cahiers des Amériques latines, n° 59 : 57-78. Paris : Éditions de l’IHEAL.
Cuarón Alfonso (réalisateur) (2018). Roma [film], Netflix, 135 minutes.
Falquet Jules (2016). « Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition décoloniale d’Abya Yala ». Trad. de l’espagnol par Hanitra Andriamandroso (2017). Contretemps. [URL : https://www.contretemps.eu/racines-feministes-lesbiennes-autonomes-dabya-yala/. Consulté le 5 juin 2019]
Gobierno de México (2019). « Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México », lopezobrador.org [URL: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Inmujeres-Plan-Emergente-CPM-06mar19.pdf. Consulté le 07/06/2019]
Herrera Gioconda (2016). « Travail domestique, soins et familles transnationales en Amérique Latine : réflexions sur un champ en construction », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, n° 31. Paris : Association Alhim et Université Paris 8. [URL : https://journals.openedition.org/alhim/5436. Consulté le 16 juin 2019]
Hondagneu-Sotelo Pierrette (2003). Gender and U.S. Immigration Contemporary Trends. Oakland : University of California Press. [URL : http://california.universitypressscholarship.com/view/10.1525/california/9780520225619.001.0001/upso-9780520225619. Consulté le 16 juin 2019]
INEGI (2019). « Inicio », INEGI. [URL : https://www.inegi.org.mx/. Consulté le 17 juin 2019]
Jordan Miriam (2018). « A Refugee Caravan is Hoping for Asylum in the U.S. How Are These Cases Decided ? ». The New York Times, 30 avril 2018. [URL : https://www.nytimes.com/2018/04/30/us/migrant-caravan-asylum.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article®ion=Footer. Consulté le 25 juin 2019]
Lesné Maud, Simon Patrick (2012). « La mesure des discriminations dans l’enquête "Trajectoires et Origines" ». Collection : Document de travail, n° 184. Paris : INED. [URL : https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/mesure-discriminations-enquete-teo/. Consulté le 16 juin 2019]
Malkin Victoria (2004). « “We go to get ahead”: gender and status in two Mexican migrant communities ». Latin American perspectives, vol. 31, n°138, septembre : 75‑99.
Martín Cullell Jon (2019). « México triplica las deportaciones de migrantes centroamericanos con López Obrador ». El País, 9 mai 2019 [URL : https://elpais.com/internacional/2019/05/08/actualidad/1557337692_116128.html. Consulté le 16 juin 2019]
Martínez Buján Raquel (2016). « L’expérience du retour des migrants boliviens depuis l’Espagne : la prise de décision et la réinsertion dans leur pays d’origine à partir de la perspective de genre ». Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, n° 31. Paris : Association Alhim et Université Paris 8. [URL : http://journals.openedition.org/alhim/5515. Consulté le : 5 juin 2019]
Perraudin Anna (2011). Mobilités et ethnicité : l’expérience migratoire des Indiens mexicains, de la migration interne à la migration internationale. Thèse de doctorat : sociologie. Paris : EHESS.
OCNF (2019). « Inicio », Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. [URL : https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/. Consulté le 17 juin 2019]
Oliva Corado Ilka (2017). Histoire d’une sans-papiers : traversée du désert de Sonora-Arizona. Kinshasa : Éditions Nzoi.
ONU Femmes (2019). « Page d’accueil ONU FEMMES ». [URL : http://www.unwomen.org/fr. Consulté le 17 juin 2019]
Parella Sonia, Petroff Alicia (2014). « Migración de retorno en España: salidas de inmigrantes y programas de retorno en un contexto de crisis ». Dans Arango J., Moya Malapeira D., Alonso J. Inmigración y Emigracíon: mitos y realidades. Anuario de la Inmigración en España 2013. Barcelone : CIDOB : 63‑87.
[URL : https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_y_emigracion_mitos_y_realidades_anuario_de_la_inmigracion_en_espana_2013_edicion_2014/(language)/esl-ES. Consulté le 16 juin 2019.
Radford Jill, Russell Diana (1992). Femicide: the politics of woman killing. New York : Twayne.
Reina Elena (2019). « La frontera sur de México es una olla a presión ». El País, 19 avril 2019 [URL : https://elpais.com/internacional/2019/04/17/mexico/1555463562_198481.html. Consulté le 16 juin 2019]
Rosas Carolina (2008). Varones al son de la migración: migración internacional y masculinidades de Veracruz a Chicago. Mexico : El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales.
Rouse Roger (1992). « Making Sense of Settlement: Class Transformation, Cultural Struggle, and Transnationalism among Mexican Migrants in the United States ». Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 645, n°1 : 25‑52. [URL : https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/74735/j.1749-6632.1992.tb33485.x.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consulté le 16 juin 2019]
Rousselot Vanessa (réalisatrice) (2015). En otra casa [documentaire], ADAV, 54 minutes.
Salguero María (2017). « Mapa de feminicidios en México ». Awid, 18 juillet 2017. [URL : https://www.awid.org/es/recursos/mapa-de-feminicidios-en-mexico. Consulté le 17 juin 2019]
Tarrius Alain (2000). Les nouveaux cosmopolitismes : mobilités, identités, territoires. La Tour d’Aigues : Ed. de l’Aube.
Ximénez de Sandoval Pablo (2019). « Un juez federal prohíbe que Estados Unidos obligue a los migrantes centroamericanos a esperar en México ». El País, 9 avril 2019. [URL : https://elpais.com/internacional/2019/04/09/actualidad/1554765683_246857.html. Consulté le 17 juin 2019]
Pour citer cet article
Guillaume Duarte et Cléa Fortuné, « Les femmes dans les migrations Mexique-Etats-Unis, le regard d’une chercheure française », RITA [en ligne], N°12 : septembre 2019, mis en ligne le 12 septembre 2019. Disponible en ligne :http://revue-rita.com/rencontres-12/les-femmes-dans-les-migrations-mexique-etats-unis-le-regard-d-une-chercheure-francaise-entretien-avec-anna-perraudin-clea-fortune-guillaume-duarte.html



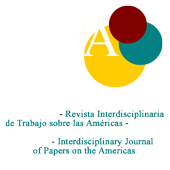










 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8