Repenser le dualisme urbain / rural. Rapport à la ville et urbanité mapuche au Chili
Cet article s’intéresse au processus d’urbanisation à l’œuvre chez les Mapuches du Chili et aux reconfigurations territoriales qui en découlent. La place et les fonctions de la ville dans l’édifice territorial autochtone sont analysées à partir des pratiques concrètes de l’espace qui révèlent une absence de rupture entre le monde de la ville et celui des communautés d’origine.
... La validité du terme d’« urbain » et de son usage pour qualifier la présence autochtone en ville y est ainsi discutée. Le simple fait de résider en ville transforme-t-il nécessairement les autochtones en « urbains » ? Sinon, dans quelle mesure peut-on alors parler d’« autochtones urbains » ? Quelle réalité, enfin, ce terme recouvre-t-il ? Plus globalement, c’est la validité même du binôme ville / campagne qui, à partir des urbanités autochtones et de l’urbanité mapuche en particulier, sera ici questionnée.
Mots clés: Ville; Urbanité; Communauté autochtone; Peuple mapuche; Chili.
------------------------------------------------
Bastien Sepúlveda
Docteur en Géographie
Chercheur associé ERIAC – E.A. 4307
Université de Rouen
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Repenser le dualisme urbain / rural. Rapport à la ville et urbanité mapuche au Chili
Introduction(1)
Enclave du pouvoir colonial dont elle a symbolisé l’imposition dans le Nouveau Monde, la ville s’y est érigée en une forteresse de laquelle les populations autochtones ont été mises à l’écart. Fondées sur des terres acquises de gré ou de force à des communautés locales qui en ont été expulsées, les villes américaines ont constitué des espaces d’exclusion repoussant l’autochtone aux frontières de l’idée même de modernité. Réceptacle des flux de la colonisation européenne, c’est à partir de la ville que se sont organisées les expéditions vers l’intérieur des terres, cet arrière-pays « sauvage » qu’elle avait à charge de domestiquer et d’administrer. C’est donc dans le rejet et l’antinomie de l’autochtone, relégué à l’état d’une nature qu’elle a repoussée à ses marges, que s’est bâtie la ville dans les Amériques (Kermoal et Léveque, 2010).
Des processus enclenchés depuis le début du siècle passé ont néanmoins rendu cette construction dichotomique de moins en moins évidente. D’une part, parce que beaucoup de communautés autochtones se voient en quelque sorte désormais « rattrappées » par la ville, que ce soit par effet d’expansion du tissu urbain (Wood, 2003) ou par la croissance démographique et la densification du bâti au sein même des villages ou communautés (Dybbroe, 2008). D’autre part, parce qu’en raison du manque de terres et de la paupérisation des économies familiales dans les communautés autochtones, celles-ci se vident depuis plusieurs décennies d’une part importante de leurs effectifs en faveur des grands centres urbains. Accentués par les dégradations liées à l’intensification des activités d’extraction et d’exploitation des ressources naturelles dans le contexte des économies néolibérales, les mouvements migratoires de populations autochtones n’ont cessé de croître à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
Des étendues glacées de l’Arctique canadien (Dybbroe, 2008) aux portes de la Patagonie (Bengoa, 1996 ; Gundermann et al., 2009), en passant par le bassin amazonien (Pinedo-Vasquez et Padoch, 2009) et l’Amérique Centrale (Camus, 2002 ; Velasco, 2007), aucune région ne semble avoir été épargnée par ce phénomène. De sorte que, d’un bout à l’autre du continent, une majorité d’autochtones répondrait aujourd’hui à la catégorie d’« urbain ». Ironie de l’histoire ? Si la ville empiète désormais sur le domaine communautaire, les territoires autochtones, en retour, semblent déborder sur les espaces urbains, dans un mouvement que l’on pourrait qualifier d’interpénétration. Se produit ainsi un effet de « brouillage » qui, rendant ville et autochtonie interdépendants, met à mal les fondements et présupposés d’une construction idéologique ayant inscrit les deux termes dans un rapport dualistique.
Partant de ces constatations, je propose d’explorer la ville comme un espace du possible, s’affirmant aujourd’hui comme un lieu central autour duquel se recomposent les territoires autochtones. Je m’appuierai, pour ce faire, sur le cas des Mapuches du Chili, chez qui j’ai réalisé de nombreuses enquêtes dans le cadre d’observations participantes lors de mes travaux de thèse (Sepúlveda, 2011). Après avoir analysé le processus d’urbanisation auquel la société mapuche s’est vue soumise au cours du siècle passé, je m’intéresserai aux réélaborations identitaires et aux modalités d’inscription des Mapuches dans la mosaïque urbaine. Enfin, je tenterai d’interroger et de reconsidérer, à partir de l’urbanité mapuche, la validité d’une idéologie ayant arbitrairement enfermé l’autochtonie du côté d’une nature antinomique à l’idée de ville et de modernité.
I. Mouvements migratoires et urbanisation mapuche au Chili
L’indépendance chilienne, gagnée entre 1810 et 1818, ne fut pas synonyme d’une remise en cause immédiate et systématique de l’autonomie jadis reconnue aux Mapuches par la Couronne espagnole. Un traité signé en 1641 dans la localité de Quilin avait effectivement érigé le fleuve Bío-Bío en une frontière séparant le royaume espagnol –au nord– d’un territoire autochtone autonome –au sud. Ce n’est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec la campagne militaire de Pacification d’Araucanie, que ce territoire sera annexé à la juridiction chilienne. Prenant fin en 1884, la campagne de « pacification » permit de soumettre les familles mapuches au régime de la Réduction. Sortes de réserves foncières données en propriété aux principaux chefs indiens, les 3.078 réductions attribués entre 1884 et 1929 eurent surtout pour fonction d’enclore les droits territoriaux autochtones et d’ouvrir l’outre Bío-Bío à la colonisation (González, 1986).
Mais en raison d’une pression démographique de plus en plus forte au sein des espaces réductionnels, les communautés mapuches furent soumises à d’importants mouvements migratoires qui prirent rapidement l’allure d’un véritable exode rural. Notons, en guise de repère, qu’entre 1929 et 1963 la disponibilité en terres serait passée de 6,1 ha. à 1,8 ha. par personne. Conjuguée à la mécanisation progressive du travail agricole, cette réalité se traduisit, à partir des années 1930, par une importante croissance des flux en faveur des grands centres urbains du pays (Almonacid, 2008). Un des modes d’insertion des migrants mapuches en milieu urbain a alors été pendant longtemps –et en partie encore aujourd’hui– le système de recrutement connu au Chili sous l’expression puertas adentro, par lequel l’employeur offre à ses salariés la possibilité de résider dans le lieu de travail.
Beaucoup d’hommes trouvèrent ainsi refuge en tant que main d’œuvre dans les boulangeries, tandis que les femmes se dédièrent majoritairement au travail domestique. Quand ils le purent, ces « travailleurs de l’ombre » fondèrent leur propre foyer hors de la résidence professionnelle. Dès cet instant, ils furent presque systématiquement rejoints par d’autres parents, tentés eux aussi par l’aventure urbaine. De tels mécanismes contribuèrent à accélerer et intensifier le processus migratoire, ce qui se manifesta par l’apparition de véritables « quartiers mapuches » au sein des grandes villes du pays (Ancan, 1994). Dans les années 1960, il a ainsi été estimé qu’entre 15% et 25% des Mapuches avaient d’ores et déjà quitté leur communauté (Almonacid, 2008). Dix ans plus tard, M. Stuchlik (1976: 75) notait « [...] qu’il ne [s’agissait] pas que de « quelques hommes », mais que presque la moitié de la population masculine adulte [avait] émigré ». Durant la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1989), le processus de liquidation des réductions, via la division des terres communautaires en parcelles individuelles attribuées à chacun des chefs de foyers, n’arrangea rien à cette situation.
Toutefois, malgré l’évidence du phénomène migratoire, les recensements n’ont jamais pris en compte les groupes autochtones autrement que dans un cadre de référence les renvoyant à une éternelle identité paysanne. Ainsi, pour les Mapuches, c’est la Réduction qui a presque systématiquement fait office d’unité censitaire de base. Passant outre la réalité d’un secteur devenu au fil du temps majoritaire au sein de la société mapuche, les chiffres officiels ont inévitablement eu tendance à minimiser l’effectif global de cette population. Un premier décompte officiel eut cependant lieu en 1952, fixant à 875 le nombre de Mapuches résidant dans la capitale chilienne. Pour C. Munizaga (1971), ce chiffre aurait été plus que sous-évalué car, à cette date déjà, les registres électoraux de la Province de Santiago faisaient état de quelques 10.000 inscrits portant au moins un nom mapuche. Pour l’année 1966, une estimation d’A. Saavedra (2002) donne une population mapuche urbaine d’environ 40.000 individus entre les différents centres urbains du pays. D’après M. Stuchlik (1976), ce chiffre se serait toutefois élevé à au moins 100.000 migrants.
Ce n’est en fait qu’à partir du recensement de 1992 que l’appartenance ethnique fut officiellement prise en compte. Aussi, l’annonce de ces résultats vint contrecarrer l’image rurale que l’ensemble de la société chilienne s’était forgée des Mapuches (Aravena, 2010). En laissant à tout un chacun la possibilité de s’identifier à l’un des trois groupes autochtones alors reconnus –mapuche, aymara et rapa nui–, le recensement de 1992 contribua à extirper l’autochtonie des espaces réductionnels(2). Plus que l’importance à la fois absolue et relative des Mapuches –plus de 900 000 individus, soit près de 10% de la population du pays–, ce qui surprit davantage fut la répartition géographique des Mapuches dans le Chili, qui ne coïncidait plus uniquement aux régions traditionnelles de peuplement –Bío-Bío, Araucanie et Los Lagos. Celles-ci ne regroupaient désormais plus que 36% d’une population résidant, pour moitié, dans la capitale chilienne.
De tels résultats signifièrent que, contrairement aux idées reçues et à l’image stéréotypée de l’autochtonie véhiculée dans l’imaginaire national, les Mapuches étaient devenus majoritairement urbains. Par extension, cela signifia également qu’un mouvement migratoire enclenché depuis plusieurs décennies avait contribué à vider le territoire historique au profit des communes du Grand Santiago. En révélant un taux d’urbanisation de près de 80% pour l’ensemble des groupes autochtones du pays, ce recensement mit à découvert une dynamique encore insoupçonnée. Mais ce qui fut d’autant plus surprenant fut de se rendre compte que la part des migrants installés à Santiago était même moindre que celle des individus y étant nés (Valdés, 1996).N’ayant jamais véritablement cessé au cours du XXe siècle, les mouvements migratoires en direction de la capitale chilienne n’étaient donc déjà plus en 1992 le principal facteur explicatif de la présence mapuche à Santiago.
Si les résultats du recensement de 2002 ont par la suite confirmé cette configuration –malgré une baisse enregistrée de 35% de l’ensemble des effectifs, en raison de la modification de la question visant à sonder l’ethnicité–, ils révélèrent néanmoins une tendance à la « relocalisation » dans le territoire d’origine. Sans avoir été fondamentalement remise en cause, la présence mapuche dans les communes du Grand Santiago fut tout de même réévaluée à environ 30% de l’effectif total, contre près de 45% en 1992. Inversement, les régions du berceau démographique historique ont retrouvé leur place, regroupant près de 59% de la population mapuche du Chili, contre seulement 36% en 1992(3).
Cela signifie-t-il pour autant que la société mapuche se soit en quelque sorte « désurbanisée » ? A l’évidence non, car les villes fondées en territoire historique sont elles aussi devenues le réceptacle d’importants mouvements migratoires. C’est par exemple le cas en Araucanie, où 29% de la population mapuche recensée en 2002 résidait en ville, principalement à Temuco qui est la capitale régionale. Même dans le territoire d’origine, la vie en communauté rurale est donc loin de caractériser l’ensemble de la population mapuche.
Carte 1 : Population mapuche au Chili en 2002 (source : auteur)
II. De l’urbanisation à l’urbanité : la ville dans l’édifice territorial autochtone
Mais si la ville s’est offerte comme une alternative au manque de terres et aux faibles rendements des agricultures de subsistance, est-elle pour autant parvenue à rompre le cercle de pauvreté dans lequel fut plongée la société mapuche à partir de la mise en réduction ? On observe, de fait, que les migrants mapuches et leurs descendants se sont intégrés au paysage urbain en tant que pauvres parmi les pauvres, dans les banlieues les plus défavorisées des grandes villes. Lieux de recomposition et de reproduction de leur identité, les périphéries urbaines sont devenues, pour les Mapuches des villes, des espaces privilégiés de sociabilité. Un espace proprement mapuche s’est ainsi structuré à l’échelle de ces quartiers, dans un mouvement d’intégration de la ville à l’édifice territorial autochtone.
A. « Mapurbe » ou l’émergence d’une nouvelle catégorie identitaire
Longtemps occultée, passée sous silence, en raison de la forte discrimination dont les autochtones sont victimes en milieu urbain, l’identité mapuche urbaine n’est véritablement sortie de l’ombre qu’au début des années 1990, dans le sillage du « réveil indien » et de la prise de conscience ayant suivi le recensement de 1992. En écho à cette résurgence, la législation indigéniste promulguée en 1993 reconnut, pour la première fois, l’existence d’autochtones urbains. En outre, elle institua la figure d’Association Indigène (A.I.) qui sert aujourd’hui de plateforme organisationnelle au mouvement mapuche urbain. En consolidant ainsi le tissu associatif mapuche en ville, la nouvelle législation contribua indiscutablement à favoriser l’affirmation des urbains en tant que nouvelle catégorie identitaire dans l’univers mapuche contemporain.
L’ascension du jeune poète mapuche urbain David Aniñir, dans le début des années 2000, illustre à merveille ce tournant. Fils de migrants mapuches installés à Cerro Navia, une commune pauvre du Grand Santiago, D. Aniñir représente cette génération d’individus nés et grandis en ville. C’est depuis cette position particulière –qu’il assume pleinement et revendique même ouvertement– qu’il s’exprime. S’identifiant successivement comme « mapuche del hormigón », « indio de la selva gris » ou encore « nieto de Lautaro tomando la micro », il évoque dans son oeuvre (Aniñir, 2009)(4) l’expérience traumatique de la migration et le dur combat des urbains devant composer leur identité dans un milieu définitivement hostile, en proie à la discrimination et l’exclusion sous toutes ses formes.
Héritier d’un silence qu’il entend briser, il investit l’espace poétique comme un véritable refuge identitaire, un lieu où la construction et l’affirmation d’une mapuchité urbaine devient possible. En ce sens, l’œuvre de D. Aniñir est tout aussi marginale et périphérique que l’identité qu’il revendique, reléguée en marge des représentations hégémoniques d’une mapuchité ancrée dans les secteurs ruraux de l’outre Bío-Bío. Fabien Le Bonniec (2009: 512) souligne très justement, à ce titre :
« David Aniñir a révolutionné la poésie Mapuche. Jusqu’au début des années 90, la poésie mapuche moderne se caractérisait par des thématiques communes liées à la terre, à la nature, à la vie quotidienne de la communauté. L'écriture bilingue s’y était imposée comme symbole de la récupération et l'exaltation d'une supposée culture ancestrale opposée au monde winka [...]. David Aniñir a coupé complètement avec ces représentations en revendiquant à travers la poésie, et d’autres arts associés, son identité mapuche urbaine et en créant le concept de mapurbe [...] ».
Ce concept de mapurbe est employé, sous la plume de D. Aniñir, comme synonyme de « Mapuche des villes », mais fait plus largement référence aux accomodements et à la resignification de l’identité mapuche en milieu urbain. Car en revendiquant et en intégrant des éléments exogènes, les jeunes générations bricolent, recomposent et actualisent en effet leur ethnicité. L’adhésion à la culture punk ou heavy-metal, par exemple, constitue pour certains d’entre eux une forme originale de résistance identitaire, une manière détournée mais innovante d’exprimer la situation d’exclusion dont ils sont victimes, tout en facilitant la création de ponts avec d’autres secteurs de la société (Barros Cruz, 2009)(5). Inévitablement, ces accomodements génèrent, comme le suggère Claudia Briones (2007), un certain nombre de frictions voire de ruptures, tant vis-à-vis des classifications hégémoniques communément acceptées que de la position de repli et de camouflage identitaire des aînés.
Reprise et revendiquée par de jeunes urbains de la province argentine de Río Negro partageant cette expérience de l’exclusion sociale, la catégorie mapurbe s’est vite répandue et son usage s’est ainsi généralisé à l’ensemble de la société mapuche, de part et d’autre des Andes (Kropff, 2004). Ces jeunes urbains, qui entretiennent de nombreuses similitudes avec la réalité décrite dans les poèmes de D. Aniñir dont ils s’inspirent, se sont conformés en Equipe de Communication MapUrbe qui publie une revue fanzine éponyme(6). Distribuée de manière informelle dans les principaux centres urbains de la Province de Río Negro, comme San Carlos de Bariloche et General Roca, cette revue est destinée prioritairement aux jeunes Mapuches des quartiers marginaux des villes de Patagonie. En outre, le défi posé par ses rédacteurs est de proposer une alternative possible aux discours ruralisants qui, en redonant à l’expérience urbaine une certaine épaisseur historique, permette de l’inscrire dans la continuité des processus socio-politiques propres à la société mapuche (Cañuqueo et Kropff, 2007).

Image 1 : Couverture de la revue MapUrbe, Año 3, n°12 (source : Equipo MapUrbe)
Ainsi resignifée par les jeunes générations, la ville devient un espace identitaire dont la pratique et l’appropriation contribuent à restructurer l’édifice territorial autochtone(7). Pour autant, la ville ne cesse d’être rappellée à la mémoire collective tel un lieu définitivement adverse, symbole de l’établissement et de l’imposition du pouvoir colonial, vaste structure de béton recouvrant et asservissant la terre jadis usurpée aux ancêtres ! Dans ses poèmes, par exemple, D. Aniñir (2009) utilise parfois le terme « Santiagóniko » pour se référer à la capitale chilienne qu’il qualifie même allègrement de « mierdópolis », comme pour en souligner la charge hautement négative.
La ville, en somme, apparait dans le discours mapurbe comme un lieu hostile que l’on ne renonce pourtant pas à s’approprier ou, plutôt, à se réapproprier.Mais par-delà toute tentative de renversement symbolique des codes et des fonctions assignées aux espaces urbains, on observe que les pratiques très concrètes des individus prennent corps et s’inscrivent systématiquement au niveau du quartier. C’est alors à cet échelon, investi comme espace de vie et de sociabilité primordial, qu’une territorialité mapuche urbaine se dessine.
B. La formation d’une territorialité mapuche urbaine
Comme cela a été signalé plus haut, les logiques de regroupement familial structurant le patron migratoire mapuche ont engendré des processus d’agglomération au sein des communes les plus pauvres des grands centres urbains. Si certaines communes du Grand Santiago, comme Cerro Navia ou La Pintana, comptaient ainsi en 2002 des concentrations de population mapuche s’élevant à plus de 6%, ces chiffres sont souvent plus significatifs encore à l’échelle du quartier. Des études menées dans ces deux mêmes communes ont effectivement démontré que, dans certains quartiers, la proportion de population mapuche pouvait augmenter considérablement. A Cerro Navia, par exemple, dans le quartier Sara Gajardo, N. Gissi (2001) recense une population mapuche d’environ 30%.
Dans un quartier de la commune de La Pintana, M. Valdés (1996) en dénombre au moins tout autant et précise même que dans l’un de ses pâtés de maisons, 115 des 129 voisins recensés, soit 89,14% de ses habitants, sont Mapuches. Mais l’auteur insiste également sur le fait que tous les voisins de plus de 50 ans sont des migrants provenant du même secteur d’origine et qu’ils sont liés par des liens de parenté directs avec leurs proches voisins –fils, frères, cousins, etc. On se trouverait là, selon lui, face à « [...] une forme d’interrelation et de production sociale similaire au comportement du Lof [structure communautaire traditionnelle] » (Valdés, 1996: 50). Or, toujours d’après le même auteur, cette situation caractériserait près de 58% de la population mapuche recensée dans les neuf communes du Grand Santiago où cet effectif est le plus significatif.
Le rôle des réseaux de parenté dans l’explication des patrons de distribution de la population mapuche donnerait ainsi lieu à ce que N. Gissi (2001) nomme une « production incessante de différenciation et auto-ségrégation », faisant du quartier un nouveau « groupe socioterritorial de référence ». Mais l’importance de ces réseaux ne se limite pas à ce seul aspect car, plus globalement, l’activation des liens de parenté constitue un point d’appui essentiel servant de médium à l’insertion de l’ensemble du groupe dans le milieu urbain.
A. Aravena (2010: 465) enregistre, à ce propos, une « tendance de la population mapuche immigrée à se réfugier dans des stratégies économiques familiales » qui, dans bien des cas, constituent la principale source de revenus. L’effet de cette tendance est bien entendu de maintenir la cohésion du groupe parental qui, en ville, semble se reproduire et se territorialiser selon un schéma assez semblable à celui de l’univers des communautés rurales. Les logiques économiques à l’œuvre chez les migrants et leurs descendants accompagnent, consolident et participent donc pleinement d’un processus de territorialisation se matérialisant par la restructuration du lof au sein des espaces urbains.
Si le quartier constitue le cadre de référence de l’identité mapuche en milieu urbain, la commune s’est alors convertie en un cadre d’action incontournable de la vie associative. C’est à cet échelon que se déploie et prend effectivement place l’action collective autochtone. S’exprimant la plupart du temps par la revendication d’un lieu pour la réalisation des réunions et activités inhérentes au développement associatif, les demandes des urbains visent également l’obtention et la reconnaissance d’un espace institutionnel propre, d’une place au sein de l’administration municipale. C’est ainsi, par exemple, qu’est apparu le Parc des Peuples Autochtones dans la commune de El Bosque, à Santiago, où l’association Mahuidache a obtenu l’installation d’un vaste complexe socio-culturel qui, outre sa fonction primordiale de recréaction d’un espace communautaire propre, sert également désormais de base à la mise en place de parcours ethno-touristiques mettant en réseau différentes initiatives vouées à la valorisation de l’identité autochtone en milieu urbain(8).
Plus ambitieux encore, certains envisagent l’intégration de ce genre d’espaces au cœur de quartiers ethniques s’apparentant sous certains aspects à de véritables gated communities dont les fonctionnalités ne seraient toutefois pas simplement résidentielles. L’idée vise en effet à recréer, en ville, un espace communautaire clairement délimité, semblable à ce qui relève, dans le territoire d’origine, du domaine des anciennes réductions. Les urbains, on le voit, tentent d’accommoder de la sorte le lexique de la « récupération » au contexte de la ville, mobilisant pour ce faire une conception du territoire en tant qu’espace quadrillé, surface bornée, appropriée et exclusive, rappelant le paradigme territorial de l’Etat moderne. En-deçà, leurs pratiques tendent pourtant à dessiner les contours d’un territoire structuré par des réseaux de parenté qui, ne se ceignant pas à l’horizon fermé et restreint du quartier, connectent la ville à l’univers communautaire d’origine.
III. Reconsidérer le couple ville / campagne à la lueur de la « mapurbanité »
Je tenterai de démontrer, dans cette dernière partie, qu’espaces urbains et ruraux ne fonctionnent pas de manière autonome mais interdépendante. La ville, en effet, semble s’articuler à l’univers rural post-réductionnel selon des modalités qui conduisent à reconsidérer le concept de communauté autochtone –indéfiniment ancré dans la ruralité– et, dans son sillage, la validité même du binôme ville / campagne. Abordée alors dans sa dimension spatiale, c’est-à-dire dans la manière dont elle informe et s’inscrit dans l’espace, l’urbanité mapuche ou « mapurbanité » devrait permettre de mieux cerner la place de la ville et ses modalités d’inscription dans la géographie contemporaine du territoire mapuche.
A. Une communauté translocale
La migration en milieu urbain n’implique pas nécessairement de rupture vis-à-vis des communautés d’origine. Celles-ci, au contraire, continuent de constituer un espace de référence pour les migrants et leurs descendants qui s’estiment redevables à l’égard du groupe familial. Sur cette base, des flux financiers et économiques s’instaurent entre les deux pôles, conférant aux migrants un protagonisme notoire et indiscutable dans les affaires de la communauté. F. Almonacid (2008: 142) précise que dans les années 1930, déjà, « [les migrants] étaient un élément fondamental pour la subsistance de la communauté, car ils maintenaient des contacts avec leurs parents et leur envoyaient de l’argent régulièrement [...] ». Ces apports sont parfois si conséquents qu’ils peuvent même, dans certains cas, bouleverser le patron des économies familiales. A la fin des années 1960, M. Stuchlik (1976: 94) notait ainsi « [qu’] un groupe domestique peut aussi cesser de réaliser certaines tâches ou les limiter lorsqu’il reçoit une aide économique constante d’un membre qui travaille en ville (un fils généralement) ». En ce sens, les migrants [permettent] que la communauté reste viable pour ceux qui s’y [maintiennent] » (Almonacid, 2008: 142).
On ne peut toutefois manquer de signaler que ces échanges se caractérisent, dans la pratique, par une certaine réciprocité des flux, permettant alors d’entrevoir la migration comme une stratégie économique familiale plutôt qu’individuelle. Cette forme d’échange réciproque et bilatéral de biens tant matériels que financiers s’accompagne, de plus, d’une importante circulation de personnes faite « [...] d’allées et venues incessantes dont témoigne la quantité de bus, toujours pleins, reliant les communautés et secteurs ruraux aux grandes villes du pays, particulièrement Santiago » (Bengoa, 1996). Les mois d’été, notamment, sont une occasion propice à la venue des urbains dans leur communauté d’origine où, durant plusieurs semaines, ils participent aux tâches agricoles, nombreuses à la période des récoltes (Ancan et Calfío, 1999).
La célébration des cérémonies religieuses traditionnelles, généralement à l’issue de ces travaux, est probablement l’une des formes les plus efficaces, pour les migrants, d’entretenir, renouveler et renforcer les liens avec leur communauté. Outre signifier et réaffirmer l’appartenance du migrant à une communauté « de sang », fondée sur la parenté, la participation aux cultes l’inscrit également dans une communauté mystique et hautement symbolique, fondée sur un lien spirituel. Inversement, pour les cérémonies célébrées en ville, il est fréquent que l’on fasse appel aux chamanes des communautés. Mais notons que ce type de « recrutement » ne se fait pas au hasard : les chamanes proviennent généralement de la communauté d’origine de l’une des familles de l’association qui organise la cérémonie. Mobilisées d’un côté comme de l’autre, les composantes du groupe familial continuent donc, par-delà les distances, de former une unité dont la cohésion tient au maintien d’une relation de connivence entre les migrants et leurs parents restés dans la « communauté ».
La prise en compte de cette réalité amène donc, comme le suggèrent Gundermann et al. (2009: 25), « [...] à reconsidérer la migration et la diversité de formes de mobilité comme un déracinement simple et définitif de la ruralité ». Si, en effet, le migrant ne cesse d’appartenir à sa communauté d’origine, la recréation d’une sociabilité mapuche en ville ne peut à proprement parler faire de l’association urbaine un substitut de la communauté rurale. Ces deux espaces, coextensifs, s’articulent en fait au sein d’une même unité ni complètement rurale, ni complètement urbaine. Il n’y a donc pas véritablement de reproduction de modèles préétablis qui, adaptés et transférés au contexte de la ville, feraient de l’association mapuche urbaine un simple succédané des structures servant de cadres d’organisation aux communautés des milieux ruraux. Plus que de reproduire ces cadres, les associations urbaines en sont la continuité et l’extension.
L’espace communautaire mapuche s’inscrit, dès lors, en porte-à-faux vis-à-vis de la définition officielle, rigide et restreinte, mais communément acceptée, dans laquelle on voudrait l’enfermer –le domaine de l’ex-Réduction. Extirpée du terroir et des espaces réductionnels par la migration, la communauté « [...] ne peut plus être définie comme une entité close et bien délimitée mais plutôt comme une structure toujours davantage multicentrée, dont les limites sociales sont devenues plus symboliques que matérielles » (Hirt, 2008: 305). Le contenu a ainsi littéralement debordé de son contenant, dont la substance et la nature doivent inévitablement être reconsidérées. Dans une tentative d’adaptation du concept, Gundermann et al. (2009) proposent ainsi l’expression de « communauté translocale », que je reprends dans l’intitulé de cette section.
Plutôt que l’artisan d’une destructuration annoncée de la communauté, la migration se doit donc d’être considérée comme le vecteur de son extension qui dépend alors de la mise en réseau des sites empruntés et parcourus par les membres composant ladite communauté. Faisant résolument abstraction du cadre géographique, l’espace communautaire mapuche semble pouvoir se définir tel un lien social constamment réactualisé. Ses limites, portées par des agents mobiles, ne s’inscrivent que très partiellement dans une étendue physique déterminée. Aussi, comme A. Aravena (2003: 177), « notre façon de comprendre la communauté fait allusion à l’espace construit par les propres acteurs, comme lieu de référence et d’affirmation de soi, indépendamment de leur localisation géographique (rurale/urbaine) ».
B. La ville, un territoire de plus ?
L’appelation d’« urbain » devient dès lors problématique, puisque « [...] ne rendant pas compte [...] du double processus de la migration mapuche : campagne-ville et, vice-versa, ville-campagne » (Gissi, 2004), elle inscrit tacitement une distinction de caractère dichotomique entre ceux résidant en ville et les autres qui vivent dans les terroirs d’origine. Or, si certains parmi les « urbains » n’ont effectivement parfois jamais mis les pieds dans les communautés de leurs parents, ils ne sont pas moins intégrés à des réseaux familiaux et d’échange qui, d’une manière ou d’une autre, les connectent à ces espaces de référence. Pouvant ainsi s’avérer effective et efficace à l’échelle individuelle, cette dichotomie identitaire perd tout son sens au niveau de cette collectivité élémentaire qu’est le groupe familial.
Il convient donc là d’insister sur le fait que ville et campagne constituent les deux pôles complémentaires et imbriqués d’une territorialité battant en brêche toute forme de classification binaire simplificatrice. Dans les années 1960, déjà, M. Stuchlik (1976: 76) enregistrait que le migrant pouvait revenir s’il le voulait, qu’en pratique, il était considéré comme « temporairement absent (même si « temporairement » signifie pour le reste de sa vie) », et qu’il était « commun qu’un homme vive entre deux à dix ans à Santiago et ensuite revienne ». Aujourd’hui encore, il n’est pas rare que certaines familles reviennent s’installer sur leurs terres. Ce « retour », pourtant, n’est jamais pleinement satisfaisant ni toujours définitif, pouvant alors donner lieu à un nouveau départ. Se forge ainsi le sentiment d’une relative indéfinition spatiale faisant de la communauté un cadre territorial dont les ancrages ne sont pas seulement multiples mais également mouvants.
Les conclusions à tirer de cette réalité coïncident en ce sens pleinement avec celles avancées par I. Hirt. Etant parvenue à déterminer qu’environ 65% des membres de la communauté Chodoy Lof Mapu résident et travaillent à l’extérieur du terroir d’origine, elle souligne « [qu’] il faut toutefois garder à l’esprit que ces chiffres ne reflètent qu’un « arrêt sur image » d’une situation à un moment déterminé, qui peut fluctuer régulièrement » (Hirt, 2008). Il n’y a effectivement rien de fixe ou d’arrêté en la matière, la communauté devant être entendue comme une structure souple, dynamique, ouverte au changement et en perpétuelle redéfinition ; un réseau de parenté dont les assises territoriales varient et évoluent au rythme des mobilités individuelles et collectives des composantes dudit réseau.
Plutôt que de voir dans la migration un facteur de différenciation spatiale, un seuil marquant le passage entre deux types d’espaces distincts –la campagne et la ville–, on soulignera donc la pertinence de l’unité du groupe de parenté dans l’analyse d’une territorialité embrassant villes et campagnes de manière transversale. Plutôt qu’une aire surfacique dont l’extension demeure relativement incertaine, le territoire mapuche se configure ainsi tel un vaste réseau aux connexions aussi nombreuses que mouvantes, nous amenant non seulement à considérer qu’un même site peut servir de point d’établissement à plusieurs groupes, mais aussi qu’un même groupe peut s’établir indifféremment et simultanément sur plusieurs sites. Faisant fi du cadre géographique, le territoire devient une unité discontigue dans l’espace, plus topologique que topographique.
Au refus exprimé par M. Valdés (1996) d’interpréter la migration mapuche comme un facteur de destructuration et de désarticulation culturelle, il faut donc ajouter que, d’un point de vue géographique, ce mouvement migratoire ne peut être analysé en termes de déterritorialisation / reterritorialisation, mais plutôt dans le sens d’une extension de l’espace communautaire au contexte urbain. La ville ne serait donc pas, comme certains le proposent, « un territoire de plus » (Bello, 1997), mais un site qui, pratiqué comme tout autre, se verrait ainsi happé et intégré à l’édifice territorial autochtone. Bien que cette territorialité « de la pratique » soit niée ou, du moins, voilée par une territorialité « du discours », elle constitue indiscutablement le socle sur lequel se fondent les modes de territorialisation mapuche en ville. Si une distinction doit donc être faite, ce n’est sûrement pas celle supposée entre un territoire urbain et un territoire rural, mais plutôt celle résidant dans l’existence d’une multitude de réseaux s’entrecroisant et s’articulant, chacun à des degrés divers, sur ces deux pôles complémentaires que sont la ville et la communauté rurale.
Conclusion
L’expérience mapuche montre comment le rapport à la ville et la pratique des espaces urbains interrogent tant les catégories de « communauté autochtone » que d’« autochtone urbain ». Dans un contexte où la communauté s’étend désormais à la ville par le maintien de solidarités familiales faisant fi du cadre géographique, peut-on légitimement continuer à l’enfermer dans un univers strictement rural ? Comme cela a été démontré, la communauté est une unité sociale qui se compose d’individus pouvant aussi bien vivre en ville qu’à la campagne. D’autre part, les « urbains » peuvent-ils vraiment être qualifiés comme tels alors que leur identité se négocie fondamentalement par leur appartenance et leur insertion dans des réseaux de parenté plurilocalisés ? On notera, à ce propos, que si la ville peut être considérée comme un nœud parmi d’autres au sein d’un vaste réseau migratoire polycentrique, le rapport qu’entretiennent les autochtones à son égard –leur urbanité– informe en même temps sur la manière dont elle contribue à (re)configurer les territorialités contemporaines.
Mais en questionnant la dichotomie idéologiquement installée entre villes et campagnes, les urbanités autochtones invitent aussi à repenser le concept même de ville dont la définition peut difficilement se limiter à un aspect purement morphologique, sous peine de l’enfermer dans une conception culturellement et historiquement marquée, celle de la modernité occidentale (Louiset, 2010). En Amérique, l’imposition d’une telle conception a signifié l’éviction des autochtones de l’idée même de ville dont l’acte de fondation, obéissant à la doctrine de la terra nullius, a invisibilisé toute forme d’occupation préalable. Bannis pour ainsi dire de l’histoire des villes fondées dans leurs territoires, les autochones ont pourtant bien contribué, par leur travail et différentes formes d’échanges –commerciaux, culturels, etc. –, à la croissance et la prospérité des grands centres urbains (Kermoal et Lévesque, 2010).
Il existe donc indéniablement, comme le revendiquent Nathalie Kermoal et Carole Lévesque (2010), « une histoire autochtone de l’urbanité » dont la prise en compte ne permet pas seulement de rendre justice à une réalité historique niée et idéologiquement occultée par la colonialité d’un pouvoir (Quijano, 2000) ayant arbitrairement relégué l’autochtonie à une ruralité totalisante. Reconnaitre et assumer cette réalité, ce n’est pas non plus uniquement se donner la possibilité d’envisager la ville comme un « palimpseste » afin d’en réécrire l’histoire (Kermoal et Lévesque, 2010). C’est aussi tenter de réévaluer et élargir la compréhension d’un concept dont la « refondation » invite à se défaire d’une conception eurocentrique linéaire simplificatrice, dans le sillage des jalons posés dans d’autres ailleurs d’une géographie culturelle de la ville (Louiset, 2012).
L’invitation, en somme, est à s’engager dans un renouveau conceptuel capable d’envisager la ville comme un objet géographique dont la nature et l’actualisation des formes résultent également des transformations produites par les processus contemporains. Car si la définition de l’autochtonie s’est effectivement ouverte à la ville, celle-ci, en retour, doit aussi s’ouvrir à l’autochtonie.
---------------------------------------
Notes de fin
(1) A l’origine d’une communication présentée dans le colloque « Dépasser les dichotomies : penser autrement les Amériques ? » (Paris, 3 et 4 mai 2012), cet article reprend et synthétise les résultats développés dans une publication parue dans la revue Espace, Populations, Sociétés (2011/2), sous le titre « Entre villes et campagnes. Mobilités contemporaines et stratégies territoriales mapuches au Chili ». Les modifications apportées au texte d’origine (profondément remanié) ont été enrichies par les commentaires des évaluateurs de la table ronde « Villes et Campagnes » que je tiens à remercier.
(2) La question référant à l’appartenance ethnique fut ainsi posée : « Si vous êtes Chilien, à quelle culture vous identifiez-vous ? a/ mapuche ; b/ aymara ; c/ rapa nui et d/ aucune des précédentes ».
(3)L’ensemble des chiffres et données censitaires proviennent des enquêtes officielles de 1992 et 2002 dont les résultats sont consultables sur le site officiel de l’Institut National de Statistiques du Chili : http://www.ine.cl/
(4) Le recueil Mapurbe. Venganza a raíz, de David Aniñir, a été édité une première fois de manière informelle et à compte d’auteur en 2005. Bien que diffusé en mains propres, dans des cercles relativement restreints, Mapurbe connut un véritable succès et fut alors réédité et commercialisé par Pehuen Editores en 2009.
(5) Plus récemment, le hip-hop s’est aussi converti en un puissant outil de revendication identitaire pour les jeunes Mapuches des banlieues défavorisées. En témoigne par exemple l’émergence du groupe Wechekeche Ñi Trawun de Santiago. Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’entretien publié en 2007 dans l’édition n°24 (pp. 20-21) du périodique mapuche Azkintuwe : http://www.mapuche.info/azkin/azkintuwe_24.pdf
(6) Le travail de l’équipe MapUrbe entre dans le cadre plus large des activités réalisées par les membres du réseau de la Campagne d’Autoaffirmation Mapuche Wefkvletuyiñ – Estamos Resurgiendo, constitué en 2002 à San Carlos de Bariloche. Une sélection d’articles publiés entre 2011 et 2006 dans la revue MapUrbe est disponible sur le site web de Wefkvletuyiñ : http://hemi.nyu.edu/cuaderno/wefkvletuyin/campana_cas.htm. On y retrouve notamment un entretien avec David Aniñir.
(7)Par-delà les efforts de resémentisation des jeunes générations de mapurbes, l’identité mapuche urbaine a également été reformulée à l’aide du terme warriache qui, littéralement, signifie « gens –che– de la ville –warria– ». Apparue à la fin des années 1990 en référence aux migrants et à leurs descendants, en somme, à l’ensemble des Mapuches vivant aujourd’hui en ville, warriache peut être considérée comme une catégorie moins restrictive que mapurbe (Aravena, 2010).
(8) Un projet de Red de Turismo Indígena s’appuyant sur plusieurs initiatives préexistantes dans différentes communes du Grand Santiago a effectivement vu le jour en 2010. Financé par des fonds publics de la CORFO et soutenu et exécuté par l’Institut d’Etudes Avancées (IDEA) de l’Université de Santiago du Chili (USACH), son principal objectif, tel qu’on peut le lire sur la page officielle dudit réseau, consiste à « creér et mettre en place un programme de diffusion technologique, voué au développement de capacités entrepreunariales et de gestion d’un tourisme autochtone durable et avec identité » (source : http://www.turismoindigena-rm.cl).
Bibliographie
Almonacid Fabián (2008). « La división de las comunidades indígenas del sur de Chile, 1925-1958: un proyecto inconcluso ». Revista de Indias, Vol. LXVIII, n°243 : 115-150.
Ancan José (1994). « Los urbanos: un nuevo sector dentro de la sociedad mapuche contemporánea ». Pentukun, n°1 : 5-15.
Ancan José, Calfío Margarita (1999). « El retorno al país mapuche: preliminares para una utopía por construir ». Liwen, nº5 : 43-77.
Aniñir David (2009). Mapurbe. Venganza a raíz. Santiago de Chile : Pehuen Editores.
Aravena Andrea (2010). Modernité, ethnicité et migration : la recomposition des identités sociales indigènes vers la fin du XXe siècle (le cas des Mapuche-Warriache à Santiago du Chili). Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Thèse de Doctorat.
Aravena Andrea (2003). « Los Mapuches-Warriaches: procesos migratorios contemporáneos e identidad mapuche urbana ». América Indígena, Vol. LIX, n°4 : 162-188.
Barros CruzMaría José (2009). « La(s) identidad(es) mapuche(s) desde la ciudad global en Mapurbe. Venganza a raíz de David Aniñir ». Revista Chilena de Literatura, n°75 : 29-46.
Bello Alvaro (1997). Un territorio más: consideraciones en torno a la identidad mapuche en la ciudad. Piriaoplis, Secunda Reunión de Antropología del MERCOSUR.
Bengoa José (1996). « Población, familia y migración mapuche. Los impactos de la modernización en la sociedad mapuche. 1982-1995 ». Pentukun, n°6 : s/p.
Briones Claudia (2007). « ‘Nuestra lucha recién comienza’. Vivencias de pertenencia y formaciones mapuche de sí mismo ». Avá, n°10 : 23-46.
Camus Manuela (2002). Ser indígena en Ciudad de Guatemala. Guatemala : Editorial FLACSO.
Cañuqueo Lorena, Kropff Laura (2007). « MapUrbe’zine: los cuerpos de ‘la lucha’ en el circuito Heavy-Punk Mapuche ». E-misférica, n°4(2), en ligne : http://www.hemisphericinstitute.org/journal/4.2/esp/es42_pg_canuqueo_kropff.html
Dybbroe Susanne (2008). « Is the Arctic really urbanising? ». Etudes/Inuit/Studies, 32(1) : 13-32.
Gissi Nicolás (2004). « Los Mapuche en el Santiago del siglo XXI: desde la ciudadanía política a la demanda por el reconocimiento ». Cultura Urbana, nº1 : s/p.
Gissi Nicolás (2001). « Asentamiento e identidad mapuche en Santiago: entre la asimilación (enmascaramiento) y la autosegregación (ciudadanía cultural) ». Dans, Colegio de Antropólogos deChile (ed.). Actas del CuartoCongreso Chileno de Antropología (Santiago, 2001). Santiago de Chile : Cd-Rom.
González Héctor (1986). « Propiedad comunitaria o individual. Las leyes indígenas y el pueblo mapuche ».Nütram, Año 2, n°3 : 7-13.
Gundermann Hans, González Héctor, De Ruyt Larisa (2009). « Migración y movilidad mapuche a la Patagonia argentina ». Magallania, Vol. 37, n°1 : 21-35.
Hirt Irène (2008). Redistribuer les cartes : approche postcoloniale d’un processus de cartographie participative en territoire mapuche (Chili). Université de Genève, Thèse de Doctorat.
Kermoal Nathalie, Lévesque Carole (2010). « Repenser le rapport à la ville : pour une histoire autochtone de l’urbanité ». Nouvelles Pratiques Sociales, vol. 23, n°1 : 67-82.
Kropff Laura (2004). « ‘Mapurbe’: jóvenes mapuche urbanos ». Kairós, Año 8, n°14, en ligne : http://www.revistakairos.org/k14-archivos/laura%20kropff.pdf
Le Bonniec Fabien (2009). La fabrication des territoires Mapuche au Chili de 1884 à nos jours. Communautés, connaissances et Etat. EHESS / Universidad de Chile, Thèse de Doctorat.
Louiset Odette (2012). « Pour une géographie culturelle de la ville : ‘A passage to India’ ». Annales de Géographie, n°684 : 172-193.
Louiset Odette (2010). « La ville pour nature ». L’Information Géographique, 2010/3 - vol. 74 : 6-22.
Munizaga Carlos (1960 [1971]). Vida de un araucano. El estudiante mapuche Lorenzo Aillapán en Santiago de Chile, en 1959. Santiago de Chile : Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Antropológicas y Arqueología.
Pinedo-Vasquez Miguel, Padoch Christine (2009). « Urban, Rural and In-between: Multi-Sited Households Mobility and Resource Management in the Amazon food Plain ». Dans, Alexiades M. (ed.). Mobility and Migration in Indigenous Amazonia. Contemporary Ethnoecological Perspectives. New York / Oxford : Berghahn Books : 86-96.
Quijano Aníbal (2000). « Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina ». Dans, Lander E. (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales : 201-246.
Saavedra Alejandro (2002). Los Mapuche en la sociedad chilena actual. Santiago de Chile – Valdivia : LOM Ediciones – Universidad Austral de Chile.
Sepúlveda Bastien (2011). Les Mapuches du Chili : des représentations aux pratiques de l’espace. Géographie(s) d’un territoire autochtone. Université de Rouen, Thèse de Doctorat.
Stuchlik Milan (1999 [1976]). La vida en mediería. Mecanismos de reclutamiento social de los mapuches. Santiago de Chile : Soles Ediciones.
Valdés Marcos (1996). « Notas sobre la población mapuche de la Región Metropolitana: un avance de investigación ». Pentukun, n°5 : 41-66.
Velasco Laura (2007). « Migraciones indígenas a las ciudades de México y Tijuana ». Papeles de Población, n°52 : 184-209.
Wood Patricia (2003). « ‘A Road Runs Through It:’ Aboriginal Citizenship at the Edge of Urban Development ». Citizenship Studies, 7(4) : 463-479.
Pour citer cet article:
Sepúlveda Bastien, «Repenser le dualisme urbain / rural. Rapport à la ville et urbanité mapuche au Chili », RITA, N°6: février 2013, (en ligne), mis en ligne le 28 février 2013. Disponible en ligne http://www.revue-rita.com/villes-et-campagnes/bastien-sepulveda.html



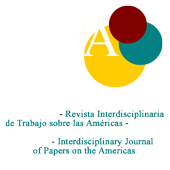









 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8