Faire une ethnographie du passé : le cas de la réception populaire des politiques culturelles en Colombie (1930-1946)
Les politiques nationalistes sont souvent abordées sous l’angle de l’histoire des idées politiques. L’analyse se focalisant sur l’évolution des idéologies et des processus mis en place par l’élite politique. Cependant un processus tel que le nationalisme, dont l’acteur principal est le peuple dans sa globalité et son hétérogénéité, ne peut être compris par la seule analyse des actions des gouvernants. Ce peuple gouverné et crée par l’élite reçoit et interprète ses politiques. La question de la réception populaire des politiques de nationalisme mérite donc d’être traitée...
... La recherche politique de la Nation, considérée selon le modèle occidental comme le cœur des systèmes politiques modernes, intervient en Amérique latine après un XIXème siècle marqué par l’exclusion de la majeure partie de la société, sur des bases raciales. Fomenter la nation signifie alors inclure les franges de la société jusqu’à présent exclues du jeu politique. Différentes formes d’inclusion se succèdent en Colombie au long du XXème siècle. Faisant appel à des campagnes d’hygiénisation, de diffusion culturelle mais aussi de récupération des folklores nationaux, l’élite politique a tenté de préparer le peuple au jeu capitaliste mais aussi a cherché à faire naître une âme nationale, ce qui placerait la Colombie parmi les nations modernes. L’étude de tels processus sous l’angle de la réception populaire pourraient permettre une réelle compréhension des temps vécus. Mais, le parcours d’une telle recherche reste contrarié, la question la plus difficile pour les études culturelles étant celle de la réception d’un discours par son public.
Mots clefs : Colombie ; Ethnohistoire ; Nation ; Politiques culturelles ; Populaire ; Réception.
--------------------------------------
Margot Péronne Wasmer
Master Etudes latino-américaines
IHEAL-CREDA (Université Paris3)
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Faire une ethnographie du passé : le cas de la réception populaire
des politiques culturelles en Colombie (1930-1946)
Introduction
La modernité politique, incarnée par les Etats-nations européens, a largement perturbé l’ordre établi dans différentes régions du monde, dont l’Amérique latine. Après le démembrement de l’Empire Ibérique, les différents pays ont entamé la recherche politique de la Nation, considérée selon le modèle occidental comme le cœur des systèmes politiques modernes. Mais après un XIXème siècle marqué par l’exclusion de la majeure partie de la société, sur des bases raciales, fomenter la nation signifie inclure les franges de la société jusqu’à présent exclues du jeu politique. Différentes formes d’inclusion se sont succédées et ont coexisté en Colombie au long du XXème siècle. Faisant appel à des campagnes d’hygiénisation, de diffusion culturelle mais aussi de récupération des folklores nationaux, l’élite politique a tenté de préparer le peuple au jeu capitaliste mais aussi a cherché à faire naître une âme nationale, ce qui placerait la Colombie parmi les nations modernes. Ces politiques, dirigées aux paysans et ouvriers ont-elles répondu aux attentes du peuple ? Quelle fut leur réception populaire ? Le nationalisme comme objet d’étude est souvent à l’origine d’une grande production d’histoire des idées politiques. Cependant, l’analyse de ces politiques sous ce seul angle est à mon sens une vision biaisée du processus. Ecouter le peuple à propos des politiques faites à son égard me semble d’une importance capitale pour mieux comprendre les temps vécus et leurs conséquences sur le présent. A travers l’analyse d’une politique culturelle particulière, les Ecoles Ambulantes, j’ai souhaité rendre compte de la réception populaire des politiques culturelles, voulant ainsi proposer une nouvelle lecture du processus de construction de la nation colombienne, avec toutes ses discontinuités. Rendre compte d’un ressenti populaire impliquait donc d’entreprendre une recherche différente, notamment dans sa méthodologie : celle d’une réelle étude descriptive et analytique des paysans et ouvriers des années 30, mais surtout de leur ressenti en tant que premiers visés par les politiques culturelles, le tout effectué à partir d’archives. A travers la rédaction d’un réel carnet de terrain, je souhaiterais mettre en exergue la complexité d’analyse d’un tel sujet, en tant que processus social mais aussi en tant qu’objet de recherche. Ma réflexion s’organisera donc autour des différentes étapes de construction de cette recherche. J’expliquerai tout d’abord la genèse du sujet, comment la volonté d’étudier la communauté colombienne et ses symboles m’ont conduite à entreprendre une telle recherche, accompagnée d’une réflexion méthodologique intense. J’expliciterai ensuite les premiers pas de la recherche, à travers l’étude de l’acteur politique, et comment cela m’a permis une certaine compréhension et approximation du nationalisme comme processus à la fois politique et social. Les sources étant réduites, j’exposerai ensuite les difficultés de cette étude et le point sur la diversification des sources employées, afin de comprendre et de décrire la cristallisation de ces politiques culturelles. Enfin, je ferai part de ma déception personnelle et du difficile deuil qu’il m’aura fallu faire, les sources ne me permettant pas de « faire parler ce peuple ».
I. Comprendre la communauté colombienne et ses symboles à travers son passé : genèse du sujet de recherche
Après presque un an sans fouler le sol colombien, j’arrive le soir du 12 juillet 2011, fatiguée d’un long voyage et angoissée par cette nouvelle étape de vie qui commence. L’odeur pesante de ce Bogota surdimensionné m’a manqué, mes doutes quant à ma venue se dissipent, alors que naissent en moi de nouvelles interrogations : qu’en sera-t-il de mon terrain ? Intéressée par les politiques officielles de nationalisme sous la République Libérale (1930-1946), à travers l’étude de la réception populaire des politiques de création d’identité, j’engage une longue expédition vers le passé colombien. Tout a commencé il y a cinq ans, quand lors de mon premier voyage je me suis acheté, comme beaucoup de touristes une manilla. Ce bracelet tressé aux couleurs du drapeau colombien ne me quitterait plus, comme fier étendard de mon premier voyage outre-Atlantique. Dans un quartier populaire de Cali une dame m’a fait remarquer que je portais, à mon poignet, les couleurs d’un pays qui n’était pas le mien. « Les Français ne sont pas aussi fiers de leur pays que les Colombiens » m’a-t-elle déclarée, comme si ce fût pour elle une vérité incontestable. Je restai sans mot. Ce bracelet représente-t-il pour les colombiens un attachement réel à un pays ? Cet attachement s’apparente-t-il à ce que nous appelons la « nation » ? A l’appartenance à un peuple, à une culture et à un territoire qui différencient le Eux du Nous ? Comment peut-on considérer ce lien visible et matérialisé dans un pays en conflit interne depuis maintenant près de 70 ans où le combat entre le Eux et le Nous met en scène les colombiens eux-mêmes? Comment pouvons-nous comprendre l’« être colombien » d’aujourd’hui quand la société colombienne semble se mutiler, dans un conflit et un système d’exclusion qui fait de la violence une trame « normale » des relations sociales ?
Mes recherches sont nées de ces questions. En tant qu’étudiante en sciences sociales, j’ai souhaité comprendre comment, dans une société en constant conflit, héritage de nombreuses guerres civiles, et que Daniel Pécaut (Pécaut, 1987), politologue français, nomme « une guerre de la société contre la société », le peuple se fondait dans une communauté. N’était-ce pas ce qui manquait en réalité à la Colombie d’aujourd’hui ? Une identité à laquelle chacun s’identifierait, permettant ainsi de dépasser les conflits et l’exclusion, d’apaiser les maux et la violence ? La recherche de cette identité de tout un peuple, la Nation dans son sens moderne(1), a été pour de nombreux pays, en Amérique Latine mais aussi en Asie et en Europe, un long labeur, qu’il a fallu penser, mettre en place, réajuster, pourtant pas toujours efficace. Ce sont ces processus de création d’identité qui m’ont intéressé en Colombie. Dans ce pays dont l’indépendance avait été rythmée au XIXème siècle par de nombreuses guerres civiles et qui ne connaissait comme système de valeurs et de construction sociale que l’exclusion de l’Autre(2), comment allait-on penser, créer une identité commune à laquelle chacun voudrait se rattacher ? De quoi pouvait se nourrir ce « plébiscite de tous les jour » qu’Ernest Renan (Renan, 1882) place au cœur du concept de Nation ? A travers les mots de Renan Silva, historien colombien, cette problématique prend tout son sens. Pour lui, l’inclusion du peuple à la Nation représente un enjeu de taille, qui continue d’avoir des conséquences sur la société actuelle.
« Il nous semble que ce problème est particulièrement important dans la situation actuelle de la Colombie, pays qui traverse non seulement des difficultés dans la construction d’un ordre social, mais surtout qui est caractérisé par une désintégration sociale, et dont les difficultés rencontrées viennent en grande partie de la dérive initiée après 1810, au moment du démembrement de l’Empire Ibérique. En presque deux siècles de vie indépendante la société colombienne a montré d’énormes difficultés à convertir en fonctionnement pratique étendu à toute la société un idéal qui, de façon paradoxale, a été énormément prolifique, créant un abîme et un système de contraste » (Silva, 2000 : 2).
Le phénomène de cristallisation d’une mémoire collective nationale devait alors servir d’appui chaque fois que les urgences du présent posaient la question de l’avenir de cette société. Cette question, très présente, se comprend à travers les mots d’Alfonso Lopez Pumarejo, quand il écrit dans les années 1930:
« Je me suis souvent demandé si durant ce siècle de vie républicaine la Colombie s’est attardée à s’interroger sur son propre destin. Le pays sait-il quelle est son orientation, jusqu’où penche l’effort collectif, comment nous proposons nous en tant que nation ? » (cité dans Silva , 2000 : 3).
L’idée de construire la nation et de renforcer les liens entre les membres de la société, le tout sur la base d’un ensemble de traditions partagées, comme une voie d’affirmation nationaliste et d’invention d’identités collectives prend alors toute son ampleur. Le rôle de l’Etat dans la formation de la nation ne se cantonne plus à la simple intervention économique. Il doit incarner un projet national, un effort matériel et culturel qui puisse se convertir en une politique de toute la société, pour permettre la connexion des groupes et des diverses régions, leur inculquant la fiction d’une histoire commune, présentée comme histoire nationale, et l’espérance d’un futur appuyée dans cette fiction construite (Silva, 2000 : 2). L’interventionnisme étatique dans le champ culturel s’opère donc. Mais, l’historiographie se fixe souvent sur les politiques et leur sens pour l’élite et a rarement cherché à comprendre et redonner une voix à ceux qui les ont expérimentées. Je souhaite comprendre et dessiner cette société des années trente et quarante : comment les campesinos et obreros ont reçu et interprété ces politiques, sorties de l’idéologie élitiste, ayant pour fin l’inclusion politique de ces franges de la société, et la connexion spirituelle, la création d’un lien émotionnel voire sentimental entre tous les Colombiens ? Enrichir le répertoire des acteurs de cette époque est devenu pour moi un objectif non négligeable pour en compléter l’historiographie. Mais il faut pouvoir écouter la voix du peuple alors qu’elle fut longtemps tue, ignorée. Et, dans un contexte politique élitiste, le nationalisme viendrait nécessairement d’en haut, pour embrasser et créer le bas de la société. J’ai souhaité m’intéresser à ce second ensemble, et à la réception que le peuple a fait des politiques créées à son attention. Débute alors pour moi une ethnographie du passé, accompagnée de ces enchantements, mais surtout de ses difficultés. Quelle méthode adopter pour rendre compte des impressions, des ressentis, des classes populaires colombiennes ? L’utilisation de la micro-histoire me semble la méthode la mieux adaptée. Nous chercherons donc à passer d’un cas particulier, tel que la mise en place des Ecoles Ambulantes et des Centres de Culture Sociale, à la généralisation du problème de cette société pour ainsi accéder aux expériences sociales vécues. Or, un obstacle non négligeable persiste : comment faire parler ces personnes, aujourd’hui, presque toutes disparues ? Comment écrire une histoire « différente » ? Bien que riches en informations, les archives(3) représentent une somme de décrets et de rapports écris par le gouvernement et pour le gouvernement, où est totalement absente la voix du peuple. L’époque étudiée ne me permettant pas d’entrevues, il me faut trouver d’autres alternatives. Le principal défi de cette recherche reste donc de trouver des sources pour pouvoir l’aborder.
II. Etudier le phénomène nationaliste à travers l’acteur politique : compréhension d’un processus politique et social
Abandonner totalement l’acteur politique dans cette recherche reste inconcevable, les problématiques de nationalisme et autres politiques de modernisation s’inscrivant nécessairement dans un mouvement intellectuel élitiste et, dans le cas de la période étudiée, à caractère global. En effet, les nationalismes modernes ne sont pas apparus avec le tournant libéral colombien, dans les années trente, ils l’ont précédé voire déclenché. Mon premier contact avec mon sujet est donc bien éloigné de mon objet d’étude : la revue Universidad, dans laquelle la génération des nouveaux intellectuels des années vingt a publié et s’est construite. J’ai consultée cette revue, à la bibliothèque Luis Angel Arrango, dans cette salle sombre qu’est l’hemeroteca. A la vue de ces gros volumes, regroupant les numéros hebdomadaires publiés de 1921 à 1931, je suis à la fois émue et déçue. Toucher l’histoire du doigt est une sensation unique, mais ce n’est pas cette histoire que je souhaite toucher. Je me dédie cependant à l’étude des 124 numéros, comprenant ainsi les diverses origines du mouvement nationaliste ainsi que l’interprétation du monde et de son organisation, à travers les textes de la jeune élite. En écrivant cet article je me sens presque à leur place : celle d’une privilégiée au milieu des inégalités. Le simple fait d’étudier représente pour moi, comme cela représentait pour eux, une chance incroyable de se forger un esprit, une vraie richesse. Cette sensation se renforce à la vue des pages publicitaires de la revue : une propagande de 1921 pour la bière Aguila me renvoie à ma propre existence et à ces moments de parche que le Chorro de Quevedo(4), dans le centre de Bogota, nous offre les week-ends. A croire que les choses n’ont pas changées. Au fil de ma lecture je comprends peu à peu l’importance de la première guerre mondiale dans la prise de conscience d’une existence propre et réelle de l’Amérique ou plutôt dirons-nous, des Amériques. La mentalité des latino-américains envers l’Europe a changé : on n’idolâtre plus un continent qui s’est suicidé dans une guerre sanguinaire. L’Amérique latine recherche alors sa propre force, à dessiner ses propres traits, à comprendre sa propre histoire et à s’éloigner de ce vieux continent qui l’a fait tant souffrir et que l’on a pourtant continué à aduler longtemps. Parallèlement à cette prise de conscience, de nombreux changements économiques s’opèrent, à partir desquels naissent des interrogations sur l’ordre social, sur la capacité physique de l’Homme colombien à supporter la poussée de la modernisation dictée par le capitalisme. En effet, l’entrée du pays dans l’ère capitaliste mondiale et la réception de fonds en compensation de la perte de Panamá vont considérablement brouiller l’ordre établi. Ces deux processus comportent de nombreuses interrogations sur la race, dans un sillon déterministe hérité du XIXème siècle européen. Pour les médecins, devenus alors politiciens,
« L’Amérique hispanophone est née de races historiquement inférieures : indigènes sans capacités de raisonner, noirs sans sens moral, créoles paresseux qui n’étaient ni indiens, ni noirs, ni espagnols ; mulâtres grimpeurs et anarchiques » (Ayala Diago, 2007 : 55).
Les références aux penseurs français sont nombreuses. Je lis avec grand mépris ce que Nous leurs avons très bien enseigné, à haïr l’Autre, celui qui est différent. Et pourtant, Nous ne nous sommes jamais qualifiés nous-même, comme eux le font, de « Race […] caractérisée par sa paresse, la tristesse et l’arrogance » (Ayala Diago, 2007 : 55)(5). Une nouvelle difficulté vient de me sauter au visage, comment prendre du recul, rester objective face aux liens intellectuels si inconfortables entre la France et la Colombie ? Mais, je lis ces textes à travers un cadre bien différent de celui de l’époque, et même si les mots sont durs j’essaie de relativiser. C’est que j’ai la sensation, au fond, que les choses n’ont pas vraiment changé. La Colombie reste un pays où la principale forme de socialisation me paraît être l’exclusion de l’Autre. Presque un siècle est passé depuis la rédaction de cette revue et pourtant la situation me semble similaire. Alors que les avancées technologiques nous propulsent chaque jour plus loin vers le futur, les Colombiens me semblent figés dans un contexte politique et social sans issue, celui d’un conflit armé qui a transformé la violence en quotidienneté et qui favorise l’organisation hiérarchique de la société. A cette époque, la colombianité est pratiquée à travers différents régimes qui tentent d’unifier et de normaliser la population comme « nationale », en même temps qu’ils creusent les différences. La Colombie a donc connu, comme une grande partie de ses voisins, des périodes de politiques d’unité, d’identités et de différences (Castro-Gomez , 2008 : 11). La production de la Nation évolue donc entre unification et différenciation, ces projets et discours voulant la production d’une unité politique et culturelle mais aussi la hiérarchisation des différents groupes de population interpelés par ces techniques. Les écrits de German Arciniegas, Gilberto Alzate Avandaño ou encore Jorge Eliecer Gaitan se succèdent. Cette revue répond à un besoin de ces jeunes intellectuels d’être « des hommes libres d’Amérique du Sud » en échos au manifeste de Cordoba, publié en 1918, à travers lequel les jeunes Argentins ont propagé dans toute l’Amérique latine une critique de l’éducation régnante qui essaie de « maintenir enfermée la jeunesse […] qui exige qu’on lui reconnaisse le droit d’extérioriser cette pensée propre dans les corps universitaires au travers de ses représentants ». Universidad est un des représentants du corps universitaire colombien, et sert les intérêts intellectuels des jeunes étudiants. Ils expriment alors leur souhait de rénover la politique, de l’adapter au capitalisme, sans céder cependant à la morale capitaliste qui s’exalte contre les valeurs soutenues par l’organisation encore féodale de la société colombienne. Dans les années 1920, les anciennes mœurs semblent alors entrer dans une phase d’éboulement (Uribe Celis, 1991 : 58). Rien de surprenant, étant donné que la crise des valeurs, de la religion et de la morale, se présente comme une constante historique dans les sociétés en changement. On considère alors l’exercice des vertus chrétiennes comme solution aux maux sociaux. Mais en refusant le changement de morale amené par le capitalisme, les gouvernants ignorent le mouvement ouvrier urbain qui naît. La question sociale est alors plantée. La croissance urbaine, qui flanque chaque périphérie de ses misères et de son chômage, la colonisation des terrains vagues, le droit du peuple à l’éducation, à la santé et à l’hygiène sont autant de thèmes à penser. Ces intellectuels refusent alors la modernisation de la morale et vont donc faire une tentative de modernisation dans la tradition, en réprimant par les armes l’agitation sociale qui sera un échec et mènera à la chute du conservatisme. Paradoxalement et parallèlement à cette négation de progrès social, les années 1920 sont un foyer de nationalisme notoire et, par conséquent, un laboratoire politique de la modernité. Dans le sillon du romantisme du XVIIIème siècle, on assiste aux premiers pas nationalistes. Le peuple est alors central dans les préoccupations : de lui viendra la réussite ou l’échec de la modernité colombienne. Il faut donc l’hygiéniser(6), l’éduquer, l’instruire. Dans cet élan, la fomentation et l’établissement d’une culture nationale sont de réelles préoccupations. Le passé national intéresse, surtout pour proposer une lecture de celui-ci à travers un prisme triomphaliste et mystificateur. Ces premières approches de l’utilisation de la culture comme politique nationaliste nous conduisent peu à peu au cœur de notre sujet. La conception folklorique(7) de la culture populaire n’est donc pas une exclusivité de la République Libérale. Les premiers pas ont été faits durant l’hégémonie conservatrice. La création et mise en place de valeurs et de modèles historiques tente d’accompagner le peuple dans son entrée dans la modernisation politique. Bogota est, pour certains, « L’Athènes de l’Amérique latine ». L’adoption de l’hymne national se fait durant cette décennie, et accompagne la multitude d’actes commémoratifs qui se mettent en place pour magnifier l’histoire nationale et faire naître le sentiment patriotique chez les plus jeunes. La démocratisation culturelle et des moyens de communication doit servir cette grande cause : le journalisme se consolide jusqu’à être un des plus construit au niveau continental, et sert la rééducation du peuple, en transmettant l’information, palliant ainsi le manque de transmission de l’information scientifique et le manque d’instruction. Accompagnée de campagne d’alphabétisation et d’hygiène, la presse participe à la création d’un « état d’âmes populaires » (Silva, 2001) et la démocratisation de la culture ouvre la voie aux libéraux qui arriveront au pouvoir en 1930. Malgré certaines avancées dans la sécularisation, les premières tentatives de nationalisme, le réveil général et l’euphorie restent élitistes. En dépit des tentatives pour faire participer partiellement le peuple, la majorité de la société reçoit à peine les échos de ce frémissement, les résultats sont superficiels, altérés. En effet, dans le cas de l’hégémonie conservatrice, le désir civilisateur des élites a primé dans les définitions d’identités sociales et géoculturelles, fondées dans la « colonialité du pouvoir » (Quijano, 2000), dans laquelle les classifications raciales étaient déterminantes. L’imaginaire de la blancheur soutenait un ordre hiérarchique et naturalisant, ainsi que des différences populaires et spatiales. Cette vision du national(8), fondée sur la machine binaire utile/inutile et raciale construite à partir d’une vision péjorative du peuple, perçu comme dangereux pour la santé publique(9), n’aboutit pas aux résultats escomptés. Cependant, une période de transformation anthropologique fondamentale se présente alors : l’émergence d’un nouveau Nous, dans un territoire délimité ainsi qu’un nouveau rapport entre le collectif et l’individu dicté, selon Benedict Anderson, par l’utilisation de la Nation comme catégorie analytique permettant de comprendre les différents processus caractérisant la modernité (Anderson, 1991).
III. Diversifier les sources : un moyen de palier le manque d’informations
Il faut attendre l’arrivée des Libéraux au pouvoir pour que le frémissement national se consolide, prenne toute son ampleur et particulièrement à partir du gouvernement d’Alfonso Lopez Pumarejo, en 1934. En étudiant cette période je me réconcilie doucement avec l’histoire du pays. Le prisme pour considérer la nation a changé. Le peuple n’est plus classé selon son utilité mais selon son savoir, à travers le cadre binaire culte/inculte(10). Les libéraux entrent donc dans une stratégie educalizadora(11) qui se superpose à la stratégie raciale des conservateurs. Les politiques culturelles s’allient aux politiques d’hygiène. Le temps passe et je me rapproche du cœur de mon étude en même temps que je le sens s’échapper. Mes premières recherches sont infructueuses. Les seuls témoignages populaires que je trouve dénoncent un manque cruel d’Etat(12), rien que je ne sache déjà. Je vois s’envoler mes espoirs à mesure que défilent les archives. Je vais devoir faire des choix. Je commence par multiplier les chances en me rendant aux Archives locales de Bogotá. Il n’y a rien. Et, celles du département ont brulé. La complexité d’une recherche sans sources officielles prend toute son ampleur. Je pense alors à chercher des personnes qui aient vécu ces moments, en faisant le tour des maisons de retraite de Bogotá et de ses environs. Une de mes amies françaises travaille sur un projet de ferme écologique à Ciudad Bolivar, dans le sud de Bogotá, avec des personnes âgées. Mais, les contacts sont difficiles à faire, et je n’ai que peu de temps. Je reviens donc sur la décision de ne pas utiliser la presse, puisque je considère qu’elle véhicule un point de vue trop élitiste, et je trouve un compromis : l’étude de la presse ouvrière. Un ami journaliste est prêt à m’aider. Je prends rendez-vous dans les locaux de El Espectador, avec Jorge Cardona, la « bible de la maison ». Il connaît l’histoire du journalisme mieux que personne et, surtout, il a des contacts intéressants. Ce lieu me rassure, ces bureaux sont chaleureux, les gens sont prêts à m’aider. Nous faisons un point sur mes recherches et prenons un autre rendez-vous, une semaine plus tard pour concrétiser notre premier échange. Il me demande un temps pour réfléchir et mieux me conseiller. Il me propose aussi d’organiser un rendez-vous avec la petite fille de Jorge Eliecer Gaitan, et avec le fils de Guillermo Nanetti, les ministres de l’Education Nationale de 1941 et 1940. Je reste un peu sceptique mais j’accepte. Les témoignages de ces personnes ne sont en rien populaires, mais la difficulté d’une telle recherche me pousse, de plus en plus, à ne refuser aucune opportunité. Jorge me présente un livre qui traite du journalisme en Colombie. Cette lecture me semble intéressante. Je pourrais peut-être y trouver quelques informations sur la presse ouvrière de l’époque à un niveau régional. Je repars avec de nombreuses questions en tête mais aussi avec davanatage d’espoir pour réaliser cette recherche.
J’ai l’impression de faire un travail invisible dans un pays où l’Histoire n’est même pas une matière obligatoire au collège. La plupart des personnes que je rencontre me disent à quel point cela va être compliqué pour moi de poursuivre ce chemin. D’une part, peu de personnes s’intéressent aux thèmes que je traite. Et, d’autre part, la plupart des archives ont brûlé durant les extrêmes violences du Bogotazo, le 9 avril 1948. Mon travail se complique davantage. A défaut de sources primaires, je révise toute l’historiographie de l’époque. Renan Silva est un de mes auteurs principaux. Tous ses travaux portent sur les politiques culturelles durant la République Libérale, traitées sous l’angle de l’histoire des idées politiques. A la lecture de ces ouvrages je commence à saisir l’idéologie libérale de l’époque, la manière dont s’est créer le concept de culture populaire et les raisons de cela.
« La notion de culture populaire est une création intellectuelle […] dont la construction donne lieu à une distribution particulière des produits culturels (produits de « haute » et « basse » culture), ce qui par principe signifie une valorisation biaisée de ce qu’on appelle la « culture de masse » et un certain attachement au folklore » (Silva, 2001).
C’est une façon politique de concevoir les relations entre élite et peuple, pour ainsi déterminer les traits de la culture populaire. Sous la République Libérale, la représentation de la culture populaire est pensée à travers un prisme folklorique. Elle devient une « représentation officielle, légitime et légitimée» (Silva : 12) qui apparaît durant deux phases précises : la décennie 1930, qui s’applique à diffuser certaines formes de culture intellectuelle mais aussi un système varié de préceptes, normes éducatives et sanitaires considérés essentiels au processus de civilisation de masse(13) ; et la décennie 1940, qui se caractérise par le développement d’une certaine connaissance des cultures populaires, par le biais d’un travail de terrain autour des formes d’activité culturelle des populations paysannes et des habitants populaires urbains. En somme, sont favorisées la diffusion et l’exploration de la vie sociale, économique et culturelle des secteurs populaires. Cette vision de la culture populaire s’inscrit dans un questionnement propre au nationalisme de l’époque sur les relations entre les classes dirigeantes et les masses populaires. L’exclusion et la vision péjorative du peuple en vigueur sous l’hégémonie conservatrice semblent se modifier. La lecture de ces textes me rassure. J’ai l’impression d’aborder une histoire plus « humaine » où l’élite reconnaît ses torts et rend au peuple ses vertus, même si ce ne sont que des paroles, comme dans les discours d’Alfonso López Pumarejo :
« Les principaux vices et erreurs de notre démocratie surgissent, en mon sens, d’une faille fondamentale dans les relations entre les classes dirigeantes du pays et les masses populaires » (República de Colombia, 1939 : 108).
Affirmation complétée par,
« Si la nation a résisté c’est car il y a dans le peuple des vertus insoupçonnées qui l’encouragent, le stimulent et le renforcent, tandis qu’il supporte avec un courage tranquille les contradictions et erreurs des classes dirigeantes » (República de Colombia, 1939 : 110).
Cette nouvelle façon de considérer le peuple, d’en parler et donc de le construire amène à la considération d’un problème de civilisation : le peuple marche nu-pieds, la grande majorité de la population est analphabète, les citoyens n’ont pas conscience de leurs droits ni de leurs devoirs. La situation devrait changer maintenant que le peuple est considéré comme une figure active de la démocratie. La culture est alors vue comme quintessence de l’âme nationale et se met en place un climat pour éduquer les sensibilités populaires et construire alors un nouvel ordre culturel. Les savoirs sociaux s’allient aux savoirs médicaux et biologiques. La considération des masses, nouvellement urbaines et perçues comme dangereuses pour la santé publique, est remplacée par un discours plus modéré dans lequel la race tend à se dé-biologiser (en s’éloignant des considérations raciales) pour entrer dans le terrain de la « culturisation » : « le travail et la culture, sous quelque manifestation que ce soit, sont les pierres de taille de la race » (Bejarano, 1920 : 191). Dans cet esprit, se crée à partir de 1937, au sein du Ministère de l’Education Nationale, une section d’Extension Culturelle, dont la mission est de localiser sur le terrain la culture populaire, c’est-à-dire de connaître et de valoriser l’activité culturelle des masses, en complément de la diffusion de la « haute culture ». L’extension de la culture, dans une société caractérisée par son analphabétisme et ses inégalités en termes d’accès à l’instruction, doit utiliser des moyens appuyés sur des techniques modernes de reproduction du son et de l’image, afin de diminuer les distances culturelles entre groupes sociaux, mais aussi dans le but de toucher un maximum de personnes et de régions. L’Extension culturelle cherche à améliorer le niveau de vie, mais surtout à favoriser les mouvements d’intégration entre le gouvernement et le peuple, à travers une certaine cohérence et homogénéité des formes sociales. En somme, elle cherche à produire « Nation et communauté » (Anderson, 1991) dans la société paysanne, à « établir une connexion intelligente entre les obligations de l’Etat et les exigences du peuple au gouvernement » (López Pumarejo, 1939 : 81). L’Extension culturelle est alors la localisation sur le terrain de la culture populaire. Le travail de connaissance et de valorisation de l’activité culturelle des masses irait de paire avec l’idée d’étendre la culture aux masses. Les Beaux-Arts ont alors une importance relative dans cette organisation car ils vont permettre d’étendre une partie de l’activité culturelle considérée comme « haute culture » aux groupes et quartiers populaires : l’Orchestre symphonique donne des concerts gratuits, les ouvriers sont conviés à ces actes culturels, à faire pénétrer dans la vie des masses populaires l’amour de l’Art (jusque là produit par et pour l’élite). Mais, l’Extension culturelle ne se résume pas à la transmission d’un certain art aux masses. Le projet intègre aussi un volet de récupération de l’art populaire, que Dario Achury Valenzuela, longtemps directeur du service d’Extension Culturelle, qualifie, en 1940, de la manière suivante:
« Ses différentes activités [de la section d’Extension culturelle] convergent vers une fin essentielle : orienter et concrétiser les différentes manifestations de la culture nationale, au profit du peuple, se comprenant par culture, non l’acquisition de connaissances décoratives et vaguement éducatives, sinon un répertoire de convictions qui dirigent réellement l’existence d’un peuple. Cela, avec des conditions particulières, est le supposé humain sans lequel la culture est impossible, car perdre de vue la vie effective de l’homme et ses inévitables urgences est précisément la négation de la culture. »(Ministerio de Educación Nacional, 1940 : 9).
Une des tâches de la direction d’Extension Culturelle est donc d’élargir, de favoriser, de connaître la culture des masses populaires, perçues comme élément de base à la construction d’une culture nationale (Extension culturelle : 74). Parmi les outils de ce système on compte la Radio Nationale, principal instrument de propagande culturelle, soutenue par les Ecoles Ambulantes, le Cinéma Educatif et la diffusion de livres. On allie donc à la diffusion de la culture des moyens d’alphabétisation. L’historiographie me permet de mieux appréhender ces projets et le système de valeurs qui les sous-tend. La radio est un outil central de diffusion. Heureusement, j’ai pu assister à plusieurs conférences de l’historienne Mary Roldan, du collège de New-York, qui publiera ensuite un livre sur la Radio diffusora Nacional de Colombia. Je comprends alors comment la Radio a été utilisée et je découvre l’engouement populaire face à cette nouvelle technologie. D’une certaine manière et à un certain niveau, le peuple analphabète avait accès au savoir. De plus, cet outil permet de recréer une mémoire collective, en syntonisant les colombiens sous un même temps historique, homogène, base de l’unité nationale. Le contexte de liberté informative crée par la Radio colombienne sert l’idée de Nation, d’identité collective, d’intérêt général et public. La promotion d’un nouveau lien affectif à travers les ondes de la Radio nationale doit produire une communauté et harmoniser la société constituée, jusque là, d’individus isolés. Le succès de la radio s’exprime sur les gros titres des journaux. A la lecture des deux quotidiens les plus connus, El Tiempo et El Espectador, je saisi l’engouement vis-à-vis de cette nouveauté. Un article de El Tiempo attire plus particulièrement mon attention :
« Les généreux et méthodiques efforts [de la radio nationale] ont le singulier mérite d’avoir influencé de la manière la plus efficace et saine sur la réalité intellectuelle du peuple. […] Ses programmes […] renferment quotidiennement tout ce dont rêve celui qui aurait l’intention d’acquérir ou de développer ses connaissances. Musique, littérature, Beaux-Arts, questions administratives et techniques, […] traités avec une habilité extraordinaire. […] Tous ces services sont voués, de façon admirable, à instruire de manière visiblement pédagogique et agréable, […] rien de meilleur ne peut être exigé dans ce sens ».(14)
Adossées à ce grand processus d’éducation et de création de liens invisibles favorisant « l’unité », les Ecoles Ambulantes vont se développer, à partir de 1940, sous le Ministère de Jorge Eliecer Gaitan, et traverser les routes de la Colombie, village après village, jusqu’à la fin du premier semestre 1941. Dans le désordre des Archives Générales de la Nation, je trouve le compte rendu de l’époque sur le fonctionnement des écoles. J’ai donc la possibilité d’approcher l’idéologie que sous-tend la création de ce système mais aussi son organisation et ses objectifs :
« (…) diffuser par les moyens les plus pratiques et efficaces les principaux éléments de culture à tous les secteurs populaires; étudier les problèmes de santé scolaire et paysanne et les problèmes d’éducation physique, à travers une consciencieuse et permanente recherche qui permettrait, par la suite, l’adoption de moyens concrets pour l’amélioration de la race, de l’esprit et de la mentalité de toutes les classes sociales (Extension culturelle : 21) ».
Ainsi, trois sections sont organisées. La première est composée du cinéma éducatif, de la bibliothèque rotatoire et de la discothèque. La seconde section fondée sur la médecine regroupe un travail d’hygiène, un cabinet dentaire et des cours d’éducation physique. Enfin, la troisième section, plus artistique, s’occupe de diffuser l’art par un groupe de danse, une chorale et un ensemble scénique. Mais, ces écoles ne servent pas seulement à dispenser des savoirs mais aussi à en collecter. Chaque école est dirigée par un inspecteur dont la tâche est multiple. Au delà de veiller au bon déroulement des enseignements, il doit transmettre un compte rendu sur l’accueil réservé aux écoles et effectuer une étude du lieu visité, une sorte de mini ethnographie. Connaître le pays -et ses populations- est l’un des principaux objectifs de ces écoles. Ainsi l’inspecteur doit étudier les habitudes, les modes vestimentaires, les traditions, le niveau d’hygiène et de santé dans ce cadre… Renan Silva qualifie ce travail de préambule à celui de l’enquête folklorique de 1942 qui transforma chaque maître d’école en ethnographe d’un jour, dont la mission était de recueillir méthodiquement le folklore national pour pouvoir établir avec précision les profils de l’âme nationale. Ce qui attire le plus mon attention est la partie réception populaire des comptes rendus. Je vois s’entrouvrir une porte sur la résolution de ma question de recherche. Il faut maintenant pouvoir retrouver ces comptes rendus. Je me rends donc dans plusieurs institutions, dont la Bibliothèque Nationale à laquelle fut rattaché le service d’Extension Culturelle, avec l’espoir de trouver des informations. Mais la mémoire est en conflit en Colombie et l’état des archives reflète bien ce processus. Les comptes rendus sont introuvables. Je me plonge cependant dans la lecture d’un fond appelé « comptes rendus et communications : 1941 » dans lequel je lis à plusieurs reprises que des lettres de la part des villageois arrivent en masse aux différents services. Or, l’organisation est telle qu’il m’est impossible de savoir de quelle ville, de quel département, de quelle région ils proviennent. Le nom des inspecteurs ayant rédigé ces comptes rendus n’apparaît pas. Les lettres ont donc bien existé, mais leur conservation relève du mystère. La frustration d’une telle découverte que je ne peux approfondir est grande. Mon sujet m’échappe totalement. Je crois avoir tout tenté, du moins tout ce qui était entre mes mains, sans résultats. Catalina Muñoz, historienne de l’université du Rosario qui m’aide dans cette recherche me rassure en me confirmant que si je n’ai pas trouvé c’est que les sources n’existent pas ou ne sont pas accessibles de manière publique. C’est un des risques de la recherche en histoire. Sans sources, comment travailler et avancer dans mes questionnements ? La déception est grande. Je n’écrirai pas d’histoire différente. Je dois alors repenser mon sujet, et trouver une nouvelle question de recherche à laquelle je puisse répondre.
Conclusion
A la fin juillet 1941, les Ecoles Ambulantes auront visité 10 régions, pas moins de 180 municipalités, en 358 jours. Pourtant les témoignages populaires, de personnes ordinaires, sont restés introuvables. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que ces politiques culturelles furent assez bien reçues et appréciées de la population. Le peu d’éléments que j’ai pu étudier appuient cette hypothèse, même s’ils ne traduisent pas nécessairement la voix du peuple. La Colombie reste aujourd’hui un pays sans union, ces politiques n’ont donc pas atteint le but visé. Les raisons sont, à mon sens, gouvernementales. Le manque d’Etat, de décentralisation, la difficulté de faire appliquer la loi en dehors de la capitale et des villes qui la relie par voies terrestres, permettent d’expliquer l’échec d’une telle politique publique. Les Ecoles Ambulantes disparaissent fin 1941, lorsque le matériel n’est plus utilisable car il fut trop peu entretenu, volé ou encore perdu. Les régions refusent de rendre les camionnettes pour que l’Etat les remette en circulation après réparation, les appareils de cinéma éducatif ne fonctionnent plus… Bogotá souhaite la reprise de la tournée des Ecoles mais cela devient impossible de par la non-coopération régionale. Depuis, les problèmes sont, en partie, toujours les mêmes : le manque d’Etat et le régionalisme. Aussi, l’inexistence de l’acteur populaire dans les archives me fait réfléchir. Je commence à penser que cela explique, peut-être, certains échecs de cette politique. Comment poursuivre un travail « populaire » quand l’acteur populaire reste invisible ? Le gouvernement ne semble pas s’être intéressé à ce que les ouvriers ont pensé de ces démarches sociales et politiques. L’intérêt de tels retours devait être qualifié de relatif, vu que les courriers n’ont pas été conservés... L’image d’un projet populaire s’est évanouie peu à peu. Comme beaucoup d’autres projets en Colombie, le populaire reste un concept, une rhétorique et non une réalité considérée dans sa complexité. Les élites en parlent, l’utilisent à des fins politiques mais elles ne cherchent visiblement pas à le comprendre et encore moins à lui faire une place au niveau national. Cette forme de censure de la voix populaire est franche et a certainement toujours existé. L’élite reste donc l’élite, au centre du jeu politique qu’elle soit conservatrice ou libérale. Les vaines tentatives d’inclusion des franges populaires à une nouvelle forme de citoyenneté dictée par la modernité auront finalement permis d’installer et de consolider la fracture sociale dans le pays. Bien que la manière de s’intéresser au peuple ait été quelque peu différente sous la République Libérale, il reste « introuvable »(15) et, d’une certaine façon, non considéré dans la construction de la Nation, alors qu’il en est le cœur. On trouve ici une des possibles explications à la violence persistante dans la société colombienne. L’élite a en effet posé à travers le processus de construction de la Nation, les bases d’une nouvelle forme de reconnaissance populaire(16), malheureusement inachevée, puis niée. Sous la République Libérale, c’est à travers la folklorisation de la culture populaire que le peuple récupère ses vertus. Les politiques culturelles telles les Ecoles Ambulantes ont donc largement contribué à la matérialisation d’une idéologie nouvelle plaçant le peuple au cœur de la démocratie, bien que cela produise des tensions de plusieurs sortes, présentées dans cet article. Les Ecoles Ambulantes s’arrêtent donc à la fin du premier semestre de l’année 1941, emportant avec elles les ambitions et les espoirs de l’élite mais aussi l’élan d’un peuple qui commençait, tout juste, à ressentir les changements de la vision que les dirigeants avaient et véhiculaient sur cette tranche majoritaire de la population colombienne. Ces premières formes d’intégration du peuple au tout national ont certainement préparé celui-ci au populisme qu’incarnera le personnage de Jorge Eliecer Gaitán. Considéré et depuis peu présent et indispensable, le peuple est alors attentif à l’appel aux masses. A la fois reconnu et avec une demande de reconnaissance chaque fois plus grande, le peuple va donc recevoir et interpréter les appels de ce leader libéral pour le soutenir dans sa course à la présidentielle, en 1948. L’assassinat de Jorge Eliecer Gaitán, le 9 avril 1948, représente un moment difficile pour ce peuple qui commençait à être reconnu, qui commençait à émerger comme interlocuteur potentiel dans les discours politiques. Les violences meurtrières qui ont suivi cet assassinat et qui plongeront le pays dans un état de violence extrême pendant dix ans, mais qui sont surtout à l’origine d’un certain réveil populaire ayant amené à la création du groupe révolutionnaire des FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) trouvent donc, d’une certaine façon, leur origine dans des faits plus anciens que le seul assassinat de l’homme providentiel. Les politiques nationalistes colombiennes s’arrêtent au début de cette période de guerre civile, dont les conséquences se font sentir encore aujourd’hui dans le pays. L’absence première de l’acteur populaire, son instrumentalisation puis son rejet ont réellement écarté le peuple-populaire de la vie publique. Bien qu’utilisé à des fins politiques, souvent clientélistes, le peuple reste un concept pour les dirigeants et non une réalité, un groupe d’acteurs à prendre en compte et avec qui dialoguer. Malgré plusieurs tentatives nationalistes pendant la seconde moitié du XXème siècle (et notamment sous la présidence de Alvaro Uribe), la société colombienne reste constituée de l’élite du pays, les majorités restant absentes du jeu démocratique, continuant de servir les intérêts des partis hégémoniques sur des bases clientélistes.
---------------------------------------------------
Notes de fin
(1) D’après Benedict Anderson et Ernest Gellner, la nation se construit par la voie de l’homogénéisation culturelle, de la création d’une communauté qui doit partager un certain patrimoine (langue, traditions, race, histoire) qui la distingue des autres groupes. La Nation est alors pensée comme une communauté imaginée de semblables. Elle est donc un objet, un ensemble culturel limité, particulier et autocontenu, car elle est une puissante construction symbolique qui ordonne et soutient le peuple en formes d’identification collective et individuelle.
(2) Le livre de Cristina Rojas Civilisacion y violencia décrit parfaitement la création de l’Autre comme ennemi et son exclusion en Colombie, par l’imposition d’un système de valeurs occidentales sur la société colombienne au XIXème siècle.
(3) Dans le cadre de cette recherche nous avons consulté les archives du Congrès, des différents ministères de l’Education Nationale, des Beaux-Arts, de la Bibliothèque Nationale, du département du Cundinamarca et de la ville de Bogotá.
(4) Le Chorro de Quevedo est une place du centre historique de Bogotá où les jeunes étudiants colombiens se retrouvent le soir pour jouer de la musique, souvent folklorique, boire et danser.
(5) César Augusto Ayala Diago fait ici une paraphrase de Silvio Villegas qui dans sa thèse « La démocratie dans les tropiques », présente ses préoccupations et sa lecture des conditions humaines et géographiques avec lesquelles doit compter la Colombie pour son progrès.
(6) Le concept d’hygiénisation de la population repose sur l’enseignement de ce que l’on considère à l’époque l’hygiène « de base », notamment dans les écoles. Le peuple ne doit plus être un danger pour la santé publique. On lutte alors contre l’alcoolisme et les maladies par des campagnes d’hygiène.
(7) La conception folklorique de la culture populaire est propre aux libéraux. Elle implique une récupération du folklore et l’interprétation de celui-ci comme populaire. Le folklore devient alors le symbole du populaire.
(8) A l’époque la société se hiérarchise en fonction d’une « pigmentocracie » dans laquelle le blanc est supérieur à l’indigène et au métis. La création de la Nation va donc suivre cet idéal, les politiques mises en place servant à réhabiliter le non-blanc dans le but de stopper la dégénérescence de la race.
(9) Le peuple est perçu comme un danger pour la santé publique à un niveau hygiénique, car il présenterait des risques de contagion, mais aussi à un niveau économique car sa condition ne lui permet pas de mener à bien le travail nécessaire à la modernisation capitaliste du pays.
(10) Pour plus d’informations sur les stratégies biopolitiques ayant existé en Colombie, les stratégies mises en place (raciale, d’éducation, de développement) et les machines binaires sur lesquelles elles sont fondées, se référer à l’article de Daniel Diaz, Race, peuple y pauvres : les trois stratégies biopolitiques du XXème siècle en Colombie (1873-1962).
(11) Le terme éducalizadora fait ici référence aux nouveaux moyens engagés dans le processus de création de l’identité nationale. L’éducation, de façon générale (pas seulement l’école mais aussi l’éducation des adultes) devient un nouvel outil du processus.
(12) La quasi-totalité des lettres et télégraphes reçus à cette époque par le gouvernement réclament un police plus présente, moins corrompue et partisane et un système judiciaire plus efficace pour lutter contre les emprisonnements abusifs, souvent attribués aux luttes entre libéraux et conservateurs.
(13) Pour plus d’information sur le processus de superposition des idéologies que sous-tendent les régimes de colombianités (ici machines binaires utile/inutile et culte/inculte) se référer à l’ouvrage de Santiago Castro-Gomez et Eduardo Restrepo, Généalogies de la colombianité : formation discursives et technologies de gouvernement au XIXème et XXème siècle.
(16) Le peuple a besoin de reconnaissance et les nouvelles considérations et politiques de la République Libérale entament un nouveau chemin vers la reconnaissance du populaire et constituent donc un élément concret de la mise en place d’une certaine citoyenneté. En effet, si l’on considère différents philosophes de la démocratie tels que Rousseau, ou Rawls, la reconnaissance mutuelle des citoyens en tant que citoyens, une sorte de reconnaissance civile, est un élément concret de la vie démocratique. (LÉCHENET 2010). La reconnaissance représente donc un élément, une condition de la participation à la vie sociale, la « condition nécessaire de toute socialisation humaine ».
Bibliographie
Anderson Benedict (1991). Imagined Communities. Londre : Verso.
Ayala Diago César Augusto (2007). El porvenir del pasado, Gilberto Alzate Avendaño, sensibilidad leoparda y democracia. La derecha colombiana de los años treinta. Bogota : Fundacion Gilberto Alzate Avendaño.
Bejarano Jorge (1920). “Quinta conferencia”. Los problemas de la raza en Colombia. Bogotá : Biblioteca de Cultura.
Castro-Gómez Santiago, Restrepo Eduardo (2008). Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas et technologicas de gobierno en los siglos XIX y XX. Bogotá : Pensar.
Extension culturelle, fond : ministère de l’Education Nationale (direction des Beaux-Arts), Activités Culturelles, Informes, pochette 6, caisse 3.
Gellner Ernest (1983). Nations and nationalism. Ithaca : Cornell University Press.
Léchenet Annie (2010). La reconnaissance, condition à l’exercice de la citoyenneté, y compris pour les femmes, ou ce que peuvent nous apporter les propositions de Axel Honneth. Texte présenté au Congrès annuel de l’Association Suisse de Sciences Politiques, Genève.
López Pumarejo Alfonso (1939). Mensajes presidenciales, 1934-1938. Bogotá : Imprenta Nacional.
Ministerio de Educación Nacional(1940). La Obra Educativa del Gobierno, T. III. Bogotá : Imprenta Nacional.
Pécaut Daniel (1987). L'ordre et la violence: évolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953. Paris: EHESS.
Quijano Aníbal (2000). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.” Dans La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires : Clacso.
Renan Ernest (1882). Qu’est-ce qu’une Nation. Paris : Levy.
República de Colombia (1939). Mensajes Presidenciales, 1934-1938. Bogotá : Imprenta Nacional
Silva Renán (2001). Republica liberal y cultura popular en Colombia, 1930-1946. Cali : La Facultad, 2001.
Uribe Celis Carlos (1991). Los años veinte en Colombia. Ideología y cultura. Bogota : Ediciones Alborada
Pour citer cet article
Péronne Wasmer Margot, « Faire une ethnographie du passé : le cas de la réception populaire des politiques culturelles en Colombie (1930-1946) ». RITA, n°6: février 2013, (en ligne), mis en ligne le 28 février 2013. Disponible en ligne: http://www.revue-rita.com/regards6/margot-peronne-wasmer.html



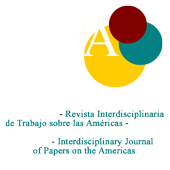








 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8