Défense de l’environnement ou défense d’être paysan ? Le statut de la paysannerie nicaraguayenne reformulé à l'aune des injonctions environnementales
L’étude des conflits agraires montre combien ils sont liés à la modification des modes de production. Les bouleversements survenus à différentes époques au Nicaragua ont contribué à recomposer...
...voire redéfinir les catégories sociales, en fonction du rôle qu’elles étaient censées jouer dans les transformations politiques et économiques, les conduisant à disputer une légitimité historique sur le contrôle de la terre et de ses ressources, tout en faisant valoir que celle-ci constitue un atout majeur pour relever les défis de la modernité.
Mots-clés : Paysans ; Conflits agraires ; Restructurations ; Nicaragua.
-----------------------------------------------
Hélène Roux
Docteure en Sociologie
IEDES, Paris 1
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Défense de l’environnement ou défense d’être paysan ?
Le statut de la paysannerie nicaraguayenne reformulé à l'aune des injonctions environnementales
Introduction
La définition du statut des paysans fait l’objet de débats contradictoires depuis fort longtemps. Les critères diffèrent en effet, selon l’Histoire, la géographie, les traditions culturelles et culturales, la taille des exploitations, les formes de possession. Le cas du Nicaragua illustre bien la tension existante entre les transformations dans le domaine foncier rural et la définition des catégories sociales. A l’occasion d’une étude réalisée entre 1990 et 2010, j’ai cherché à comprendre comment les actuelles orientations en matière de politiques de développement, promues par les institutions financières internationales et les organismes de coopération, ont influé sur les choix politiques du pays et contribué à remettre en question la légitimité de certaines catégories de populations rurales (principalement les ouvriers agricoles mais aussi plus généralement les petits paysans) et de ce fait les formes de hiérarchie qui s’étaient établies entre elles au cours de l’Histoire. Cette approche impliquait de situer l’impact, au niveau local, des nouvelles priorités de l’ordre économique mondial, en particulier celles liées à la gestion rentable des ressources naturelles dans le cadre de ce qu’on désigne aujourd’hui comme « l’économie verte ». Parallèlement il fallait rendre compte du fait que, pour être acceptés, ces apports exogènes doivent s’articuler à des concepts ancrés – ou supposés l’être – dans la tradition politique et historique du pays.
En réalité c’est l’utilisation de la terre qui pose problème et la relation qu’entretiennent avec elle, ceux qui la travaillent et/où utilisent ses ressources. Témoin de l’avènement de la Révolution industrielle, Friedrich Engels, convaincu que « la propriété paysanne [était] fatalement appelée à disparaître », s’est attaché à exposer les difficultés de l’inclusion des paysans aussi bien dans le système capitaliste que socialiste (Engels, 1894). Quelques décennies plus tard, Karl Polanyi a, pour sa part, pointé le fait que les États ont longtemps tenté de faire obstacle à l’inclusion de la terre dans les mécanismes du marché (Polanyi, 1944), laissant ainsi entrevoir qu’elle n’avait pas qu’une fonction productive. Adopter l’une ou l’autre de ces perspectives oblige à reconnaître que les formes de la possession de la terre définissent les catégories sociales, établissent les hiérarchies et par conséquent les relations de pouvoir. À travers cette oscillation entre la fonction économique et la fonction symbolique de la terre, c’est la question de l’intégration du paysan au sein du système qui est posée. Le débat qui s’engage ici, porte sur la définition de son identité, laquelle constitue la clé pour se voir légitimé (ou au contraire discrédité) en tant que sujet politique et économique.
I. Les trois réformes agraires du Nicaragua
Le renversement, en juillet 1979, de la dictature de Somoza par les forces révolutionnaires du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) a favorisé des interprétations de l’évolution de l’Histoire récente du Nicaragua, au prisme des ruptures politiques qu’elles ont provoquées. Et certainement, elles sont importantes : d’abord pour ce qu’elles annoncent des mesures prises pour transformer la société et surtout, pour ce qu’elles révèlent du choix du sujet « révolutionnaire » pressenti pour les mener à bien. En effet, quelles que soient leurs caractéristiques, les réformes ou les restructurations agraires doivent être interprétées comme une réponse politique de l’État face aux revendications du monde paysan. Mais au-delà des objectifs politiques affichés de redistribution de la terre, on doit s’intéresser aux modes de production qu’elle induit et au type d’acteurs qu’elle implique à long terme (Roux, 2008). Au Nicaragua, les seules considérations idéologiques ne permettent d’expliquer que partiellement pourquoi le choix s’est porté sur l’ouvrier agricole au détriment du paysan (petit et moyen). En revanche, une observation sur un temps long des modes de production sur lesquels devait se fonder le développement du pays, permet de mettre ce choix en cohérence non pas seulement avec « l’option préférentielle pour le prolétariat », qui inspirait le gouvernement sandiniste, mais surtout avec la Révolution libérale de la fin du xixe siècle. Elle marque une rupture structurelle profonde qui, en balayant le vieux système colonial, a accéléré l’inclusion du pays dans l’économie mondiale. Le boom du café, qui s’est produit à l’époque, a transformé brutalement mais durablement les modes de production, les structures agraires, les conditions d’accès à la propriété (notamment pour les métis qui en étaient jusque là exclus). Peu explorée à l’époque coloniale, la région du Centre Pacifique a alors connu un développement exponentiel avec l’arrivée de migrants européens alléchés par les promesses d’attribution gratuite de terres à qui saurait les mettre en valeur. Un des effets les plus notables de ces changements a été l’incorporation (souvent forcée) d’une population rurale majoritairement indienne au travail des plantations. Cette prolétarisation a entraîné à son tour une mutation d’un autre type : de l’État colonial fondé sur une division raciale, on est passé à l’État nation libéral (dans le sens de la tradition politique telle qu’elle se définit en Amérique latine) divisé en classes. À partir de cette permutation, le paysan indien, qui jusque là était tributaire de la Couronne mais néanmoins possesseur d’un titre de propriété, se transforme en prolétaire métis dépendant des rythmes fixés dans les grandes métropoles par l’économie agro-exportatrice.
Les restructurations agraires et territoriales au Nicaragua entre 1950 et 2000 s’articulent étroitement avec cette première redéfinition de l’identité rurale. Le pays a en effet expérimenté en moins de cinquante ans trois transformations importantes dans le domaine foncier. La colonisation interne vers la côte atlantique, impulsée par le régime somoziste dans les années 1950-1960, répondait au besoin de diminuer la pression sur les grands latifundia du Pacifique et s’inscrivait dans la tradition libérale expansionniste de la fin du xixe siècle. La réforme agraire sandiniste quant à elle, a certes pris des mesures radicales de confiscation des biens somozistes, mais le choix – certes un peu contraint dans un contexte de guerre et d’embargo économique – de miser résolument sur l’agro-exportation a conditionné la décision de maintenir de grandes structures de production étatiques et par conséquent, de favoriser les ouvriers agricoles au détriment des petits paysans. Loin de s’inspirer des révolutions chinoise (plus proche dans le temps) ou mexicaine (plus proche géographiquement et culturellement), les références de la réforme agraire sandiniste puisent à la fois dans la conception libérale de la fin du xixe siècle et dans les analyses – qui datent de la même époque – de Marx et Engels sur la condition paysanne. Ainsi, si une rupture politique et idéologique majeure s’est bien produite lors de la chute de la dictature somoziste, elle n’a pas débouché sur une rupture des systèmes de production qui aurait pu modifier la configuration des catégories sociales.
La troisième « réforme agraire » nicaraguayenne est d’elle d’une nature bien différente. Elle se met en place à la suite de la défaite électorale du Front sandiniste au début des années 1990, dans le cadre de la fin du conflit armé. Elle est supposée apporter une réponse à la démobilisation de dizaines de milliers de combattants (Contras(1) et ex-militaires) majoritairement d’origine paysanne. Mais bien qu’elle soit présentée par les nouvelles autorités comme un pas vers la réconciliation, la restitution des propriétés confisquées aux anciens propriétaires est surtout perçue comme une manifestation de revanchisme politique. Car ce processus, rappelons-le, est contemporain de la chute du mur de Berlin et de l’époque où les économistes libéraux de l’école de Chicago n’hésitent pas à proclamer la fin de l’Histoire(2).
En 1894 Friedrich Engels affirmait « [qu’] on ne peut faire de révolution durable [en France] contre le petit paysan. » (Engels, 1894). Le choix du mot « révolution » proposé par Les Éditions sociales en 1956, pour traduire le terme « Umwälzung(3) », qui en allemand se réfère plutôt à un bouleversement (renversement de situation), révèle un choix, clairement exprimé, de donner à l’expression (révolution) un sens politique, c’est-à-dire l’aspiration des forces sociales à un renversement du système en place. De même qu’il semble opportun de relever ici – sans pour cela s’en étonner –, que l’intention de ceux qui l’ont formulée ainsi, était idéologiquement orientée, il apparaît tout aussi pertinent d’analyser le sens donné à ces mêmes formulations lorsqu’elles sont reprises dans un cadre institutionnel, en particulier celles qui étaient à l’origine connotées comme critiques, voire subversives, vis-à-vis de l’ordre établi.
Au Nicaragua, comme à une échelle plus globale, le discours sur le retour à la démocratie se conjugue à une injonction d’adopter les préceptes de l’économie de marché. Les réformes agraires seront désormais « assistées par le marché(4) ». Dans la mesure où l’intervention de l’État est vilipendée et que celui-ci n’assume plus, comme auparavant, une fonction d’arbitrage politique dans la confrontation entre différentes forces sociales en dispute pour l’accès à la terre, il n’est donc pas surprenant que les gigantesques unités de production étatiques orientées vers l’agro-exportation aient été les premières victimes du tournant néolibéral et l’ouvrier agricole, « sujet révolutionnaire » sur lequel reposait leur fonctionnement, la principale cible de l’offensive idéologique qui l’a accompagnée. La sape systématique des fermes d’État attribuées aux anciens travailleurs ainsi que des acquis sociaux obtenus à l’époque de la révolution sandiniste a rapidement évolué vers une stigmatisation de leur aspiration à accéder à la propriété de la terre. La récurrence des discours tendant à présenter leur échec comme le résultat d’une absence d’attachement à la terre avait pour objectif de justifier la nécessité du maintien de cette catégorie sociale subalterne dans le salariat. Ainsi, il est apparu que l’enjeu réel de l’affrontement concernait la valeur de la terre, en tant que fondement même des rapports de hiérarchie entre les différentes catégories sociales. Toutefois, les ouvriers agricoles n’ont pas été les seuls à naufrager. La chute des prix du café survenue au début des années 2000, a entraîné dans la débâcle l’ensemble du secteur agro-exportateur traditionnel, lequel à son tour a provoqué la faillite de l’ensemble du système bancaire. Élément déclencheur au niveau local, la crise du café a surtout été le révélateur d’une nouvelle mutation du système de production, qui appelait la substitution de la classe dirigeante traditionnelle (et de la main-d’œuvre agricole nombreuse qu’elle utilisait) par une classe émergente d’entrepreneurs tournés vers de nouvelles formes d’exploitation des ressources. De même que le boom du café au xixe siècle avait été à l’origine même de l’assignation d’identité (ethnique vs. sociale), l’adaptation des formes d’exploitation et du système de propriété à l’économie mondialisée a amorcé, en sens inverse, une redéfinition du statut des catégories sociales rurales en fonction du rôle qui leur est désormais assigné au sein du système de production.
II. Du producteur de la terre au gestionnaire de territoire
C’est à partir de là qu’il convient de rediscuter le sens à donner aujourd'hui à la citation d’Engels, en rendant cette fois le terme « Umwälzung » à son sens littéral (bouleversement) afin de comprendre les mécanismes par lesquels ces identités construites sont transformées en fonction des restructurations territoriales qui résultent de l’évolution des formes de production à l’échelle globale. Afin de pouvoir identifier le sens politique des transformations qui se produisent à une période et dans un contexte donnés, il convient de s’intéresser aux discours qui les accompagnent, voire les façonnent et mesurer leur pouvoir d’influence, au-delà de leur dimension descriptive ou interprétative.
Une abondante production de rapports et études atteste des efforts réalisés par nombre d’acteurs institutionnels pour mettre en adéquation les revendications portant sur la diversité culturelle, qui ont pris de l’ampleur à partir des années 1990, avec une exploitation durable des ressources(5). La notion d’identité ethnique joue un rôle prépondérant dans ce schéma interprétatif destiné à servir de support à l’introduction de mesures présentées comme novatrices en matière de politiques de développement. Paradoxalement, en même temps qu’elle semble se référer à un ordre ancestral, réel ou supposé, cette logique essentialiste offre en réalité une vision a-historique. Les transformations économiques et sociales, et les conflits dont celles-ci résultent, ne sont alors plus le fait d’un passé complexe façonné par l’action des différentes forces sociales mais s’expliquent par le comportement « naturel » de telle ou telle catégorie d’acteurs. Pourtant dans le cas du Nicaragua, la reformulation du statut des catégories sociales en fonction de nouvelles priorités économiques où la fonction productive de la terre cède le pas à la gestion des territoires, renvoie bien à une division entre paysans métis et Indiens datant de l’époque coloniale.
Les efforts déployés pour imposer des politiques visant à « civiliser » des populations rurales jugées rétrogrades et indomptables ont traversé les époques, les idéologies et ne se sont, jusqu’à nos jours, que rarement démentis(6). Alors qu’il symbolise l’idée même d’enracinement à la terre, le paysan semble perpétuellement un être en devenir, l’incarnation même d’un stade primitif dont seul le dépassement permettra à l’Humanité de tendre au progrès. Mais paradoxalement, c’est sa permanence immuable qui constitue l’unité de mesure du degré d’avancement du reste de la société.
Dans un article publié en avril 2003 par le quotidien national La Prensa, un haut fonctionnaire du gouvernement du Nicaragua se référait aux paysans comme à « des enragés de l’allumette(7) ». La traduction du titre original de l’article, adoptée ici, ne reflète que trop faiblement le caractère insultant de cette expression qui compare ceux à qui elle s’adresse aux chiens agissant sans discernement et donc incapables de se corriger. Ces déclarations sont un exemple, parmi d’autres, de l’idée largement répandue que le paysan nicaraguayen perpétue une tradition rétrograde, consistant à migrer et défricher continuellement de nouvelles terres. Pourtant, la raison principale du processus de grande mobilité rurale au Nicaragua réside dans la reconcentration des terres. La reprise de l'exode massif vers la frontière agricole – partiellement endigué dans les années 1980, à l’époque de la réforme agraire sandiniste – offre un démenti cinglant aux enthousiastes qui, forts du constat qu’un marché foncier a toujours existé de manière informelle, pensaient qu’il suffirait de le sécuriser pour résoudre le problème d’accès à la terre. En réalité, le dynamisme du marché foncier a surtout favorisé l’appropriation des terres par de nouveaux grands propriétaires et investisseurs étrangers. Paradoxalement les politiques de sécurisation des terres promues par les organismes financiers internationaux ont accru le phénomène et l’inclusion des terres dans le marché a eu pour résultat d’en exclure les paysans. Les plus riches chassent donc les plus pauvres, qui eux-mêmes chassent les encore moins bien lotis, qui eux-mêmes… finissent parfois par occuper des propriétés dont ils sont chassés par un propriétaire qui se voit indemnisé pour le préjudice subi…
III. Inclusion dans le système capitaliste ou subsistance en marge
Contrairement à d’autres pays, au Nicaragua, la migration rurale ne s’est pas faite principalement vers l’étranger ou vers les villes (encore que la capitale, Managua regroupe un quart des quatre millions d’habitants que compte le pays). En effet, la côte atlantique, sous protectorat britannique jusqu’à sa réincorporation au pays en 1905, a constitué pendant longtemps une formidable réserve de terres nationales. Mais l’échappatoire que celles-ci représentaient pour les paysans en quête de terre est remise en question depuis qu’une grande partie a été incorporée à la réserve de la Biosphère de Bosawas. Pris en tenaille entre l’avancée inexorable de l’économie de plantation qui les a chassés de leurs terres sur le Pacifique et les territoires de l’Atlantique désormais inaccessibles, les petits producteurs voient s’amenuiser leurs chances de se développer en tant que force émergente capable de proposer un mode de production alternatif. Parallèlement depuis le milieu des années 1990, la mise en application de la loi sur la démarcation des territoires indigènes – qui fait suite à l’adoption dix ans plus tôt, du statut d’autonomie des régions atlantiques – permet aux Communautés indiennes d’attribuer, ou non, des concessions sur leurs territoires. Ces nouvelles dispositions, qui valent pour les individus comme pour les entreprises, ont été fortement encouragées par les organismes internationaux de coopération au développement notamment la Banque mondiale qui, en même temps qu’elle fait la promotion active de la distribution foncière « assistée par le marché », reprend désormais également à son compte la notion de propriété collective. L’idée, qui apparaît dans le cadre de son programme de gestion des écosystèmes(8), se fonde sur le fait que les territoires les plus riches en biodiversité se superposent aux terres communales traditionnellement occupées par les Communautés indiennes. Bien que les territoires qui leur ont été officiellement restitués, échappent en théorie aux règles du marché, les ressources qu’ils renferment en revanche, constituent une source de profit extrêmement convoitée dans le cadre des marchés émergents liés à l’environnement (l’eau, la capture de carbone, l’écotourisme…) et à l’exploitation de la biodiversité (le bois précieux, les plantes médicinales et les connaissances qui y sont associées, le marché des biotechnologies …).
Les conflits ravivés par la progression vers la côte atlantique d’entreprises à fort potentiel d’investissement dans l’exploitation des ressources naturelles révèlent l’opposition, au sein d’un même système de marché, de deux manières distinctes de gérer les ressources : l’une découle du « dynamisme foncier », l’autre de la conservation des territoires en vue d’en rentabiliser les ressources naturelles. Les contradictions qui résultent de la promotion parallèle de la privatisation des terres et de celles des ressources naturelles ne sont toutefois qu’apparentes. En même temps qu’on dénie aux petits producteurs, la possibilité de s’intégrer à leur manière au marché (local par exemple) en sapant la petite production, l’inclusion des territoires indigènes et des ressources qu’ils renferment, dans l’économie de marché, se fait précisément au nom de la prise en compte de leur « différence » (Bartra 2008). Celle-ci ne semble toutefois acceptable que si elle s’avère rentable dans le cadre d’un système unique de marché. Mais en définitive, le problème se pose de la même manière aux paysans et aux populations indigènes qui se refusent à rentabiliser ce « facteur différence ».Fondant son analyse sur les causes de l’exploitation des paysans et non sur les causes de la pauvreté, le chercheur mexicain Armando Bartra pose le problème en ces termes :
« Il est fondamental d’élucider les mécanismes d’une exploitation, dont les prémisses ne résident pas dans le marché du travail et son aboutissement dans le processus productif capitaliste – comme [l’exploitation] ouvrière –, mais à l’inverse, trouve son origine dans la production pour son propre compte et son aboutissement dans le marché de biens, de services et de travail saisonnier. [C’est la clé] pour une critique rigoureuse d’un système qui, au lieu de conduire à la prolétarisation universelle directe que prévoyait Marx, se fait vieux dans le cadre toujours plus étendu d’un monde de travailleurs précaires, à temps partiel et à leur propre compte, dont la production domestique paysanne immergée dans le capital est le paradigme. […] Mon postulat est que les ‘rustiques’ disparaitront – à Dieu ne plaise ! – le jour où la rente différentielle disparaîtra, c'est-à-dire quand l’agriculture sera le processus continu, intensif et indépendant de la nature, rêvé par les « transgénistes » et les nano technologues […] Car si à l’ère du réchauffement global, les pratiques culturales multiples, diversifiées et durables – proverbialement paysannes – cèdent le pas entièrement au nivellement radical que demanderait par exemple, la production massive d’agro-carburants, sans réduire la consommation énergétique actuelle, la vie humaine elle-même serait mise entre parenthèses. » (Bartra, 2008).
Conclusion
L’opposition artificielle de deux problématiques, celle de l’agriculture et celle de l’environnement a pour effet de dépouiller l’Indien de son statut (social) de paysan pour le rendre à sa condition « naturelle » (ethnique) de gardien de l’environnement. Mais suffit-il d’escamoter le paysan au profit de l’Indien pour que le problème disparaisse ?
Si à l’époque l’idée d’un bouleversement qui se ferait « contre les petits paysans » paraissait inenvisageable, quelles conséquences pourraient avoir les tentatives actuelles de le réaliser sans (ou malgré) eux ? On se trouve ici face à un dilemme qui s’entretient par lui-même : le fait de conférer au paysan un statut indéfini et transitoire, renforce l’idée selon laquelle il ne peut constituer une force sociale en soi (ce qui confirme la nécessité de sa disparition/transformation). Porteur d’une identité par défaut, il est la victime d’un système sur lequel il n’a pas vraiment prise puisque sa seule possibilité de le transformer consisterait à s’y insérer, ce qui impliquerait abandonner sa condition.
La séparation des problématiques (terre et environnement), l’essentialisation artificielle des catégories sociales et la production de concepts tels que « l’empowerment », sont autant d’outils conceptuels, destinés à concéder à ceux dont la disparition semble programmée par la nature même des transformations en cours, des espaces de pouvoir limités aux interstices, tronqués et fractionnés. Leur incorporation au système, sous des formes qui ne le remettent pas fondamentalement en question, (par exemple à travers la participation aux bénéfices pour prestation de services environnementaux ou l’attribution de petits projets non viables), constitue un élément fondamental pour les maintenir sous contrôle. Mais ce mécanisme que le sociologue Pablo Gonzalez Casanova définit comme « la gestion du chaos » peine à surmonter ses propres contradictions. Car prétendre s’inscrire dans une modernité censée faire consensus en invoquant un droit ancestral dépasse le registre de la dichotomie pour aboutir à celui de l’oxymore. Dans le cas du Nicaragua, la tentative de dépasser la dichotomie dépendance/émancipation, en reléguant à un passé révolu l’affirmation du statut social (défini en termes de classe) au profit d’une conception essentialiste de l’identité, n’a réussi qu’à déplacer les conflits sur un terrain où la pratique de l’agriculture, associée à un productivisme désuet se confronte à la gestion de l’environnement, associée à une exploitation efficace des nouveaux potentiels économiques.
----------------------------------------
Notes de fin
(1) C’est ainsi que les sandinistes désignaient les opposants armés au régime, lesquels préféraient se désigner sous le sigle de « Résistance nicaraguayenne ». Sa direction était constituée principalement par d’anciens membres de la garde nationale somoziste et d’un état major politique exilé aux États-Unis, tandis que ses forces vives étaient recrutées (parfois de force) parmi les petits et moyens producteurs qui s’estimaient (souvent avec raison) victimes de mesures arbitraires de la part des fonctionnaires du gouvernement sandiniste (en particulier l’injonction de se constituer en coopératives pour pouvoir accéder à la terre). Le choix délibéré des sandinistes pour le maintien de la grande propriété agro-exportatrice a ainsi favorisé l’adhésion des ouvriers agricoles (qui y étaient attachés) au projet sandiniste et suscité la défiance de nombreux petits et moyens producteurs, qui aspiraient à une autonomie économique à travers l’accès individuel à la terre.
(2) Selon la thèse de Francis Fukuyama : la Fin de l’Histoire et le dernier homme, publiée en 1992.
(3) La proposition « um » indique une rotation et le verbe « wälzen » évoque l’idée de rouler ou de se rouler dans quelque chose.
(4) Selon la formule adoptée par la Banque mondiale à partir des années 1990.
(5) Notamment la Banque mondiale (voir note 8), l’OCDE, l’Union européenne, les agences de coopération au développement de divers pays européens (en particulier celle de l’Allemagne), ainsi que les institutions qui financent les programmes orientés vers le développement durable et les politiques environnementales.
(6) L’historien Eric Hobsbawm a néanmoins attiré l’attention sur le fait que « [la] manière traditionnelle de trainer les pieds que les paysans maitrisent si bien » (Hobsbawm, 2010 : 287) se révèle dans certains cas, d’une grande efficacité politique dans les confrontations avec les États modernes.
(7) « Gobierno: Campesinos son perros al fósforo », La Prensa, 26 avril 2003. La traduction littérale de l’expression « perros al fosforo » (chiens à l’allumette) est incompréhensible telle quelle en français. Il convient de signaler que dans l’édition en ligne du quotidien, ce titre a été remplacé par : « Gobierno : campesinos queman indiscriminadamente » (les paysans brûlent sans discernement).
(8) The World Bank: Project appraisal document on a proposed grant from the Global Environment Facility Trust Fund [Fonds GEF] in the amount of US$ 4.0 million to the Central America Indigenous and Peasant Coordination Association for Community Agro forestry (Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería comunitaria Centroaméricana - ACICAFOC) for an integrated Ecosystem Management in Indigenous Communities. Central America regional project, November 11, 2004.
Bibliographie
Bartra Armando (2008). El hombre de hierro : Los límites sociales y naturales del capital. México : Ed. ITACA-UACM.
(2007). « El laberinto de la explotación campesina ». La Jornada, 16 Avril. México.
[URL: http://www.jornada.unam.mx/2007/04/16/index.php?section=opinion&article=021a1pol]
Baumeister Eduardo, (1999) Iniciativas campesinas y la sostenibilidad de los resultados de la reforma agraria, Popular Coalition/UNRISD, Monograph 1.
Borras Jun, (2002) « La réforme agraire assistée par le marché : les cas du Brésil, de l'Afrique du Sud et de la Colombie et leurs implications pour les Philippines ». Dans Questions agraires et mondialisation (Vol. IX, pp. 119-182). Louvain : Éd. Alternatives Sud, L'Harmattan : 119-182.
Engels Friedrich (1951). Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland. Berlin : Dietz Verlag, Kleine Bücherei des Marxismus-leninismus. Édition française : (1956). La Question agraire en France et en Allemagne. Paris : Éditions Sociales.
González Casanova Pablo (2008) « Entre el orden y el caos - El capitalismo organizado » [URL: http://alainet.org/active/2581 4 ]
Hobsbawm, Eric (2010). « Paysans et politique ». Dans Rébellions. La résistance des gens ordinaires. Jazz, paysans et prolétaires. Bruxelles : Ed. Aden : 259-292.
Polanyi Karl (1983). La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps. Paris : NRF, Éd. Gallimard.
Roux Hélène, (2008) « Actualité des réformes agraires en Amérique latine ». Dans Gaudichaud F. (coord.), Le volcan latino-américain. Paris : Ed. Textuel : 157-176.
Tellez Arguello, Dora María, (1999) Muera la Gobierna ! Colonización en Matagalpa y Jinotega.1820-1890. Managua : URACCAN.
Pour citer cet article:
Roux Hélène, « Défense de l’environnement ou défense d’être paysan ? Le statut de la paysannerie nicaraguayenne reformulé à l'aune des injonctions environnementales », RITA, n°6: février 2013, (en ligne), mis en ligne le 28 février 2013. Disponible en ligne: http://www.revue-rita.com/villes-et-campagnes/helene-roux.html



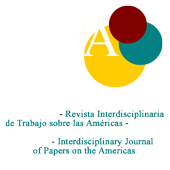








 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8